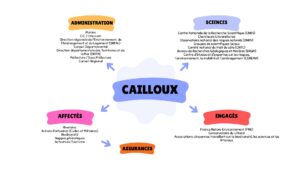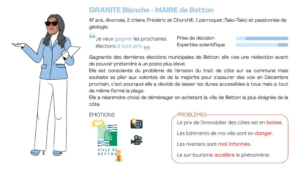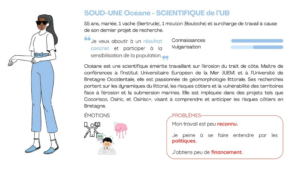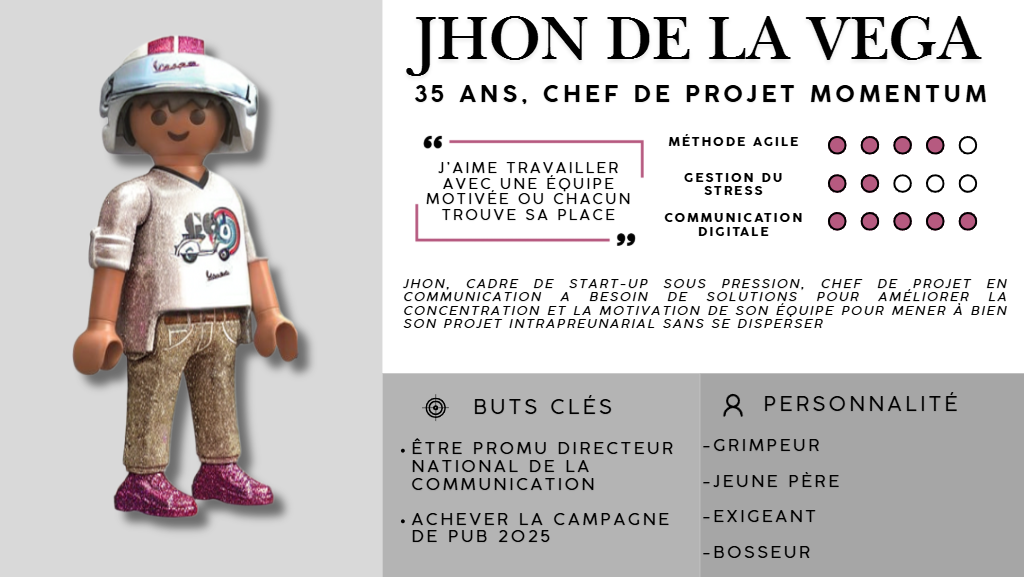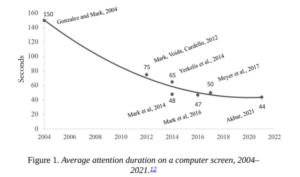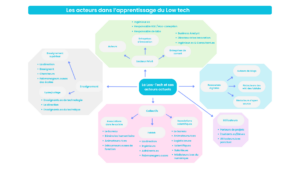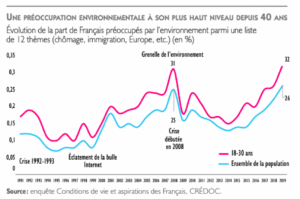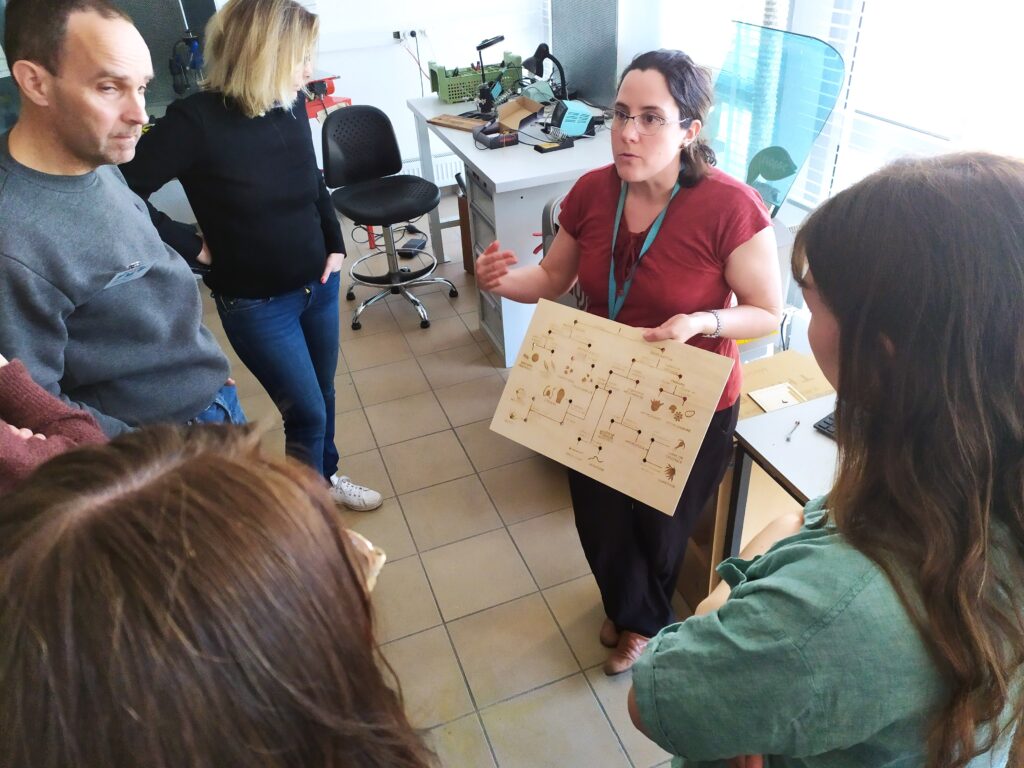Puzzle imprimé à la découpeuse laser
Comment faire un puzzle en couleur à la découpeuse laser ?
Vous pouvez imprimer en couleur sur un vieux calendrier ou une plaque de CP peuplier avec l’imprimante de la presse à chaud.
Pressez ensuite le support à chaud (200°C, 10 secondes pour le calendrier, 20 secondes pour le CP bois) : l’impression sera un peu terne mais il y aura bien un transfert de l’image en couleur.
alternative : faire imprimer par un imprimeur sur du carton, en précisant bien que ça doit être sans chlore !
Générez vos pièces de puzzle sur https://puzzle.telegnom.org/ (par exemple) en ajustant les dimensions voulues et le nombre de pièce en longueur et en largeur.
Récupérez le fichier .svg. Importez le dans Corel Draw puis scinder les courbes (autrement il va déformer les pièces le long d’un bord). Passer les pièces en trait très fin, rouge pur.
Il n’y a plus qu’à placer votre support imprimé dans la découpeuse laser et voir avec la fabmanager pour découper vos pièces de puzzle.
Et voilà !
Cailloux – Blog Enquête Terrain
INTRODUCTION
L’érosion du littoral est un phénomène naturel accentué par le réchauffement climatique. Elle modifie les paysages, menace les habitations et oblige les communes à repenser leur aménagement.
Dans ce travail, nous avons cherché à comprendre comment ce phénomène est perçu et géré à différents niveaux. Nous avons mené une enquête de terrain à travers des entretiens avec des chercheurs, des acteurs publics et des habitants directement concernés. Ces échanges nous ont permis de comparer les points de vue, d’observer les écarts entre les discours institutionnels et les réalités locales, et de mieux saisir les limites des solutions actuelles.
La première partie de notre blog présente la synthèse de ces entretiens et les principaux enseignements tirés. La seconde partie traduit ces informations sous la forme de profils types d’habitants (ou personas), qui illustrent différentes manières de vivre et de réagir face à l’érosion du trait de côte.
I. Synthèse de l’enquête terrain
A. Rappel des hypothèses et de la cartographie des acteurs
Hypothèse 1 : L’érosion côtière est vue comme un problème majeur, mais elle reste gérée localement, ce qui rend les actions peu coordonnées entre elles.
Hypothèse 2 : L’efficacité limitée des politiques de lutte contre l’érosion s’explique moins par les solutions techniques elles-mêmes que par un manque de communication et de coordination entre les acteurs concernés.
Hypothèse 3 : La sensibilisation et la participation citoyenne constituent un levier décisif pour une gestion durable et acceptée des zones côtières.
Hypothèse 4 : Le débat scientifique autour du lien entre changement climatique et érosion montre que l’incertitude scientifique complexifie la prise de décision publique.
Face à l’accélération perçue de l’érosion côtière, les politiques d’aménagement actuelles montrent leurs limites. Comment renforcer l’efficacité de la réponse collective à ce phénomène, notamment par une meilleure information, coordination et sensibilisation des acteurs locaux ?
- Liste anonymisée des personnes rencontrées
| Pseudo | Poste | Caractéristique | Verbatims |
| Mme SOUD-UNE | Chercheuse à l’IUEM | Rigoureuse et amicale | “On parle toujours de recul du littoral, mais c’est la vision humaine qui recule, pas la mer qui avance.” |
| Mme GRANITE |
Cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM* Finistère |
Dynamique, volontaire et engagée sur le sujet | “Rien ne sera fait tant que l’érosion du trait de côte ne sera pas perçue comme un risque” |
| M. GALECTRICIEN | Responsable des services techniques de la commune de Locmaria-Plouzané | En retrait et fataliste | “Il n’existe aucune solution, il faut seulement laisser faire.” |
| Gérard, Aline et Thierry | Habitants de Treffiagat | Sentiment commun d’injustice et d’impuissances, ils se sentent livrés à eux-mêmes. | “déchirement” ; “Tout a été essayé, rien ne fonctionne” |
* Direction Départementale des Territoires et de la Mer
C. Synthèse des informations clés récoltées lors des entretiens
a. Mme SOUD-UNE, chercheuse à l’IUEM
L’entretien avec Mme SOUD-UNE, permet de mieux comprendre les mécanismes naturels et humains à l’origine de l’érosion côtière ainsi que les difficultés liées à sa gestion. Son approche met en évidence la nécessité d’adopter une vision à long terme, souvent incompatible avec les logiques politiques actuelles.
Premièrement, elle nous a défini l’origine et les mécanismes de l’érosion côtière. Celui-ci n’est pas un phénomène récent : le littoral est par nature instable et en constante évolution. Depuis 20 000 ans, le niveau marin a connu une hausse de près de 100 mètres, à des rythmes variables. Cette instabilité résulte de cycles climatiques longs, liés à la position de la Terre et aux alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. L’érosion du trait de côte correspond à un remodelage permanent, plutôt qu’à un simple recul linéaire.
Les matériaux constituant les plages proviennent d’anciens dépôts, désormais épuisés, car les cours d’eau bretons ne sont plus capables d’en fournir de nouveaux. De plus, les activités humaines ont aggravé la pénurie de sédiments disponibles. Un exemple est le prélèvement de sable et de galets pour la construction du Mur de l’Atlantique ou la reconstruction d’après-guerre en France.
La distinction entre la part naturelle et la part humaine dans l’érosion est floue. Les aménagements construits pour protéger certaines zones (digues, enrochements) ont souvent des effets négatifs ailleurs, en déplaçant l’érosion. Les solutions techniques locales ne font donc que déplacer le problème plutôt que de le résoudre.
Les élus, soumis à des mandats courts, privilégient souvent des réponses immédiates au détriment d’une stratégie durable. La loi Climat et Résilience constitue une avancée, car elle oblige désormais à réfléchir à l’horizon 2050, mais les obstacles juridiques, sociaux et politiques rendent la mise en œuvre des politiques de désurbanisation extrêmement longue (environ dix ans entre la décision et l’application effective).
Selon Mme SOUD-UNE, la solution la plus durable consiste à désurbaniser le littoral et à laisser la nature agir. Cependant, cela pose de nombreux défis économiques et sociaux. Certaines expériences en cours explorent des formes d’aménagements flottants (en Chine, à Ningbo, ou encore à Amsterdam), voire des projets d’infrastructures adaptatives comme à Venise.
Des exemples concrets, tels que le port d’Ouessant, montrent l’ampleur des adaptations nécessaires : surélévation des quais, réorganisation des bâtiments pour placer les réseaux et bureaux en hauteur, et utilisation des rez-de-chaussée uniquement pour le passage. Ces initiatives témoignent d’une prise de conscience progressive, notamment chez les gestionnaires portuaires et militaires, mais encore inégale parmi les usagers et les habitants.
L’entretien avec Mme SOUD-UNE confirme que l’érosion est un enjeu sociétal majeur (hypothèse 1) et qu’elle est influencée par le climat, même si la part humaine est difficile à isoler (hypothèse 2). Les politiques d’aménagement peuvent limiter localement les effets, mais elles déplacent souvent le problème (hypothèse 3) et restent globalement insuffisantes face au remodelage naturel du littoral (hypothèse 4).
b. Mme GRANITE, cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM (Direction Départementale des Territoire et de la Mer) Finistère
L’entretien avec Mme GRANITE, cheffe de l’unité SL/UEGE à la DDTM, met en évidence plusieurs aspects essentiels de la problématique de l’érosion du trait de côte. Elle rappelle d’abord l’ampleur d’un phénomène qui est prononcé dans plusieurs zones comme le Finistère notamment à Treffiagat et Kerlouan mais qui ne se limite pas qu’à ce seul cadre local. A Treffiagat particulièrement, de multiples solutions testées ont échoué, au point que les autorités ont finalement abandonné la recherche de solution. Cette impuissance souligne la difficulté de mettre fin à ce phénomène qui reste naturel et qui, juridiquement, n’est pas reconnu comme un risque mais seulement comme un aléa. « L’érosion du trait de côte n’est pas légalement perçue comme un risque, mais plutôt comme un aléa », précise-t-elle, ce qui entretient une certaine confusion dans l’action publique. Cependant d’énormes moyens financiers ont été utilisés par l’Etat pour protéger les populations tout en étant le plus juste possible. En effet, nos interlocuteurs affirment que trois millions d’euros ont déjà été dépensés pour racheter 3 maisons menacées dans le sud-ouest du Finistère afin de les détruire et quatre autres doivent suivre cette procédure.
Face à cette situation, des initiatives innovantes émergent, comme l’application mobile CoastApp, permettant aux citoyens de documenter l’évolution du littoral par des photos et de partager ces informations.
Les informations recueillies lors de l’interview imposent plusieurs constats : l’érosion concerne une large partie du territoire et mobilise des dépenses publiques considérables. Aussi, les stratégies actuelles ne peuvent stopper le phénomène, elles peuvent juste en atténuer et endiguer les effets. Ainsi, une collaboration renforcée entre les différents acteurs et engagés doit être privilégiée.
Cet entretien confirme certaines de nos hypothèses, notamment sur l’ampleur du phénomène et l’efficacité des solutions mises en place. Cependant, il nous apporte un nouvel éclairage : la priorité n’est pas seulement technique ou financière, elle est aussi pédagogique et participative. Et ce volet, qui n’est pas très mis en avant, peut être très efficace.
c. M. GALECTRICIEN, Responsable des services techniques de la commune de Locmaria-Plouzané
Lors de cet entretien, M. GALECTRICIEN nous a renseigné sur les problématiques d’érosion rencontrées sur la commune de Locmaria-Plouzané. Deux principaux projets ont été menés : un premier projet portant sur l’érosion des dunes et un second sur l’enrochement d’une zone supportant une route.
La lutte contre l’érosion d’une dune est à l’initiative d’un citoyen, ancien chercheur, qui a signalé le problème et proposé une solution. Elle a été mise en place après l’accord de la DDTM et semble fonctionner. La solution choisie est le renforcement d’un cordon dunaire, avec une protection de la zone afin d’éviter le piétinement, ainsi que la végétalisation de la dune.
Le second projet a été mis en place car une route côtière était sur le point de s’effondrer à cause de l’érosion. Un enrochement a été choisi dans cette situation car une installation résistante à l’érosion et à la charge était indispensable. L’enrochement, mis en place il y a 3 ans, a permis de combler le trou creusé par la mer, et aucune conséquence liée à cette infrastructure n’est à déplorer. Elle est donc adaptée au lieu et à la situation.
- GALECTRICIEN a appuyé sur le fait que ces solutions n’étaient que temporaires, puisqu’il n’existe aucune solution viable pour lutter contre l’érosion, il faut seulement laisser la nature faire. Ces installations permettent uniquement de gagner du temps et de ralentir l’érosion, mais à terme, les zones côtières disparaîtront.
Cet entretien met en lumière l’impossibilité de lutter contre ce phénomène, et ce, malgré l’adoption de politiques d’aménagement et de gestion durable. De plus, il identifie les riverains comme des acteurs à part entière, qui peuvent, eux aussi, être à l’initiative de projets et d’actions sur l’érosion côtière.
d. Passants Treffiagat
Pour compléter notre enquête, nous avons échangé avec plusieurs habitants de Tréffiagat, commune du Finistère particulièrement exposée à l’érosion du trait de côte. Depuis le début de l’année, sept maisons sont en cours de rachat par la communauté de communes en vue de leur destruction. Ces terrains sont classés comme sujets à la submersion et non à l’érosion, distinction importante : selon les habitants, d’autres maisons du quartier, menacées par l’érosion, ne seront pas concernées par les rachats. Certains propriétaires risquent donc de devoir quitter leur logement sans indemnisation.
L’objectif de ces entretiens était de recueillir les observations et ressentis des habitants face aux changements visibles du littoral et aux risques pour leur cadre de vie. Ces témoignages offrent un éclairage concret sur la perception locale de l’érosion et complètent les données techniques par des récits de terrain.
Carte Google Maps – Tréffiagat
Gérard
Gérard est né à Tréffiagat et y est revenu dans les années 1980 pour sa retraite. Il se souvient qu’à sa naissance, la mer se trouvait à cent mètres plus loin qu’aujourd’hui. Depuis, même la dune et le lac ont reculé. Selon lui, les différents dispositifs de protection mis en place, comme les brise-lames en bois, n’ont eu aucun effet. “Tout a été essayé, rien ne fonctionne”, résume-t-il.
Il évoque également la relation entre les habitants et la mairie, qu’il juge prudente, voire un peu passive : “Ils font le dos rond.” La municipalité avait annoncé la future démolition de certaines maisons il y a déjà une dizaine d’années, et même si la question reste une préoccupation locale importante, peu de progrès concrets lui semblent avoir été réalisés.
Il souligne que le sujet de l’érosion n’est réellement discuté que depuis une vingtaine d’années, alors que les habitations aujourd’hui menacées sont relativement récentes. Concernant les permis de destruction, il parle d’un “déchirement” pour les propriétaires, un moment chargé d’émotion et difficile à accepter. Son discours reste marqué par une forme de fatalisme : selon lui, aucune solution, pas même naturelle, ne semble capable d’enrayer le phénomène.
Permis de démolir – Tréffiagat
Aline
Aline a acheté sa maison à Treffiagat en 1987. Celle-ci avait été construite à l’origine vers 1870 par des pêcheurs. Elle se souvient qu’à son arrivée, il n’y avait pas encore de dune devant les habitations. Pour autant, les aménagements étaient plus nombreux : un chemin permettait d’accéder au lac.
Elle évoque certaines inégalités dans la gestion des permis de construire : selon elle, des habitants situés plus à l’arrière ont construit alors qu’elle-même n’y a pas été autorisée, estimant que certaines constructions récentes se sont faites “dans l’illégalité”.
D’après Aline, l’urbanisation s’est faite “un peu n’importe comment”. Elle remarque toutefois que les maisons du XIXe siècle, construites sur la roche, semblent mieux protégées face à l’érosion, ce qu’elle trouve surprenant.
Deux habitations, des résidences secondaires, ont déjà été détruites, et deux autres doivent l’être prochainement, cette fois des résidences principales appartenant à des personnes âgées de 85 et 92 ans, ce qui rend la situation particulièrement difficile. En complément, Aline évoque le cas des deux maisons déjà détruites. Les propriétaires ayant acheté des maisons autour de 400 000 €, on pu les revendre à la communauté de communes aux alentours de 350 000 €, preuve selon elle d’une perte de valeur et d’un marché instable.
Enrochement plage – Tréffiagat
Thierry
Thierry a acheté sa maison à Treffiagat il y a trois ans. Sa propriété est directement concernée par l’érosion du trait de côte, et la partie basse de son terrain est inondable. Il explique qu’il n’avait pas été informé de la situation au moment de l’achat : le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) est sorti en juillet, alors qu’il avait signé l’acte en mai, auprès d’un notaire qui ne l’avait pas averti des risques liés à l’érosion.
Grâce à lui, nous apprenons que la mairie ne joue qu’un rôle limité dans la gestion du problème, désormais prise en charge par la communauté de communes. Il participe à des réunions de “collectifs” d’habitants, initialement réservées aux quinze maisons directement menacées, mais auxquelles participent désormais aussi des riverains plus éloignés, inquiets de la progression du phénomène. Il juge cependant ces réunions peu claires : les échanges sont très techniques et manquent de pédagogie. Les habitants, dit-il, ont surtout eu l’impression d’être mis devant le fait accompli, les premières décisions ayant été prises “en douce”. Il reconnaît toutefois qu’aujourd’hui, la communication est un peu plus transparente.
Thierry décrit les différents aménagements réalisés le long du littoral : à l’ouest, un enrochement en granit datant d’une trentaine d’années, mis en place progressivement jusqu’à la limite du sable ; à l’est, un enrochement “provisoire” posé directement sur le sable, qui n’a tenu que trois mois. La communauté de communes refuse désormais de poursuivre les enrochements, préférant “laisser faire la mer” et envisage même de retirer certaines protections existantes.
Un projet de digue est prévu à l’est et à l’ouest, pour un coût estimé à 55 millions d’euros, mais il ne protégera pas les quinze maisons les plus exposées. Les autorités prévoient d’acheter les sept maisons vouées à la destruction pour un montant global de trois millions d’euros, celles-ci étant assurées pour le risque de submersion. Thierry, dont la maison n’entre pas dans ce cadre, ne bénéficiera d’aucune indemnisation. Il se dit inquiet, désarmé et abandonné face à la situation.
Conclusion
Ces témoignages montrent à quel point les habitants de Tréffiagat vivent différemment la question de l’érosion, mais partagent le même sentiment d’injustice et d’impuissance. Entre décisions administratives floues, manque d’information et solutions limitées, beaucoup se sentent livrés à eux-mêmes face à l’avancée de la mer. Le phénomène, longtemps abstrait, touche désormais leur quotidien et remet en cause la stabilité même de leur lieu de vie.
D. Conclusion partielle
Les entretiens menés avec les acteurs institutionnels et locaux confirment que l’érosion côtière dépasse largement la simple question physique du recul du trait de côte. Elle s’impose comme un enjeu sociétal global, reconnu par tous, mais traité de manière encore fragmentée.
Hypothèse 1
L’érosion est perçue comme un phénomène mondial, mais sa gestion reste locale.
Mme GRANITE (DDTM) souligne que le phénomène excède le cadre communal, tandis que les témoignages des riverains de Treffiagat rappellent qu’il touche directement la vie quotidienne des habitants. Ce constat valide l’hypothèse 1 : l’érosion est bien considérée comme un enjeu global, mais les réponses demeurent dispersées, dépendantes des moyens et priorités de chaque territoire. Ce décalage d’échelle fragilise la cohérence d’ensemble des politiques mises en œuvre.
Les solutions techniques observées (enrochements, renforcement des dunes, protection des routes menacées) illustrent les efforts déployés pour limiter les effets de l’érosion.
Hypothèse 2
L’efficacité limitée des politiques de lutte contre l’érosion tient moins à la nature des solutions techniques qu’à un manque d’information et de coordination entre acteurs.
- GALECTRICIEN rappelle que ces mesures ne font que « gagner du temps ». Les habitants partagent ce constat d’inefficacité, souvent associé à un manque d’explication sur les choix réalisés. Les communes agissent fréquemment isolément, sans vision commune, et les habitants se sentent rarement pleinement associés aux décisions. Ainsi, cette hypothèse est confirmée : le problème est moins technique que organisationnel. La communication, la transparence et la gouvernance partagée apparaissent comme des conditions essentielles d’une réponse durable.
Concernant le rôle du changement climatique, les entretiens ont mis en évidence des perceptions divergentes.
Hypothèse 4
Le débat scientifique autour du lien entre changement climatique et érosion complexifie la prise de décision publique.
Si plusieurs interlocuteurs évoquent une aggravation visible du phénomène, aucun ne s’aventure à en attribuer la cause directe au réchauffement climatique. Les travaux de Duperret (2022) rappellent d’ailleurs qu’il n’existe pas encore de consensus scientifique sur ce lien. Cette incertitude alimente une tension : la population perçoit une urgence alors que les institutions, faute de certitudes, restent prudentes. La prise de décision publique se trouve ainsi fragilisée, faute de socle scientifique unanimement reconnu.
Au fil des échanges, un constat revient : la sensibilisation et la participation citoyenne sont perçues comme des leviers incontournables.
Hypothèse 3
L’implication des habitants et des acteurs locaux constitue un levier décisif pour une gestion durable et acceptée du littoral.
Les initiatives comme CoastApp illustrent ce potentiel. Elles montrent que lorsque les citoyens participent à l’observation et à la collecte de données, ils s’approprient davantage les enjeux et soutiennent les politiques locales. Pourtant, ces démarches restent marginales et sous-valorisées, faute d’un accompagnement institutionnel fort. L’hypothèse 3 est donc pleinement confirmée : la réussite de la gestion côtière passe par la construction d’une culture commune du risque et une implication active des populations.
Ces constats conduisent à redéfinir la question initiale. Ce travail n’a pas seulement révélé la gravité du phénomène d’érosion, mais surtout les limites des réponses actuelles et la nécessité de repenser notre rapport au littoral. La question centrale devient alors : comment informer, coordonner et mobiliser les parties prenantes autour d’une gestion durable du trait de côte ?
La désurbanisation progressive des zones les plus vulnérables, souvent évoquée comme la seule solution réellement efficace, ne pourra être envisagée qu’à travers une acceptation sociale construite collectivement.
En définitive, l’ensemble des hypothèses converge vers une même idée : la lutte contre l’érosion n’est pas qu’une affaire de géologie ou d’ingénierie, mais avant tout de gouvernance collective et de transformation culturelle. Le littoral ne se protège pas contre la mer, il apprend à vivre avec elle, par la connaissance, la coopération et la responsabilité partagée.
II. Persona
Nous avons cherché à répondre à cette problématique en élaborant trois profils types d’habitants. Cette démarche vise à traduire et synthétiser les données recueillies lors de la préparation de l’état de l’art, mais surtout au cours du travail de terrain. Ces profils d’utilisateurs, ou personas, permettent de représenter de manière concrète les différentes situations, perceptions et attitudes face à l’érosion du trait de côte. Nous présentons ainsi : Blanche GRANITE, Pierre RIVEROCH et Océane SOUD-UNE.
https://www.canva.com/design/DAG0jR8hWyk/09HQzMbzIX6PZUyarER9WQ/edit
MAKER LENS – Synthèse de l’enquête terrain et personas
Auteurs : Bérénice CARDOSO-FAUCHER, Pol TYMEN, Lucas REIS OLIVER, Divine BANON, Alex PEIRANO et Marc DUBOC — Contact : berenice.cardoso-faucher@imt-atlantique.net
PARTIE 1 : Synthèse de l’enquête terrain
1. Problématique et hypothèses
Problématique
Comment accompagner les médiateurs du low-tech dans leur mission de sensibilisation à l’approche frugale ?
Après notre premier article consacré à l’état de l’art, nous avions d’abord orienté notre réflexion vers les freins d’image et de diffusion du low-tech auprès du grand public.
Mais au fil de nos entretiens et de nos recherches, une autre réalité est apparue : ce ne sont pas seulement les utilisateurs finaux qu’il faut comprendre, mais surtout celles et ceux qui leur transmettent la démarche. Ce constat nous a conduits à reformuler notre problématique autour des médiateurs du low-tech (fab managers, enseignants, associations) dont le rôle s’avère essentiel pour rendre l’approche frugale accessible, concrète et désirable.
Hypothèses de travail
Nos deux hypothèses initiales :
- H1. L’image de la low-tech freine l’adhésion (associée à un univers militant / “retour en arrière”).
- H2. Les ressources existent mais manquent d’attractivité, de clarté et de contextualisation pour des publics variés.
Hypothèses formulées après un certain nombre d’entretien :
- H3. Les médiateurs peinent à adapter ateliers et supports à l’hétérogénéité des publics (âges, prérequis, équipements).
- H4. L’apprentissage low-tech prend du temps et nécessite une pratique guidée (paliers, retours d’expérience, essais-erreurs).
2. Cartographie des parties prenantes
Nos entretiens confirment la richesse de l’écosystème low-tech et la complémentarité des acteurs. Cette cartographie distingue clairement les médiateurs, cœur de notre recherche, des publics sensibilisés et des structures de soutien.
| Type de partie prenante | Rôle | Besoins identifiés | Exemples rencontrés |
| Médiateurs (cible directe) | Transmettre, animer, adapter la démarche low-tech | Ressources simples et visuelles, gain de temps, niveaux de difficulté, sécurité | Fab Managers (Claire Morvan), enseignants (Pierre Lemoal), associations (Petits Débrouillards) |
| Publics sensibilisés (impact indirect) | Apprendre, réparer, fabriquer | Tutoriels accessibles, projets courts, estimation honnête (temps/coût/outils) | Étudiants, cadres, débutants et “initiés”
Non rencontrés : des employés, ouvriers, des familles, des personnes agées etc |
| Structures d’appui | Héberger, financer, coordonner, valoriser | Mesure d’impact, mutualisation, passerelles pédagogiques | IMT, UBO, incubateurs, collectivités |
| Communautés & wikis | Documenter, partager, fiabiliser | Interfaces intuitives, données comparables, contributions guidées | Low-Tech Lab Brest, UBO Open Factory, wikis (comme lowtechlab.org) |
3. Méthodologie
Entre le 13/09 et le 15/10/2025, nous avons conduit 10 entretiens (présentiel / visio / téléphone), dont deux lors de portes ouvertes, avec des profils variés (fablab, enseignement, association, incubation, recherche). Afin de respecter les positions des personnes interrogées, la liste est anonymisée. Les verbatims sont eux retranscrits le plus fidèlement possible (sans reformulation).
Les acteurs surlignés en bleu sont ceux dont les entretiens ont été les plus significatifs, leur verbatims sont donc détaillés dans la partie suivante.
Tableau récapitulatif des interviews
| Les acteurs | Leurs métier |
| Claire Morvan | Responsable FabLab et médiation scientifique à l’IMT |
| Luc Morel | Permanent des petits débrouillards |
| Hélène Garin | Directrice des « Petits Débrouillards » |
| Pierre Lemoal | Enseignant de Technologie et Philosophie au Collège François Collobert (près de Châteaulin) |
| Sabine Corlay | Chargée enseignements Innovation & Entrepreneuriat |
| Julie Aubry | Coopération territorial, Low Tech et nouveaux imaginaires (Low Tech Lab) |
| Emmanuel Dubreuil | Responsable Incubateur & développement de projets (Fondation Explore), ancien président du Low-Tech Lab |
| Thomas Rivière | Membre du Low Tech Lab de Brest |
| Antoine Séveno | Fondateur Electrobox |
| Tom Le Bihan et Gwen Martin | Docteurs à l’UBO Open Factory |
4. Entretiens détaillés (profils clés)
a. Claire Morvan (Responsable FabLab et médiation scientifique à l’IMT)
Contexte
Responsable du FabLab de l’IMT Atlantique, Claire Morvan anime des activités de médiation scientifique autour des sciences participatives et notamment du low-tech. Son approche croise expérimentation technique et pédagogie : ateliers, inter semestres, projets étudiants, ceux-ci étant parfois en partenariat avec le Low-Tech Lab.
1. Sa vision du low-tech
Pour elle, le low-tech se rapproche davantage du right-tech :
“développer une technologie pour répondre à un besoin réel, en open source, mutualisée, documentée en ligne, avec du matériel local et assemblable dans n’importe quel fablab”
Cette définition insiste sur la sobriété raisonnée : la justesse technique plutôt que la simplicité absolue.
2. Activités menées
Les ateliers proposés reflètent cette philosophie :
- Fabrication de marmite norvégienne
- Conception de séchoir solaire
- Travaux intersemestre (avec le Low-Tech Lab) : test de la fiabilité et du rendement de différents isolants, comparaison de performances
Ces formats combinent manipulation et évaluation : expérimenter, mesurer, puis documenter.
3. Freins identifiés
Plusieurs limites concrètes ressortent :
- Les participants doivent financer les consommables, freinant la participation
- L’image de la low-tech reste marquée par un côté « bricolo du dimanche » ou « bobo écolo », qui nuit à sa crédibilité scientifique
- La documentation manque de rigueur. Beaucoup expérimentent avec les moyens dont ils disposent et partagent ensuite en ligne, sans que l’on sache réellement comment l’objet vieillit ni quelles sont ses performances. En somme, il existe peu de protocoles permettant de comparer les matériaux ou la durabilité des objets fabriqués.
4. Pistes d’amélioration
Claire Morvan propose la création d’une grille low-tech standardisée : une fiche d’évaluation pour chaque objet low-tech, reposant sur des paramètres mesurables (durabilité, efficacité, réparabilité…).
Cette approche rapprocherait la pratique artisanale du low-tech d’une documentation scientifique et professionnelle, tout en maintenant ses valeurs : utilité, accessibilité, durabilité.
5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses
| Hypothèse | Observation | Validation |
| H1 : l’image de la low-tech est un frein | L’aspect “bricolo du dimanche / bobo écolo” altère la crédibilité auprès d’un public non initié. | Validée |
| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Manque de documentation précise, comparée, mesurable → absence de protocole commun. | Validée et précisée |
| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Les ateliers doivent concilier ingénieurs, novices, étudiants → adaptation constante. | Validée |
| H4 : apprentissage long / progressif | La montée en compétence nécessite du temps et de la pratique mais moins que la high-tech. | Partiellement validée |
b. Pierre Lemoel (Enseignant de Technologie et Philosophie dans un collège du finistère)
Contexte
Pierre Lemoel enseigne la technologie dans un collège du Finistère, non loin de Châteaulin, avec un profil atypique : il est à la fois professeur de philosophie et de technologie. Son approche combine ainsi réflexion critique sur le progrès technologique et expérimentation concrète autour de la réparabilité et du recyclage.
1. La place du low-tech dans l’enseignement
La low-tech ou démarche sobre / frugale n’occupe qu’une petite partie du programme officiel, principalement dans les séquences sur l’obsolescence programmée et les cycles de vie des produits. A son échelle, ses cours visent à interroger les besoins réels et à amener les élèves à distinguer innovation utile et complexité superflue. “A-t-on vraiment besoin de maisons automatisées ?”. Ce type de réflexion permet également de développer l’esprit critique des élèves.
2. Pédagogie et activités mises en place
Faute de temps et de cadre programmatique dédié, Pierre Lemoel s’appuie sur des outils concrets pour rendre la démarche tangible. Il utilise notamment des robots pédagogiques pour enseigner la réparabilité et stimuler la curiosité technique des élèves.
Les “convaincus” poursuivent souvent déjà ce type de projets chez eux, tandis que les “non-convaincus” se prennent au jeu lorsqu’un résultat concret émerge.
In fine, ces ateliers “à résultat visible” permettent d’accrocher un public plus large, au-delà des élèves déjà sensibles à l’électronique ou aux problématiques environnementales.
3. Freins observés
Selon Pierre, les freins sont principalement culturels/contextuels et générationnels.
- Les élèves, “nés avec la high-tech”, baignent dans le tout-numérique et peinent à percevoir l’intérêt de la sobriété technologique.
- Il observe aussi une différence sociale : les jeunes hyper-connectés semblent moins réceptifs à la démarche low-tech, tandis que ceux issus de milieux moins technophiles y voient un espace d’expérimentation concret.
En somme, la low-tech reste marginale au collège, faute d’un temps suffisant dans les programmes et d’une visibilité institutionnelle.
4. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses
| Hypothèse | Observation | Validation |
| H1 : l’image de la low-tech est un frein | Frein lié au contexte socio-technique : les jeunes hyper-connectés associent le progrès à la high-tech. | Validée (reformulée en frein social ET générationnel) |
| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Sujet peu traité dans les programmes ; faible diffusion scolaire. | Partiellement validée |
| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Les activités concrètes (robots, objets réparables) attirent les élèves non convaincus. | Validée / précisée |
| H4 : apprentissage long | Non abordée. | NA |
Conclusion
L’entretien avec Pierre Lemoel montre que la pédagogie low-tech peut s’intégrer à l’enseignement secondaire à condition d’être ancrée dans le concret. Les élèves ne rejettent pas l’idée de sobriété, mais ils ont besoin de voir un résultat immédiat pour s’y intéresser. Dans un système éducatif encore centré sur la performance numérique (et technique ?), rendre visible l’utilité du simple devient un véritable levier de médiation.
c. Emmanuel Dubreuil
Contexte
Responsable incubateur et développement de projet au sein de la Fondation Explore[1], Emmanuel Dubreuil. œuvre à la croisée de l’innovation, de la pédagogie et de la réindustrialisation locale. Ancien président du Low-Tech Lab, il a contribué à l’élaboration d’une bibliothèque numérique recensant les enquêtes du Lab, consultable sur le site officiel (Low-Tech Lab – Les actualités sur les Low-tech ou basses technologies)[2]. Il a également participé au lancement du programme Communauté du Low-Tech Lab[3], dont l’objectif est de mutualiser les ressources, compétences et initiatives du réseau.
1. Le low-tech : une philosophie avant d’être une technique
Pour Emmanuel, la technique n’est qu’une composante d’une réflexion bien plus large. La low-tech, explique-t-il, s’attache aujourd’hui autant à la sociologie et au design de la démarche qu’à l’aspect purement mécanique ou matériel. Il cite la publication Low-Tech Principles d’Audrey Tanguy et Valérie Laforest comme référence : une approche qui met en avant les dimensions humaines, sociales et culturelles du mouvement.[4] La low-tech ne se limite pas à “faire simple”, mais à “faire juste”, à replacer la technique au service du vivant et de la société.
2. Actions et leviers de démocratisation
Pour vulgariser les connaissances techniques et rendre la démarche accessible, le Low-Tech Lab agit à travers plusieurs leviers :
- Ateliers de réparation (ex. : mobylettes, vélos, cuisine) permettant de pratiquer et d’apprendre en groupe. Parfois, un changement de sémantique pour adapter le discours aux différents publics est nécessaire.
- Tiers-lieux comme les fablabs, espaces de formation et d’expérimentation ;
- Matériel open-source hardware, garantissant la transparence et la reproductibilité ;
- Forum low-tech, pour relier initiatives, projets et retours d’expérience.
(Cette approche mêle pratique et transmission : elle abaisse les barrières techniques tout en favorisant une culture commune de la sobriété.)
3. Problématiques et enjeux actuels
Deux grands défis ressortent de son témoignage :
- Réindustrialisation et formation : la France manque de techniciens qualifiés. Il faut remettre la technique au cœur de l’éducation, valoriser les savoir-faire manuels comme la soudure, la maintenance ou la réparation.
- Diffusion et standardisation de la connaissance : la documentation low-tech est encore trop éparse. Emmanuel insiste sur la nécessité de créer des standards de documentation pour faciliter la recherche et la transmission d’informations fiables.
4. Freins identifiés
Deux obstacles majeurs ressortent :
- Les politiques publiques, souvent déconnectées des réalités de terrain, notamment dans la réforme des filières techniques et professionnelles.
- La méconnaissance du corps enseignant technique sur la question de la réindustrialisation et des besoins concrets en compétences manuelles.
5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses
| Hypothèse | Observation | Validation |
| H1 : l’image de la low-tech est un frein | La perception “retour en arrière” persiste, freinée par les logiques institutionnelles et politiques. | Validée |
| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Documentation éparse, besoin de standards pour rendre la connaissance accessible et fiable. | Validée / précisée |
| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Nécessité de changer de vocabulaire selon les audiences et de créer des lieux d’expérimentation. | Validée |
| H4 : apprentissage long / progressif | La montée en compétence nécessite des lieux de pratique et de partage (tiers-lieux, ateliers). | Validée |
Conclusion
L’entretien avec Emmanuel Dubreuil. replace la low-tech dans une dynamique à la fois philosophique et industrielle. Au-delà de la fabrication d’objets, il s’agit de refaire société autour de la technique : redonner sens au geste, structurer la transmission, et créer des outils de documentation communs. Sa vision montre que l’avenir du low-tech ne repose pas seulement sur l’invention, mais sur la formation, la mesure et la mutualisation.
d. Thomas Rivière
Contexte
La rencontre avec Thomas Rivière, membre actif du Low-Tech Lab Brest, s’est déroulée lors de la journée portes ouvertes du 27 septembre 2025. L’objectif était de découvrir les activités de l’association, ses projets et sa démarche autour des technologies sobres et accessibles, ainsi que d’identifier des pistes pour un futur projet étudiant intégrant une dimension low-tech et connectée.
1. Présentation du Low-Tech Lab
L’association rassemble une communauté de profils variés : principalement des passionnés de bricolage et des personnes intéressées par la démarche low-tech. Elle fonctionne essentiellement grâce à des bénévoles, qui assurent les permanences et animent les ateliers. Chaque année, les membres définissent collectivement les projets à réaliser. Le Lab met également à disposition des machines et propose des ateliers d’initiation pour apprendre à les utiliser.
2. Réalisations observées
Les prototypes présentés lors de la visite illustrent la diversité et la concrétisation du low-tech :
- Séchoir solaire : permet de sécher les aliments grâce à l’énergie solaire ;
- Éoliennes : une petite, capable de recharger un téléphone et une plus grande, alimentant des batteries ;
- Fours solaires : plusieurs modèles atteignant des températures élevées ;
- Marmite norvégienne : dispositif de cuisson lente, économe en énergie ;
- Douche économe : réduit la consommation d’eau.
Ces objets incarnent la philosophie du Lab : des solutions réalisables à la maison, sobres, reproductibles et ouvertes.
3. Vers des projets low-tech connectés
L’équipe du Lab a également partagé plusieurs idées de projets pouvant intégrer une dimension numérique. Deux projets phares ont été présentés :
- Hébergement solaire du site web : le site serait hébergé sur une carte électronique photovoltaïque, alimentée par batterie. Il ne serait accessible que lorsque la charge énergétique le permet, incarnant ainsi la dépendance directe à l’environnement.
- Capteurs pour la documentation collaborative : conception d’objets connectés intégrables aux prototypes (low-tech) afin de mesurer leurs performances (température, rendement, efficacité énergétique). Les données seraient alors publiées sur un site commun et chaque contributeur disposerait d’un accès pour ajouter ses résultats, permettant ainsi de comparer plusieurs versions d’un même objet (marmite norvégienne, four solaire, douche économe, etc.). Cette logique vise à professionnaliser et fiabiliser la documentation des réalisations low-tech.
4. Ressources et accompagnement
Le Lab met à disposition un wiki très complet [5], recensant les projets documentés.
Les particuliers ou étudiants peuvent :
- Reproduire des objets au sein du fablab avec l’aide des bénévoles ;
- Contacter l’association (bonjour@lowtechlabbrest.org) pour être intégrés au serveur Discord et échanger directement avec la communauté.
5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses
| Hypothèse | Observation | Validation |
| H1 : l’image de la low-tech est un frein | L’association attire surtout des passionnés ; la démarche peut paraître “niche” ou réservée aux initiés. | Validée / nuancée |
| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Documentation riche mais exigeante, le wiki suppose déjà des compétences de base. | Validée |
| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Les ateliers nécessitent un accompagnement selon le niveau des participants | Validée |
| H4 : apprentissage long / progressif | Les participants apprennent par essais-erreurs → la montée en compétence requiert du temps et de la pratique. | Validée |
Conclusion
Cette immersion au Low-Tech Lab Brest révèle la vitalité d’une communauté expérimentale, où la sobriété technologique s’enrichit d’une culture du partage. Entre bricolage collaboratif et documentation numérique, le Lab démontre que la low-tech n’est pas un retour en arrière, mais un espace d’innovation ouverte. Son principal défi : rendre ces savoirs accessibles à des publics plus variés, sans perdre la rigueur et l’esprit collectif qui font sa force.
e. Tom Le Bihan et Gwen Martin
Contexte
Tom Le Bihan (docteur en biophysique) et Gwen Martin (docteur en hyperfréquence) sont aujourd’hui fab managers et chercheurs au sein de l’UBO Open Factory, laboratoire d’innovation et fablab universitaire de Brest. Ils ont tous deux fait leur thèse à l’UBO. Leur structure accueille des publics très divers : étudiants, enseignants-chercheurs, entrepreneurs et particuliers. L’Open Factory constitue ainsi un espace-pont entre innovation technique, intelligence collective et formation à la créativité. Elle soutient des projets extrêmement variés : de la découpe laser pour les prototypes à la gestion de projets internationaux d’innovation. Pour cela, leur FabLab pratique et forme à la méthode du “double diamant”, qui permet d’apprendre à reformuler un besoin avant de concevoir la solution.
2. Leur vision de la low-tech
Même si l’Open Factory n’est pas, à proprement parler, un fablab low-tech, Tom et Gwen partagent une sensibilité forte pour la sobriété de conception. Gwen cite Antoine de Saint-Exupéry : « La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. »[6]
Pour eux, la low-tech consiste à simplifier intelligemment, à revenir à l’essentiel des fonctions, et à favoriser une vision systémique :
« Dans la high-tech, chaque partie d’un projet est développée par des spécialistes différents ; la low-tech permet à une seule personne de concevoir l’objet de A à Z. »
Cette autonomie technique rend la démarche à la fois plus concrète et plus formatrice.
3. Atouts et freins, et leviers de démocratisation
- Atouts : visibilité immédiate du produit fini, compréhension globale du processus de fabrication, sentiment d’autonomie.
- Freins : résistance au changement et vision de “retour en arrière” avec la low-tech, doublées d’une inertie structurelle dans une économie tournée vers le high-tech.
Pour démocratiser la démarche low-tech, les deux chercheurs considèrent les fablabs comme des leviers essentiels :
- formation à la gestion de projet avec un fort accent sur la créativité et l’idéation (méthode du double diamant),
- modules de formation low-tech (en cours de développement) ouverts à tout public : étudiants, entrepreneurs ou citoyens,
- accompagnement des porteurs de projets sobres, qu’ils soient scientifiques ou professionnels.
4. Applications et projets évoqués
Leur champ d’action dépasse la sphère académique. Gwen travaille par exemple avec des éleveurs laitiers sur des dispositifs de traite low-tech :
- simplification du matériel sous contrainte de normes,
- adaptation des équipements pour permettre la réparation et la maintenance locale,
- réflexion sur les modes de production : passage à une monotraite, réduction du soja importé, baisse des coûts et du temps de travail.
Ces projets témoignent d’une application directe de la frugalité technique dans des secteurs professionnels contraints. Gwen souligne un enjeu clé : la conformité aux normes industrielles. Les objets low-tech restent soumis aux mêmes réglementations que leurs équivalents conventionnels, mais leur simplicité permet paradoxalement de réduire le nombre de normes applicables. Par exemple, si un dispositif traditionnel intègre de l’électricité et doit respecter les normes électriques, sa version low-tech simplifiée, conçue sans électricité, échappera naturellement à ces contraintes normatives. Cette simplification facilite également la maintenance locale : chaque chef d’entreprise peut assumer la responsabilité des réparations effectuées sur son matériel, la low-tech impliquant ici un retour à la maîtrise de l’outil.
5. Synthèse – Lecture par rapport aux hypothèses
| Hypothèse | Observation | Validation |
| H1 : l’image de la low-tech est un frein | La low-tech est souvent perçue comme un “retour en arrière” : la résistance culturelle demeure forte. | Validée |
| H2 : ressources peu adaptées / peu attractives | Peu abordée ; non pertinente ici (focus sur perception et formation). | NA |
| H3 : difficulté d’adapter aux publics | Nuancée : création de modules de formation ouverts à tous ; adaptation déjà en cours. | Précisée |
| H4 : apprentissage long ? | Validée : l’apprentissage est certes long, mais se concrétise rapidement en réalisations tangibles. | Précisée / Validée |
Conclusion
L’entretien avec Tom Le Bihan et Gwen Martin illustre une vision ouverte et systémique de la low-tech. En redonnant à chaque individu la capacité de concevoir et de réparer, ces fab managers montrent que la simplicité peut devenir un levier d’innovation. Leur démarche, à la croisée de la formation et de la recherche, souligne une conviction : la low-tech n’est pas un retour en arrière, mais un retour au sens.
5. Conclusion partielle – Enseignements de l’enquête terrain
L’ensemble des entretiens menés permet de confirmer que la diffusion du low-tech n’est pas freinée par un manque total d’intérêt, mais par un intérêt fragile et inégalement réparti, qui se heurte à des freins structurels et culturels, qu’ils soient économiques, sociaux ou techniques. Ce constat rejoint celui établi dans notre état de l’art : la démarche low-tech attire, mais reste encore difficile à s’approprier.
Les médiateurs interrogés, enseignants, fab managers, chercheurs, convergent vers un même constat : la démarche low-tech reste perçue comme exigeante tant sur le plan du temps que des compétences. Elle souffre d’une documentation morcelée, dont la qualité et la profondeur varient d’un projet à l’autre ; les tutoriels disponibles sont parfois trop sommaires, parfois trop techniques, et rarement pensés pour être réutilisés ou comparés. Cette hétérogénéité limite sa diffusion auprès d’un public non initié.
Sur le plan analytique :
- H1 est validée : l’image de la low-tech, associée au “bricolage du dimanche”, freine son appropriation.
- H2 est confirmée : la documentation existe, mais elle est trop éparse et parfois trop technique pour les novices, ou au contraire trop simplifiée pour les plus expérimentés. Elle reste donc mal adaptée à la diversité des profils.
- H3 est partiellement validée : l’adaptation aux publics reste difficile, même si des lieux comme l’UBO Open Factory, le Low-Tech Lab de Brest ou certains enseignants parviennent à la rendre plus accessible.
- H4 est nuancée : l’apprentissage prend du temps, mais la pratique directe et la réalisation complète d’un objet peuvent compenser cette lenteur par une compréhension plus solide. De plus, la pratique directe et la répétition font gagner en aisance, la simplicité venant avec l’habitude.
En somme, le problème ne réside pas dans le manque de ressources, mais dans la manière de les présenter et de les contextualiser. Les médiateurs ont besoin d’outils simples et souples, capables de trier, d’adapter et de mettre en valeur les savoirs existants.)
Ces constats nous ont conduits à faire évoluer notre solution initiale. Plutôt qu’une application de reconnaissance d’objets, notre projet se réoriente vers un site web collaboratif et modulaire, développé avec un client réel, permettant la génération automatique de tutoriels contextualisés.
Cette évolution répond directement aux besoins exprimés par les acteurs rencontrés : une documentation plus rigoureuse (Claire Morvan), des standards de partage (Emmanuel Dubreuil), une documentation collaborative (Thomas Rivière) et des formations ouvertes à tous (Tom Le Bihan & Gwen Martin).
Cette conclusion partielle ouvre la voie à une conception plus centrée sur l’usage, là où la médiation devient la clé. Pour comprendre à qui s’adresse vraiment cette solution, nous avons ainsi cherché à incarner nos utilisateurs à travers trois profils types.
PARTIE 2 : Personas
Introduction
À partir des données recueillies lors de l’enquête terrain, nous avons identifié deux profils types incarnant les utilisateurs cibles de notre projet :
- les médiateurs, comme les Fab Managers, qui diffusent la démarche low-tech et cherchent à la fois à gagner du temps et à rendre leurs ateliers plus accessibles
- les novices curieux, désireux de se lancer dans des projets sobres mais freinés par le manque de confiance et/ou de ressources accessibles (souvent perdus face à une abondance de ressources peu hiérarchisées ou trop spécialisées)
- les enseignants, qui puisent dans la plateforme pour trouver des projets pédagogiques adaptables à leurs contraintes de classe et transmettre une culture technique low-tech à leurs élèves
Ces personas, construits à partir des entretiens et des observations, nous permettent d’incarner les besoins, les attentes et les contraintes de notre solution.
Les Personas
Conclusion finale – Vers une solution collaborative
L’enquête terrain et la construction des personas confirment que la clé de la diffusion du low-tech réside dans la médiation. Pour les fab managers et enseignants comme Aude et Ethan, ainsi que pour les débutants tels que Daniel, il ne s’agit pas seulement d’apprendre à fabriquer, mais de trouver les bons points d’entrée : des ressources fiables, attractives et contextualisées qui répondent aux besoins spécifiques de transmission, d’autonomisation ou d’inspiration pédagogique.
Le projet Maker Lens devient ainsi un site web intuitif et modulaire conçu pour :
- générer des tutoriels personnalisés selon le profil et le besoin des utilisateurs ;
- agréger et valoriser les ressources existantes issues des wikis et des fablabs ;
- favoriser la collaboration entre écoles, associations et communautés ;
- et rendre la documentation plus vivante, mesurable et partagée.
Cette orientation répond aux attentes exprimées sur le terrain : professionnaliser la documentation tout en conservant l’esprit frugal et ouvert du mouvement. Elle ouvre la voie à une phase de conception, en partenariat avec un client réel, afin de tester les parcours utilisateurs et valider la pertinence des fonctionnalités proposées.
En redonnant aux médiateurs les moyens d’agir et aux citoyens les moyens de comprendre, Maker Lens entend contribuer à la démocratisation d’une culture du “faire simple”, une culture à la fois technologique, pédagogique et humaine.
PARTIE 3 : Annexes
Acronymes
UBO : Université Bretagne Ouest
NA : non abordé.e.s
Bibliographie
- [1] Fondation Explore | fonds-explore.org
- [2] Low-Tech Lab, « Actualités / Blog », ? | lowtechlab.org
- [3] Low-Tech Lab, « Archipel des communautés low-tech » | lowtechlab.org
- [4] Audrey Tanguy, Valérie Laforest, Les frontières du Low-tech : principes-clés identifiés dans la littérature. [Rapport de recherche] PRC20.1 – L1.1, Mines Saint-Etienne. 2021, 21p. | hal.cnrs.fr
- [5] Low-Tech Lab, « Wiki » | lowtechlab.org
- [6] Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Editions Gallimard, février 1939.
F.O.C.U.S – Enquête terrain, données recueillies et Persona
ENQUETE TERRAIN, DONNEES RECUEILLIES ET PERSONA DU PROJET : F.O.C.U.S.
par LACOTTE Axel, GILLET Lucie, PETIT Gaëtan, Xiaoyu LIU et Gaspard CHEVALIER.
Dans le cadre de notre recherche de problématique, nous nous sommes dirigés vers le milieu professionnel et plus précisément au niveau de la concentration des personne faisant partie d’un groupe ayant un projet en commun
Rappel de la problématique : comment améliorer la motivation des salariés dans le cadre de projets collaboratifs ?
Hypothèses : suite à la redirection de notre projet, nos hypothèses ont évolué dans le même sens que notre nouvelle problématique suite à l’état de l’art. S’en est suivi des entretiens pour les vérifier.
Hypothèse 1 : L’environnement de travail est le facteur le plus important sur les performances du salarié;
Hypothèse 2 : Des salariés motivés par ce qu’ils font travaillent mieux
Hypothèse 3 : Afficher la progression augmente la motivation
Hypothèse 4: Le travail en équipe dans un espace de travail dédié permet d’être plus concentrée que le télétravail.
RECHERCHE DE TERRAIN :
Afin d’approfondir nos recherches, nous avons contacté diverses personnes, qui seront anonymisées dans cet article, afin d’orienter et de développer plus précisément nos pistes vers une problématique présente dans le milieu professionnel et de la concentration.
Dans un premier temps, nous avons rencontré en visioconférence : Christine, 60 ans, qui est manager dans une grande entreprise gérée par l’Etat.
Lors de l’interview de Christine, elle nous a parlé du passage durant le COVID-19 de multiples sociétés comme la sienne en télétravail. Ce qui est resté comme tel même après la pandémie, pour des questions de logistiques et de pratique.
Elle nous a fait remonté en particulier le côté “génération-dépendant”, en mettant en valeur le fait que l’implication au télétravail des employés dépend de la manière dont ils ont été habitués à travailler et s’ils sont facilement déconcentrés à la maison.
Grâce à cet entretien nous avons compris qu’après la pandémie, la manière de travailler des gens avait drastiquement changé. Menant à dans certains cas une baisse de motivation et d’implication de salariés, en particulier durant les travaux de groupe au vu de la baisse de gens travaillant présentiel. Ce qui nous a fait avancer à propos de notre problématique de l’impact d’un manque d’implication au sein d’un groupe de travail.
Dans un deuxième temps, nous avons rencontré : Poline, 22 ans, qui est formatrice au sein d’une petite association
Lors de l’interview de Poline, elle nous a parlé des formations qu’elle effectuait dans le cadre de son poste au sein d’une association. Nous lui avons demandé dans quelles situations les gens qui participaient à ses formations étaient plus ou moins concentrés.
Ce qui en ait ressorti principalement est que ce qui va principalement joué pour garder attentif un groupe de personne lors de grosses formations qui requiert d’être concentré est le fait qu’il ait choisi d’être présent ou non (formation obligatoire ≠ pas obligatoire), donc de la volonté des personnes.
Également est principalement remonté, la manière dont est construite la formation, si c’est actif ou passif. Les personnes ont tendance à vite lâcher lorsqu’ils ne sont pas stimulés par une formation active.
Grâce à cet entretien, nous avons compris que la manière d’amener les gens à être concentrés est d’abord de les stimuler et de les motiver en présentant une formation de manière ludique et entraînante. Ce qui nous a fait avancer à propos de notre problématique de l’importance d’une bonne adhérence à un projet lors d’un travail de groupe.
Dans un troisième temps, nous avons rencontré Alban, 40 ans, qui est enseignant-chercheur dans les risques psychosociaux au travail.
Lors de l’interview de d’Alban nous avons évoqué notre avancement sur notre recherche documentaire et notre parti pris pour améliorer la concentration en augmentant la motivation des équipes.
Alban nous apporte son aide car il a de l’expérience sur les sujets de motivation au travail et a une vision plus large de la culture d’entreprise et nous a permis de voir comment s’intègre notre projet dans la culture d’une entreprise.
Ce qui est ressorti principalement c’est qu’avec notre projet nous pouvons agir sur deux formes de motivations.
D’une part la motivation intrinsèque, en jouant sur l’idée de progression sur des tâches en temps réel on crée une forme de stimulation liée à la tâche (exemple du time-timer).
D’autre part on peut jouer sur la motivation extrinsèque :
- L’accomplissement de tâches permet de dépasser des jalons associés à des primes, des avantages des récompenses.
- La valorisation aux yeux des autres membres de l’équipe, le travail étant collaboratif, l’accomplissement des tâches bénéficie à tout le groupe. La visualisation de son impact au profit du groupe améliore l’intégration des employés.
Nous avons également discuté des limites de ce projet:
- La motivation est pluri-factorielle, notre outil ne peut pas agir sur les leviers principaux de motivation: le sens du projet global de l’équipe et la rémunération fixe.
- Notre outil va être intégré dans une entreprise ayant déjà sa culture propre. Bien que nous ayons pensé notre projet avec des récompenses et un système de valorisation des collaborateurs, il peut être détourné comme un outil de contraintes et de mise sous pression des collaborateurs.
Dans un quatrième temps, nous avons rencontré Michelle, 50 ans, qui est cheffe de projet dans l’aérospatial français. Pendant l’entretien, nous nous sommes intéressés au fonctionnement de ses équipes et à ses méthodes de gestion de projet.
Elle nous a révélé que dû à des contraintes des investisseurs (publics), de sécurité et d’échelle des projets, les projets sont gérés par cycles en V (réflexion totale en amont et validation des étapes).
Il existe une dynamique d’équipe au sein des différents services (ici : robotique et électronique) même si elle reconnaît que certains ingénieurs ont des difficultés à travailler en équipe efficacement. Elle pense que ces ingénieurs sont déjà motivés par ce qu’ils font mais que dans son cas, notre solution lui servirait plutôt à intégrer les travailleurs isolés dans l’équipe. Elle reste donc enthousiaste vis-à-vis de notre solution.
Dans un dernier temps, nous avons rencontré Orianne, 24 ans, qui est responsable d’un magasin drive d’une grande chaîne de magasins. Nous avons abordé sa relation avec ses équipes, leurs motivations et ce qu’elle pensait du travail d’équipe dans son entrepôt.
Ce qui est ressorti de cet entretien, c’est que dans son métier, ses équipes ne sont pas motivées par les tâches à faire. Ces tâches sont principalement de la manutention où un appareil au poignet indique à tout moment ce qu’il faut faire (transporter des articles d’un point A à un point B principalement). Pour elle, la seule motivation de ses équipes, c’est le salaire.
Nous pouvons aussi ajouter que les salariés sont supposés travailler en équipe, mais que c’est uniquement la machine au poignet qui crée du lien entre eux. Ce ne sont pas des individus qui travaillent en équipe par eux-mêmes et donc notre solution semble d’autant moins adaptée à cet environnement.
Ce que l’on peut retenir d’important dans ces différents entretiens menés:
L’arrivée du télétravail change la relation avec le reste de l’équipe et avec l’espace de travail. Le travail doit de plus en plus être effectué en autonomie. L’espace commun de travail ne disparaît pas mais on doit composer avec l’absence physique d’un certain nombre de collaborateurs. L’esprit d’équipe, le sens du collectif est plus difficile à créer dans ce contexte où il y a moins de présence physique.
Notre projet doit prendre en compte ces réalités, il doit permettre de mieux rendre compte de l’aspect collectif du travail, c’est également un repère stable dans l’espace de travail grâce à sa dimension matérielle.
Nous avons compris qu’il fallait laisser la possibilité de s’intéresser au sujet quand les personnes le désirent, selon leur propre chef et ne pas leur infliger une certaine pression lors d’un suivi de leur travail de trop près ou de les mettre en compétition.
PERSONAS
Nous avons décidé de créer 2 fiches personas, un employé et un chef de projet.
Concernant l’employé, nous avons conçu un personnage en quête d’excellence, responsable et sociable. Il aime le travail d’équipe et aspire à être reconnu pour son travail. Cependant, il a des difficultés à maintenir sa concentration dans l’open space. Carlos ne manque pas de motivation intrinsèque ; c’est plutôt l’environnement ou les outils de management qui ne parviennent pas à canaliser son énergie et à lui montrer l’impact de son travail.
Concernant le chef de projet, nous avons décidé de créer un personnage motivé, ambitieux et compassionnel. Dans le cadre de sa recherche de solution pour motiver son équipe autour d’un projet qui lui tient énormément à cœur : le projet d’une vie. Il sait que son équipe est compétente et enjouée concernant ce dernier, seulement, elle n’est pas très motivée et à du mal à trouver une bonne dynamique.
Breizh4line – Retour enquête terrain
I) De la salinisation à la consommation dans les foyers : déroulement de la recherche terrain et de notre pivot
- La salinisation, notre sujet de base
Notre réflexion s’est initialement portée sur la salinisation des eaux douces, un phénomène qui menace la qualité et la disponibilité de la ressource. Ce problème, directement lié aux activités humaines (pompages excessifs, urbanisation, pratiques agricoles) et accentué par le changement climatique (sécheresses, montée du niveau de la mer), représente un risque silencieux mais préoccupant pour l’approvisionnement en eau potable. Nous avons effectué une enquête terrain auprès de chercheurs, d’associations et d’entreprises. La plupart de nos contacts proviennent du réseau de l’école ou bien de connaissances. Nous avons également contacté via mails et téléphone les différents acteurs afin de convenir d’un rendez-vous, en présentiel ou en visioconférence.
Très vite, nos recherches et nos échanges avec différents acteurs nous ont amenés à élargir notre approche au-delà de la salinisation. C’est la question de la quantité et de la qualité des eaux douces dans leur ensemble (acidification, pollutions diffuses, contamination chimique ou organique) qui doivent être interrogées.
Notre problématique était : Comment limiter les effets de la salinisation des eaux douces en Bretagne ?
Nos hypothèses :
- Hypothèse 1 : Les activités humaines (pompages excessifs, urbanisation, agriculture intensive) accélèrent la salinisation des nappes côtières et la dégradation de la qualité de l’eau douce
- Hypothèse 2 : La Bretagne, du fait de sa dépendance à l’eau de surface (80 %), est plus vulnérable que d’autres régions françaises.
- Hypothèse 3 : Il n’existe pas tant de solutions techniques pour contrer la salinisation mais plutôt des solutions de monitoring afin de tracker
Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:
Cartographie des acteurs salinisation
Image 1 : Cartographie des acteurs de la salinisation
Liste anonymisée des acteurs interviewés :
| Nom | Catégorie d’acteur | Profil |
| Mr Rivière | Chercheur – Association | Professeur (mathématiques et électronique), membre d’une association sur les rivières, chercheur au pôle Observation Signal et Environnement |
| Mr Robot | Chercheur | Professeur et chercheur en robotique marine, se concentre sur les karst |
| Mr Opotable | Entreprise | Directeur de l’innovation et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale |
| Mme Trèsmart | Startup – Chercheur | Hydrogéologue et ingénieure mécanique |
a) Mr Rivière
Profil : professeur à l’IMT Atlantique dans le Département Mathematical and Electrical Engineering. Il fait parti de l’association La Maison de la Rivière et de la Biodiversité, permettant de découvrir « en immersion » les écosystèmes aquatiques du Finistère. Il fait également parti du pôle Observations Signal & Environnement au Lab-sticc dans la télédétection océanique (images satellitaires), le monitoring de l’environnement marin (images aériennes, données GNSS, ARGOS, AIS, etc.) et sous-marin (acoustique passive, images vidéo sous-marines).
Verbatim : “Le problème n’est pas seulement technique. Tant qu’on pompera trop, le problème sera toujours le même. Ce qu’il faut, c’est un réel changement au niveau des modèles agricoles et politiques.”
Résumé de l’échange : Mr Rivière possède une double casquette (scientifique et associative) qui lui donne une vision globale de la qualité des eaux, de la rivière jusqu’à la mer.
Il décrit les problèmes multiples qui affectent les eaux douces en Bretagne : acidification liée à l’agriculture intensive et à l’industrie chimique, pollution par les nitrates et phosphates, prolifération d’algues vertes. Les données de l’IUEM (rapport envoyé) confirment une persistance de ces polluants dans le temps. L’eau du robinet provient principalement de l’Élorn et de l’Aulne, mais environ 20 % des ressources viennent des nappes phréatiques, déjà fragilisées par les intrants agricoles.
Côté solutions, il existe déjà des solutions, cependant il pense que c’est via un changement de modèle agricole, davantage tourné vers le bio, la réduction de la taille des exploitations et une régulation de l’usage des sols que de vrais changements apparaîtront.
Mr Rivière travaille dans une association, notamment sur la prévention pour reconnecter les enfants de la ville à la nature. En effet, des espèces de poissons sont directement impactées par la qualité des eaux (ex : saumon, truite de mer, anguilles…). Et les poissons plus adaptés à des eaux chaudes vont prendre le dessus.
Concernant son travail au Lab-Sticc, il se concentre sur les environnements marins, notamment sur la diminution de la circulation dans l’océan atlantique (Gulf Stream). Il rappelle qu’avec la fonte des glaces c’est la superficie de la Bretagne qui disparaît tous les 5 ans.
Enseignements :
- Des solutions techniques existent déjà, le problème est bien plus politique. Ce sont les systèmes et modèles politiques et agricoles qu’il faut revoir afin de diminuer l’impact environnemental.
- Il y a un grand travail de prévention de la population, de la jeunesse sur les sujets de l’eau. Il y a aussi beaucoup de méconnaissances sur la salinisation des eaux mais également sur toutes les questions autour du cycle de l’eau.
b) Mr Robot
Profil : professeur et chercheur au Lab-sticc, il est spécialisé en robotique marine et karstique, il a notamment travaillé sur la mise en œuvre de systèmes de communication à l’aide de capteurs (sonars) pour un robot mobile sous-marin. Son but est d’explorer et mesurer les réseaux souterrains (karsts, grottes, nappes).
Verbatim : “Ce n’est pas qu’un problème du Sud : ça existe aussi en Bretagne. Et une fois que l’eau salée s’installe dans une nappe, elle ne repart plus.”
Résumé de l’échange : Mr Robot travaille sur des robots autonomes destinés à explorer les réseaux karstiques, des réservoirs d’eau douce souterraine. Ces zones sont souvent invisibles, inaccessibles et pourtant cruciales car elles alimentent des ressources en eau douce destinées à la population mondiale.
Il explique que ces systèmes sont vulnérables aux phénomènes de pompage excessif, notamment dans les zones côtières. Lorsqu’on extrait trop d’eau, la pression diminue, et l’eau salée s’infiltre dans les nappes (le biseau salé). Il cite le cas des sources du Lez (près de Montpellier), où la surexploitation provoque régulièrement des remontées d’eau de mer dans les forages.
Les zones karstiques sont très poreuses et laissent aussi remonter d’autres types de polluants : microplastiques, pesticides anciens, métabolites (résidus chimiques transformés par l’environnement), voire molécules médicamenteuses (paracétamol). Ces traces se retrouvent jusqu’au fond des grottes, parfois à des profondeurs censées être “protégées”.
Mr Robot insiste que la solution s’appuie sur des outils de mesure et de modélisation précis. Cela passe par le développement de capteurs CTD (température, conductivité, densité) pour repérer les intrusions salines, une mesure du pH, un prélèvement de sédiments et d’eau pour évaluer la pollution. De leur côté, ils travaillent également sur la détection d’ADN environnemental permettant de suivre l’évolution des milieux et même d’identifier les espèces présentes historiquement.
Au-delà de l’aspect scientifique, il pointe les enjeux politiques et économiques. En effet, les désalinisateurs existent, mais ils sont coûteux et énergivores. La Bretagne est, de plus, très calcaire et possède beaucoup de granite. Elle n’a donc pas la capacité de stockage suffisante pour multiplier les pompages. Mr Robot insiste donc pour une meilleure planification hydrologique afin d’organiser les captages de manière durable. Les robots et capteurs ne sont que des outils : le cœur du problème reste la gestion collective et la sobriété hydrique.
Enseignements :
- Nous ne connaissions absolument pas l’existence des karst, qui est pourtant une source d’eau douce souterraine non-négligeable. Cependant nous confirmons l’hypothèse 3 concernant les solutions de monitoring pour l’analyse des données.
- Des solutions techniques existent déjà, notamment des désalinisateurs très coûteux et énergivores. Cela pourrait être intéressant, si ce n’est compliqué, de les rendre low-tech.
- L’accent est porté, encore une fois, sur le changement de modèle politique et économique afin de réellement faire bouger les choses, plutôt que des solutions techniques qui sont déjà sur le marché.
c) Mr Opotable
Profil : directeur de l’innovation et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale dans l’entreprise Eau du Ponant. Il s’occupe du “petit cycle de l’eau”, c’est à dire : la gestion publique de l’eau potable, la collecte et le transfert des eaux usées et enfin la gestion des eaux pluviales et incendie.
Verbatim : “Beaucoup d’industriels ne sont pas conscients que les stations d’épuration traitent très bien les eaux usées domestiques mais ne sont pas conçues pour éliminer les particules industrielles.”
Résumé de l’échange : Eau du Ponant assure le traitement et la distribution de l’eau potable, la collecte des eaux usées, leur épuration et leur retour dans le grand cycle de l’eau. L’entreprise est engagée sur les sujets d’innovation, de durabilité et d’expérimentation, notamment en matière de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et de solutions écologiques (myco-restauration, capteurs de suivi, etc.).
L’échange avec Mr Opotable a permis de dresser un panorama sur 2 enjeux : la quantité et la qualité.
- Enjeux de quantité
Le Finistère fait face à des épisodes récurrents de sécheresse. La région, principalement granitique, dispose de très peu de nappes phréatiques, ce qui rend la ressource vulnérable : l’ensemble des acteurs (agriculteurs, industriels, collectivités) puisent dans les mêmes réserves. Il y a une baisse constante des volumes disponibles et cela soulève la question cruciale du partage et de l’économie de la ressource.
Mr Opotable insiste sur la nécessité de mieux mesurer la consommation, notamment dans le secteur agricole où les forages ne sont pas systématiquement équipés de compteurs. Le manque de données fiables empêche une gouvernance efficace de la ressource et complique la modélisation hydrologique du territoire.
- Enjeux de qualité
Des progrès notables ont été réalisés grâce au travail conjoint avec le monde agricole : certaines rivières comme l’Orne affichent aujourd’hui une concentration en nitrates de 23 mg/L, contre 50 mg/L auparavant. Cependant, les pesticides, métabolites et micropolluants issus des activités agricoles et industrielles demeurent présents dans l’eau, avec des effets à long terme encore mal connus.
Les stations d’épuration actuelles traitent principalement la pollution organique par voie biologique, sans éliminer les micropolluants (résidus médicamenteux, hormones, polluants éternels tels que les PFAS). D’où la volonté d’Eau du Ponant de traiter les pollutions à la source, en identifiant et responsabilisant les producteurs de rejets.
Enseignements :
- La gestion de l’eau est avant tout une question de gouvernance, principalement dans le monde agricole, il y a un réel sujet qui empêche une vision correcte de la ressource.
- Les nappes karstiques sont des milieux très vulnérables, elles sont polluées en profondeur. Les impacts sont lents, invisibles et quasi irréversibles.
d) Mme Trèsmart
Profil : hydrogéologue, ingénieure mécanique de formation et entrepreneuse. Elle possède une startup avec un concept de bateau qui récolte la houle des vagues pour créer de l’énergie renouvelable et ainsi alimenter les centrales pas loin du bord de la mer. Elle a étudié la qualité et la variabilité des eaux selon son origine (souterraine, de surface, de pluie…)
Verbatim : “On parle de techniques de désalinisation, mais l’eau douce, ce n’est pas juste de l’eau sans sel. C’est un équilibre chimique fragile.”
Résumé de l’échange : Mme Trèsmart aborde cet entretien sous un angle plus écologique et social que purement technique. Ce fut l’entretien de transition entre notre premier sujet et notre sujet actuel.
L’eau potable n’est pour rappel pas simplement de l’eau douce, elle contient des minéraux et doit être équilibrée chimiquement. “Dessaler” ne suffit donc pas : il faut reminéraliser et stabiliser l’eau pour la rendre buvable et compatible avec les réseaux.
Elle souligne les différences régionales : certaines zones disposent de nappes souterraines importantes (notamment calcaires), d’autres, comme la Bretagne, reposent surtout sur des eaux de surface et de pluie, donc plus vulnérables aux pollutions agricoles (nitrates, phosphates, pesticides).
Elle insiste sur la politisation de l’eau : la gestion des zones humides, les bassines de stockage, l’irrigation agricole ou encore les conflits d’usage entre agriculteurs, collectivités et citoyens. Selon elle, les solutions techniques existent (filtration, mycorestauration, réutilisation des eaux usées, désalinisation solaire) mais elles ne suffisent pas : le vrai changement doit venir d’une meilleure gouvernance, d’une culture du partage et de la sobriété.
Finalement, elle évoque la perception citoyenne. En effet, la méfiance envers l’eau du robinet peut être forte, pourtant, elle rappelle que l’eau du robinet est beaucoup plus contrôlée que celle en bouteille. L’éducation à ces enjeux est donc essentielle pour éviter une perte de confiance dans le service public.
Enseignements :
- Le traitement chimique pour obtenir une eau potable est extrêmement compliqué à atteindre, ce n’est pas qu’une question de sel.
- Il y a un problème de connaissance et de confiance, en effet le rapport à l’eau (eau en bouteille vs du robinet) peut traduire un besoin de changer les habitudes et les consciences.
- Il y a des solutions techniques (désalinisation, filtration, mycorestauration) mais le frein est plutôt lié à la volonté collective et l’Etat. C’est un problème de société, pas seulement environnemental.
Au fil de nos recherches et de nos enquêtes terrain, il est devenu évident que le verrou principal n’est pas uniquement la salinisation ou les intrusions d’eau de mer, mais la manière dont les usagers consomment l’eau. En effet, nous avons relevé un consensus entre les interview : une solution purement technique, n’est pas viable mais elle réside dans un changement des modèles économiques, agricoles et des habitudes de consommation. Nous nous sommes d’abord interrogés sur la pertinence de cibler les agriculteurs ou les usagers. Pour les agriculteurs, des solutions techniques existent déjà, notamment grâce à des capteurs afin d’optimiser la qualité de l’eau ainsi que sa consommation. Cependant, c’est surtout le modèle agricole lui-même qui doit évoluer, ce qui rend le champ d’action limité dans ce secteur car très politisé. C’est pourquoi nous avons choisi de réorienter notre réflexion vers les usagers. La gestion individuelle de la consommation domestique d’eau représente un réel problème, à la fois économique et énergétique. En d’autres termes, sensibiliser à la quantité et au bon usage de l’eau domestique s’avère être un levier fondamental pour atténuer la pression sur les ressources et changer le récit du “manque d’eau”.
2) Pivot du projet, en route vers la consommation de l’eau potable chez les usagers
Notre prise de recul nous a permis de pivoter vers un problème plus connu mais pourtant toujours aussi présent : la consommation d’eau dans les foyers.
Notre problématique : Comment réduire la consommation excessive d’eau dans les foyers ?
Nos hypothèses qui ont été le fil conducteur de nos interview :
- Hypothèse 1 : Les foyers n’ont pas conscience (ou une méconnaissance) de leur consommation détaillée d’eau utilisée lors de leurs gestes quotidiens
- Hypothèse 2 : Les utilisateurs seraient plus motivés à réduire leur consommation s’ils pouvaient visualiser en temps réel l’impact financier de leur usage
- Hypothèse 3 : Les propriétaires de plusieurs logements (bailleurs, résidences, colocations…) souhaitent suivre et comparer les consommations d’eau afin de détecter un quelconque problème ou surconsommation.
- Hypothèse 4 : L’adoption d’un capteur dépend de sa facilité d’installation et d’usage.
Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:
Cartographie des acteurs eau potable
Image 2 : Cartographie des acteurs concernant l’eau potable
Liste anonymisée des acteurs interviewés :
| Nom | Catégorie d’acteur | Profil |
| Mr et Mme Ecolo | Particuliers – Propriétaires | Couple avec 2 enfants, sont sensibles à l’environnement |
| Mr Fuite | Acteurs publics | Technicien de résidences étudiantes |
| Mr et Mme Pas-écolo | Particuliers | Couple avec 3 enfants, ne sont pas forcément sensibles à l’environnement |
a) Mr et Mme Ecolo
Profil : couple propriétaire, ont deux adolescents. Ils sont sensibles à l’environnement, ils ont une vision long terme et une appétence pour la technologie. Ils sont équipés de panneaux solaires et d’un système ENGIE de suivi énergétique.
Verbatim : “ On a déjà un système de suivi électrique via ENGIE. Si on avait la même chose pour l’eau, ce serait top.”
Résumé de l’échange : Le couple a compris rapidement notre projet et perçoit notre solution comme une extension logique de leur démarche actuelle. En effet, ils voient cela comme un outil concret pour visualiser la consommation d’eau, comprendre les usages et ajuster les comportements (surtout de leurs enfants). Pour eux, l’eau est encore un usage “invisible” car le prix n’est pas élevé pour l’instant, mais d’ici 2030, ils savent que cela va augmenter. Ils font le parallèle avec leur application de suivi électrique, qui les aide à optimiser les moments d’usage des appareils électriques, par exemple, lancer les appareils gourmands (four, lave-linge) lorsque la production solaire est forte. Ils estiment que notre dispositif pourrait avoir le même effet vertueux sur l’eau, en permettant de repérer les usages les plus coûteux (douche, arrosage, lave-vaisselle…). Comme pour l’électricité, il y a des données personnelles à intégrer mais ils ne trouvent pas cela dérangeant, c’est même normal car une consommation pour 4 personnes est différente pour 2, également l’âge peut faire varier la consommation, ainsi que le mode de vie (sportif, retraités…)
Ils soulignent que la solution s’adresse avant tout à des personnes conscientes des enjeux environnementaux ou cherchant un retour sur investissement, plutôt qu’au grand public. Ce sont aussi des personnes qui pensent résultats longs termes et non pas dans les quelques semaines. Côté prix, ils pensent que payer 70 à 80 euros pour 3 à 4 capteurs est tout à fait acceptable (surtout pour la cuisine). Cependant, l’idée de l’abonnement n’est pas forcément optimale selon eux, sinon opter pour un abonnement peu cher.
Enseignements :
- Les foyers déjà sensibilisés ont conscience du problème. Ils cherchent des outils concrets et mesurables pour agir sur leur consommation. L’hypothèse 1 sur la conscience de la consommation est partiellement confirmée, nous nous adressions à un public très spécifique.
- L’hypothèse 2 se confirme : le levier économique (ROI, facture) complète le levier écologique.
- Il y a un lien entre écologie, technologie et pédagogie qui peut être fort suivant les cibles, ici le couple était curieux et engagé, prêt à investir afin de concilier économie, écologie et confort de vie.
- L’importance du feedback visuel clair via une application et de la mesure en temps réel est confirmée, il y a une notion de challenge, très appréciée.
b) Mr Fuite
Profil : Technicien chargé de la maintenance et du suivi des consommations d’eau dans les résidences étudiantes. Il gère les relevés de consommation d’eau, la maintenance préventive et la détection des incidents (fuites, anomalies). Il travaille en lien avec l’équipe technique de l’établissement et mais ne connaît pas forcément les contraintes budgétaires et techniques liées à la gestion des bâtiments collectifs.
Verbatim : “On fait les relevés d’eau tous les mois et on compare avec l’année dernière. Ça marche tant qu’il n’y a pas de problème. Cependant, on a eu une fuite récemment dans un bâtiment, et on ne s’en est rendu compte que plusieurs semaines après, quand la facture est arrivée…”
Résumé de l’échange : Le technicien indique que les relevés d’eau sont effectués chaque mois et comparés avec les années précédentes. Ce suivi “papier” fonctionne globalement, mais peut laisser passer des anomalies entre deux relevés. Par exemple, une fuite importante est survenue dans un des bâtiments et a été détectée trop tard, générant un surcoût notable, mais aussi une perte de temps non négligeable. Il évoque la volonté de l’équipe technique de mettre en place un système d’alarme automatique capable d’envoyer une notification en cas de pic anormal de consommation. Il souligne que l’intégration d’une telle fonctionnalité serait un atout fort pour les gestionnaires de bâtiments, en complément d’un suivi des usages pour sensibiliser les occupants.
Toutefois, il insiste sur la contrainte budgétaire : le coût d’équipement et d’installation doit être raisonnable pour être envisagé à l’échelle de plusieurs bâtiments. Il n’est cependant pas au courant des budgets disponibles et doivent sûrement rester à définir.
Enseignements
- L’hypothèse 3 est confirmée, en effet, le besoin de détection rapide des anomalies (fuites, surconsommation) via une alerte, alarme ou un visuel est fort pour les gestionnaires de bâtiments. → La dimension alerte / notification automatique est une évolution stratégique à intégrer à notre solution.
- L’hypothèse 2 est indirectement confirmée : il y a un intérêt économique fort et opérationnel (plutôt qu’écologique dans cette situation)
- L’hypothèse 4 est confirmée : il y a besoin d’un produit simple à installer et d’utilisation.
- Le capteur pourrait ainsi répondre à une double fonction : sensibilisation + sécurisation du réseau.
- Cela ouvre une piste B2B complémentaire : équiper les résidences, collectivités ou bailleurs.
c) Mr et Mme Pas-écolo
Profil : couple citadin avec 3 enfants, sans démarche écologique particulière, n’ayant pas de dispositif de suivi énergétique. Leur rapport à l’eau est utilitaire : ils utilisent sans compter, sans percevoir de problème particulier.
Verbatim : “On ne sait pas combien on consomme, mais la facture ne change pas trop, donc on ne se pose pas la question.”
Résumé de l’échange : l’entretien a rapidement montré une absence de conscience du volume d’eau utilisé dans leurs gestes quotidiens. Ils reconnaissent ne pas vraiment consulter leur facture d’eau en détail, tant que le montant reste stable. Leur discours montre que l’eau n’est pas perçue comme une ressource rare ni comme une charge financière trop importante. Ils admettent toutefois qu’une fuite importante serait problématique, ce qui met en lumière un intérêt ponctuel et réactif, plutôt qu’une démarche proactive. Le couple indique aussi que pour qu’un tel produit les attire, il doit être très simple d’utilisation et d’installation.
Lorsqu’on évoque l’idée d’une application, ils répondent que cela pourrait être une bonne idée à condition que ce soit ludique et avec un réel bénéfice immédiat (réduction visible de la facture).
Leur réaction permet de mieux comprendre le déficit d’intérêt général du grand public, mais aussi les leviers à activer : pédagogie, visualisation concrète, notifications simples et valorisation des économies réalisées.
Enseignements :
- Hypothèse 1 confirmée : le manque de conscience du problème est un frein majeur à l’adoption. La plupart des foyers ne connaissent pas le volume d’eau consommé.
- Hypothèse 2 confirmée : le levier écologique seul n’est pas suffisant : il faut un bénéfice direct, à court terme et visible.
- L’hypothèse 4 est aussi confirmée : la simplicité d’utilisation est quasi-obligatoire
- Le côté ludique et pédagogique peuvent aider à rendre le sujet plus concret et attractif.
- Cette catégorie d’usagers incite à envisager un positionnement progressif : d’abord les foyers engagés, puis le grand public à travers la sensibilisation et les incitations financières.
II) Personas
Persona 1 :
Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:
Image 3 : Persona 1, Cécile Encieux
Pourquoi ce choix ? Nous avons choisi une cible déjà consciente d’un point de vue écologique et économique. De plus, il y avait une forte appétence pour les gadgets techniques, ils adoptent les produits tech sans réticences. C’est également une famille avec des enfants, notamment des adolescents, qui peuvent avoir une consommation d’eau élevée.
Persona 2 :
Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:
Image 4 : Persona 2 : Jack Adi
Pourquoi ce choix ? Nous avons voulu creuser une cible qui voyait le côté économique plutôt qu’écologique. Un propriétaire multi-logement est une cible idéale, directement inspiré de nos interview. Ce profil est, selon nous, touché, notamment par l’aspect économique. En effet : les bailleurs sont motivés par la réduction des coûts de gestion et la prévention des sinistres (fuites non détectées provoquant de lourdes factures).
Persona 3 :
Lien pdf afin de lire le document de manière lisible:
Image 5 : Persona 3 : Romain Tenance
Pourquoi ce choix ? Nous avons voulu creuser une cible qui voyait le côté pratique au travail et économique. C’est aussi une cible qui permettrait de savoir si c’est possible d’élargir notre marché (B2B). Nous voulions une cible plus axée professionnelle.
F.O.C.U.S : Etat De L’Art
ETAT DE L’ART DU PROJET : F.O.C.U.S.
par LACOTTE Axel, GILLET Lucie, PETIT Gaëtan, Xiaoyu LIU et Gaspard CHEVALIER.
PROBLÈME INITIAL
La concentration est l’action de faire porter toute son attention sur un même objet. Nous pensons que la concentration est la clé d’un travail de groupe efficace et productif. Ainsi notre groupe va se pencher ce semestre sur la problématique suivante : Comment améliorer la concentration des travailleurs dans un espace de travail collaboratif ? Cette problématique s’inscrit dans plusieurs environnements possibles :
- Des classes d’élèves où le professeur fait son cours
- Des équipes de sportifs entraînées par un coach
- Des bureaux ouverts où les salariés travaillent ensembles, dirigés par un manager
Plusieurs facteurs hypothétiques pourraient expliquer un manque de concentration, et ils se distinguent en plusieurs catégories :
- LES FACTEURS EXTERNES
-
- Le bruit nous semble être la cause principale de la perte de concentration
- La lumière / luminosité de l’espace de travail
- Les collègues/camarades nous interrompent
- La qualité de l’air
- Ergonomie de l’espace de travail
- LES FACTEURS INTERNES
-
- L’état de fatigue, alimentation, la santé physique
- La motivation à faire réaliser tâche, le niveau de stress, la santé mentale
RECHERCHE DOCUMENTAIRE
La concentration (ou capacité d’attention soutenue) est un facteur clé de la performance cognitive (1) . Lorsqu’elle fait défaut, le résultat est une perte de productivité significative le cerveau subit des “ switch costs” (coûts de changement de tâche). Chaque fois qu’on abandonne un travail pour en commencer un autre, même brièvement, il faut un temps non négligeable pour se recentrer.
Cette dynamique est confirmée dans une étude (2) menée auprès de développeurs logiciels, qui montre que les interruptions répétées, y compris celles provoquées par nous-mêmes, réduisent la performance, car le cerveau doit constamment rediriger ses ressources cognitives vers la nouvelle tâche.
De plus, les recherches sur le “media multitasking” (3) (utiliser plusieurs médias en même temps) révèlent qu’il nuit à la mémoire de travail, à la compréhension de texte et à la capacité de rappel, ce qui finit par impacter négativement la qualité et la rapidité d’exécution des tâches académiques.
Enfin, des études (4) montrent que dans les environnements ouverts (du type open-space), où les distractions externes sont nombreuses, les salariés dont les tâches exigent une forte concentration sont ceux qui voient le plus leur performance diminuer et leur niveau de stress monter.
Aujourd’hui, nous constatons que la capacité de concentration est en baisse et que c’est un problème de société qui tend à s’amplifier à l’avenir, comme le montre cette étude réalisée en 2023.(5)
Comme nous le pensions, différents facteurs jouent sur la concentration :
FACTEURS EXTERNES :
- Le bruit
Le bruit constitue l’un des facteurs environnementaux les plus influents sur la concentration (6). Dans un milieu professionnel, scolaire ou même domestique, une exposition prolongée à des sons parasites — conversations, notifications, circulation, machines — perturbe la capacité du cerveau à maintenir une attention soutenue. Les études en ergonomie et en psychologie cognitive (7) montrent que le bruit augmente la charge mentale, ralentit le traitement de l’information et favorise la fatigue attentionnelle, en particulier dans les espaces ouverts où le contrôle de l’environnement sonore est limité .
Pour y remédier, plusieurs solutions existent : l’aménagement acoustique des locaux (panneaux absorbants, cloisons, revêtements anti-bruit), la création de zones calmes ou de “bubbles” de concentration, l’utilisation de casques antibruit ou de sons neutres comme le bruit blanc, ainsi que la mise en place de politiques de travail hybrides favorisant des temps de travail au calme. Ces dispositifs permettent de restaurer un environnement propice à la concentration et à la performance cognitive.
- La luminosité
La luminosité joue un rôle essentiel dans la concentration et la performance cognitive. Une lumière insuffisante ou inadaptée fatigue les yeux, altère la vigilance et réduit la capacité d’attention, tandis qu’un éclairage trop intense ou mal orienté peut provoquer de l’inconfort visuel et des maux de tête. Dans les environnements professionnels et scolaires, la qualité de la lumière influence directement la productivité, l’humeur et le niveau d’engagement. Les recherches en ergonomie et en neuropsychologie (8) ont montré que la lumière naturelle améliore la régulation du rythme circadien, favorisant ainsi l’éveil et la concentration, tandis qu’un éclairage artificiel mal calibré (notamment à lumière froide ou clignotante) peut induire une baisse de performance.
Pour optimiser ces effets, plusieurs solutions existent : maximiser l’accès à la lumière naturelle, utiliser des luminaires à intensité et température de couleur réglables, adapter la disposition des postes de travail pour éviter les reflets, et intégrer des pauses visuelles régulières pour limiter la fatigue oculaire. Ces aménagements contribuent à créer un environnement visuel équilibré, propice à la concentration et au bien-être.
- La présence humaine
La présence humaine dans un environnement de travail ou d’étude influence fortement la concentration, tant de manière positive que négative. Travailler entouré d’autres personnes peut stimuler la motivation, favoriser la coopération et renforcer le sentiment d’appartenance, mais cela peut aussi générer des distractions sociales, du bruit conversationnel et une surveillance implicite qui réduisent l’attention soutenue. Les recherches en psychologie du travail et en neurosciences sociales (7) montrent que la simple présence d’autrui active certaines zones cérébrales liées à la vigilance et à l’autorégulation, ce qui peut détourner une partie des ressources cognitives nécessaires à la tâche en cours. Dans les open spaces, cette co-présence constante augmente la charge mentale et le risque d’interruptions involontaires.
Pour limiter ces effets, plusieurs solutions existent : instaurer des zones de travail individuelles ou silencieuses, favoriser le télétravail partiel, définir des moments collectifs distincts des périodes de concentration, ou encore aménager des espaces modulables selon les besoins (travail collaboratif contre travail focalisé). Ces approches permettent de concilier la dimension sociale du travail avec la préservation d’un environnement propice à la concentration.
- La qualité de l’air
La qualité de l’air influence directement les capacités de concentration, la vigilance et les performances cognitives. Un air vicié, mal ventilé ou chargé en dioxyde de carbone (CO₂) réduit l’oxygénation du cerveau, provoquant fatigue, somnolence et baisse de l’attention. Des études en ergonomie et en santé environnementale (8) ont montré qu’un taux de CO₂ supérieur à 1000 ppm entraîne une diminution mesurable des fonctions exécutives, telles que la prise de décision et la mémoire de travail. Dans les bureaux et les salles de classe mal ventilés, ces effets s’accumulent au fil de la journée, altérant la productivité et la capacité de travail
Pour améliorer la qualité de l’air, plusieurs solutions existent : assurer une ventilation naturelle ou mécanique efficace, installer des capteurs de CO₂ pour surveiller les niveaux en temps réel, introduire des plantes dépolluantes, limiter les sources de polluants intérieurs (produits chimiques, mobilier non certifié), et prévoir des pauses régulières à l’extérieur. En maintenant un air sain et bien renouvelé, on favorise un environnement plus énergisant, propice à la concentration et au bien-être mental.
- Ergonomie de l’espace de travail
L’ergonomie de l’espace de travail joue un rôle déterminant dans la capacité de concentration et la performance cognitive. Un poste mal adapté — siège inconfortable, bureau trop haut ou trop bas, position de l’écran inappropriée — peut provoquer des tensions musculaires, des douleurs chroniques et de la fatigue physique, qui détournent l’attention de la tâche principale. De plus, un environnement encombré ou mal organisé augmente les distractions visuelles et réduit l’efficacité dans la gestion des documents et outils nécessaires au travail. Les recherches en ergonomie et psychologie du travail (9) montrent que des postes bien conçus, adaptés à la morphologie de l’utilisateur et favorisant une posture confortable, améliorent la vigilance, diminuent le stress physique et mental, et permettent de maintenir l’attention sur des périodes plus longues.
Pour optimiser l’ergonomie, plusieurs solutions existent : utiliser un mobilier réglable en hauteur, positionner les écrans à la bonne distance et hauteur, organiser l’espace de manière fonctionnelle, favoriser la lumière naturelle et limiter les sources de distraction visuelle, et encourager les pauses actives pour réduire la fatigue corporelle. Ces mesures contribuent à créer un environnement de travail propice à la concentration et au bien-être global des salariés.
FACTEURS INTERNES :
- La santé physique
- L’état de fatigue
L’état de fatigue constitue un facteur majeur affectant la concentration et les performances cognitives. Une fatigue physique ou mentale réduit la vigilance, ralentit le traitement de l’information et accroît les erreurs, rendant plus difficile le maintien d’une attention soutenue sur des tâches prolongées. Les recherches en neuropsychologie et en chronobiologie (10) montrent que le manque de sommeil, les horaires de travail décalés ou l’accumulation de tâches stressantes altèrent la mémoire de travail, la prise de décision et la capacité à se focaliser sur l’essentiel.
Pour limiter ces effets, plusieurs solutions existent : adopter des rythmes de sommeil réguliers et suffisants, inclure des pauses courtes et régulières au cours de la journée de travail, pratiquer des micro-siestes si possible, et gérer la charge de travail pour éviter la surcharge cognitive. Maintenir un état de vigilance optimal favorise ainsi une concentration plus stable, une meilleure productivité et un bien-être général amélioré.
- L’état d’alimentation
L’état d’alimentation a un impact direct sur la concentration et les performances cognitives. Une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucres rapides ou insuffisante en nutriments essentiels, peut provoquer des variations de la glycémie, entraînant fatigue, irritabilité et baisse d’attention. Les études en nutrition et neuroscience (11) montrent que le cerveau dépend d’un apport énergétique stable et de nutriments spécifiques (oméga‑3, vitamines, minéraux) pour maintenir la mémoire de travail, la vigilance et la capacité de résolution de problèmes.
Pour favoriser une concentration optimale, plusieurs solutions existent : prendre des repas équilibrés et réguliers, privilégier les aliments à index glycémique modéré, s’hydrater correctement tout au long de la journée, et éviter les excès de caféine ou de sucre qui peuvent provoquer des pics suivis de baisses d’énergie. Une alimentation adaptée permet ainsi de soutenir l’énergie mentale, la concentration et la productivité sur la durée.
- La santé mentale
- Le niveau de stress
Le niveau de stress constitue un facteur majeur pouvant altérer la concentration et les performances cognitives. Un stress modéré peut parfois stimuler la vigilance, mais un stress élevé ou chronique surcharge les ressources cognitives, réduit la mémoire de travail, augmente les distractions et favorise les erreurs. Les recherches en psychologie et neurosciences (12) montrent que le cortisol, hormone du stress, affecte le fonctionnement du cortex préfrontal, siège de la planification et de l’attention soutenue.
Pour limiter ces effets et préserver la concentration, plusieurs solutions existent : pratiquer des techniques de gestion du stress (respiration, méditation, mindfulness), organiser le travail en priorisant les tâches et en évitant la surcharge, aménager des pauses régulières pour se détendre, et maintenir un environnement de travail soutenant (clarté des objectifs, communication bienveillante). Une gestion efficace du stress permet ainsi de maintenir un niveau d’attention optimal et de préserver la performance cognitive sur la durée.
- Le niveau de motivation
Le niveau de motivation joue un rôle central dans la capacité à se concentrer et à maintenir l’attention sur une tâche. Une motivation élevée favorise l’engagement cognitif, la persévérance et la vigilance, tandis qu’une motivation faible entraîne procrastination, distraction et baisse de performance. Les recherches en psychologie cognitive et en neurosciences motivationnelles (13) montrent que la dopamine, neurotransmetteur lié à la récompense, module la focalisation et la capacité à gérer des tâches exigeantes sur le plan cognitif.
Pour optimiser la concentration via la motivation, plusieurs solutions existent : fixer des objectifs clairs et atteignables, segmenter les tâches en étapes concrètes et valorisantes, offrir des feedbacks réguliers et positifs, et associer les tâches à des intérêts personnels ou professionnels. Maintenir un niveau de motivation suffisant permet ainsi d’améliorer la persistance attentionnelle et l’efficacité globale dans le travail ou l’apprentissage.
Nous nous appuyons aussi sur la théorie des deux facteurs de Herzberg (14) , qui distingue pour la motivation les facteurs extrinsèques (conditions de travail, salaire, sécurité, relations avec les collègues) et les facteurs intrinsèques (reconnaissance, responsabilités, accomplissement, autonomie).
L’idée est que si les facteurs extrinsèques agissent sur l’insatisfaction, les facteurs intrinsèques stimulent l’engagement et la concentration. Ainsi, en améliorant les conditions de travail tout en favorisant la reconnaissance, la responsabilité et l’autonomie, nous cherchons à créer un environnement propice à une concentration soutenue et à une performance optimale.
REFORMULATION DU PROBLÈME
Après avoir analysé les différents facteurs externes et internes influençant la concentration, nous avons choisi de nous focaliser sur l’aspect de la motivation, des facteurs intrinsèques. La motivation représente un levier clé pour améliorer durablement l’attention et l’engagement des individus dans leurs tâches. De plus, la majorité des résultats de nos recherches concernaient les environnements professionnels (bureaux partagés, open spaces, …) et c’est pourquoi nous refermons le cadre de notre étude à ce milieu. Ainsi, la problématique initiale à propos de la concentration devient : comment améliorer la motivation des salariés dans le cadre de projets collaboratifs ?
ANALYSE DES ENJEUX DU PROBLÈME
- Enjeu Politique
Nous assistons à la création de politiques publiques récentes (15) encourageant la médiation sociale et la prévention des risques psychosociaux, des leviers importants pour préserver la motivation en projets collaboratifs (réduction des conflits, meilleure écoute).
- Enjeu Économique
Des études (16) montrent que la rémunération reste un levier, mais les travaux sur la motivation indiquent que l’immense majorité des gains durables en motivation collaborative passent par l’autonomie, le sens et la reconnaissance, pas seulement par le salaire direct.
- Enjeu Social
Le sens du travail et de l’équilibre vie personnelle/professionnelle sont de plus en plus centraux en France. Les projets collaboratifs motivent davantage si le lien entre les tâches et l’objectif final est explicite et si le groupe a des bonnes bases de communications. (17)
- Enjeu Technologique
Les outils numériques (plateformes collaboratives, gestion de projet, espaces de co-création) peuvent accroître l’engagement si bien choisis, mais un usage inadapté (trop d’outils, mauvaise ergonomie) fragilise la motivation. De plus, le télétravail a modifié le rapport au groupe : bénéfices d’autonomie mais risques d’isolement et de perte d’interactions informelles. (18)
- Enjeu Écologique
Pour beaucoup de Français, l’alignement éthique/environnemental d’un projet favorise la motivation prosociale (envie de contribuer à quelque chose d’utile). Intégrer des objectifs RSE dans les projets peut donc renforcer la motivation.(19)
- Enjeu Légal
Les modalités de travail (télétravail, temps de réunion hors heures, temps de formation) doivent respecter le cadre légal. En effet, les manquements peuvent démotiver fortement les salariés (ressentiment, charge perçue). (20)
Notre problématique s’inscrit donc bien dans un environnement riche touchant plusieurs enjeux de société importants
BIBLIOGRAPHIE
- Bialowolski P, McNeely E, VanderWeele TJ, Weziak-Bialowolska D. Ill health and distraction at work: Costs and drivers for productivity loss. PLoS ONE. 31 mars 2020;15(3):e0230562.
- Abad ZSH, Karras O, Schneider K, Barker K, Bauer M. arXiv.org. 2018 [cité 12 oct 2025]. Task Interruption in Software Development Projects: What Makes some Interruptions More Disruptive than Others? Disponible sur: https://arxiv.org/abs/1805.05508v1
- May KE, Elder AD. Efficient, helpful, or distracting? A literature review of media multitasking in relation to academic performance. Int J Educ Technol High Educ. 27 févr 2018;15(1):13.
- Seddigh A, Berntson E, Bodin Danielson C, Westerlund H. Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance. J Environ Psychol. 1 juin 2014;38:167‑74.
- Have Attention Spans Been Declining? — LessWrong [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://www.lesswrong.com/posts/Pweg9xpKknkNwN8Fx/have-attention-spans-been-declining
- Fernández-Quezada D, Martínez-Fernández DE, Fuentes I, García-Estrada J, Luquin S. The Influence of Noise Exposure on Cognitive Function in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. NeuroSci. 4 mars 2025;6(1):22.
- Social-Facilitation-and-Impairment Effects: From Motivation to Cognition and the Social Brain – Clément Belletier, Alice Normand, Pascal Huguet, 2019 [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963721419829699
- Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO2 concentrations on human decision-making performance – PubMed [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23008272/
- Mottaghi Z, Halvani G, Jambarsang S, Mehrparvar AH. Effect of Ergonomic Intervention on Cognitive Function of Office Workers. Indian J Occup Environ Med. 2024;28(4):267‑71.
- Santisteban JA, Brown TG, Ouimet MC, Gruber R. Cumulative mild partial sleep deprivation negatively impacts working memory capacity but not sustained attention, response inhibition, or decision making: a randomized controlled trial. Sleep Health. févr 2019;5(1):101‑8.
- Cansino S, Torres-Trejo F, Estrada-Manilla C, Flores-Mendoza A, Ramírez-Pérez G, Ruiz-Velasco S. Nutrient effects on working memory across the adult lifespan. Nutr Neurosci. mai 2023;26(5):456‑69.
- Oei NYL, Everaerd WTAM, Elzinga BM, van Well S, Bermond B. Psychosocial stress impairs working memory at high loads: An association with cortisol levels and memory retrieval. Stress. 1 janv 2006;9(3):133‑41.
- Roffman JL, Tanner AS, Eryilmaz H, Rodriguez-Thompson A, Silverstein NJ, Ho NF, et al. Dopamine D1 signaling organizes network dynamics underlying working memory. Sci Adv. 3 juin 2016;2(6):e1501672.
- Angel V, Déprez GRM. XVIII. Frederick Herzberg. La théorie des deux facteurs, motivationnels et d’hygiène. In: Les grands auteurs en psychologie et le management [Internet]. EMS Éditions; 2024 [cité 12 oct 2025]. p. 291‑307. Disponible sur: https://shs.cairn.info/les-grands-auteurs-en-psychologie-et-le-management–9782376879954-page-291
- La médiation sociale se développe en entreprise : « on peut traiter plus vite les situations conflictuelles, avant qu’elles ne dégénèrent ». 7 mars 2025 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2025/03/07/la-mediation-sociale-se-developpe-en-entreprise-on-peut-traiter-plus-vite-les-situations-conflictuelles-avant-qu-elles-ne-degenerent_6576911_1698637.html
- (PDF) The impact of organizational culture on work performance: the mediating role of intrinsic motivation. ResearchGate [Internet]. 8 juin 2025 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/348781758_The_impact_of_organizational_culture_on_work_performance_the_mediating_role_of_intrinsic_motivation
- les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues-enquete.pdf [Internet]. [cité 12 oct 2025]. Disponible sur: https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues-enquete.pdf
- Le télétravail limite-t-il la créativité collective ? 12 nov 2024 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/11/12/le-teletravail-limite-t-il-la-creativite-collective_6389158_1698637.html
- Criscuolo C, Gal P, Leidecker T, Losma F, Nicoletti G. Aspirations et (dés-)engagements : les évolutions contemporaines du rapport au travail.pdf. Econ Stat Econ Stat. 26 juill 2023;(539):51‑72.
- Expression des salariés : un droit peu exploré mais propice à l’amélioration des conditions de travail. 20 mars 2024 [cité 12 oct 2025]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/03/20/expression-des-salaries-quarante-ans-apres-les-lois-auroux-un-sujet-inexplore-mais-toujours-d-actualite_6223014_1698637.html
BREIZH4LINE – État de l’art
Axelle MELLIER
Anne-Lise PELLETIER
Romain CHRISTOL
Jean-Louis DJE
Samuel POODA
I. Présentation du problème
a. Contexte général
Notre réflexion s’est initialement portée sur la salinisation des eaux douces, un phénomène qui menace la qualité et la disponibilité de la ressource. Ce problème, directement lié aux activités humaines (pompages excessifs, urbanisation, pratiques agricoles) et accentué par le changement climatique (sécheresses, montée du niveau de la mer), représente un risque silencieux mais préoccupant pour l’approvisionnement en eau potable. Très vite, nos recherches et nos échanges avec différents acteurs nous ont amenés à élargir notre approche au-delà de la salinisation. C’est la qualité et la pureté des eaux douces dans leur ensemble (acidification, pollutions diffuses, contamination chimique ou organique) qui doivent être interrogées.
En Bretagne, 80 % de l’eau potable provient des rivières (contre 20 % des nappes), à l’inverse de la moyenne nationale. Cela rend ce territoire plus vulnérable à la dégradation de la qualité de l’eau, notamment en cas de pollution ou d’intrusion saline.
Ainsi, le problème dépasse la seule dimension environnementale pour devenir un enjeu sanitaire, économique, social et politique. La qualité de l’eau que nous consommons n’est pas la même selon les territoires, en effet, certaines régions bénéficient d’un accès régulier à une eau de haute qualité, tandis que d’autres subissent déjà des contraintes ou des risques accrus. Cela impacte donc les foyers des usagers sur leur consommation que ce soit en qualité qu’en quantité.
b. Acteurs concernés et interactions observées
L’étude de la qualité des eaux douces révèle la présence d’une grande variété d’acteurs, aux priorités et aux perceptions parfois divergentes malgré leurs interactions.
Pour les usagers, la qualité de l’eau est une préoccupation quotidienne, souvent perçue à travers son usage domestique : boire, cuisiner, se laver ou arroser un jardin. La salinisation et la pollution impactent directement son bien-être et sa santé, mais aussi son budget, car un traitement plus poussé de l’eau entraîne des coûts supplémentaires supportés par les ménages via les factures.
Les institutions publiques, qu’il s’agisse de l’État, des agences de l’eau ou des collectivités territoriales comme les communes, ont pour rôle d’encadrer et de réguler l’usage de la ressource. Elles considèrent la salinisation et la pollution comme des conséquences directes du changement climatique et des pressions locales, mais se heurtent à la complexité de la gestion de l’approvisionnement, en particulier dans les zones côtières et agricoles.
Les entreprises et startups abordent quant à elles la problématique sous un angle économique. Certaines, notamment celles actives dans l’extraction d’eau douce sur les côtes bretonnes, privilégient les bénéfices de leurs activités au détriment des équilibres hydrologiques, contribuant ainsi aux intrusions salines [42]. D’autres, issues des secteurs de l’industrie, la WaterTech, la Cleantech et de l’AgriTech, développent au contraire des solutions pour surveiller ou limiter la dégradation de l’eau, souvent en réponse au manque de données fiables. Par exemple, Adionics [43], une entreprise française, conçoit un dessalement sélectif à faible empreinte énergétique. Ces initiatives cherchent un équilibre entre performance économique et durabilité environnementale, mais restent souvent centrées sur l’efficacité technique, au détriment des dimensions sociales et écologiques du problème.
Les agriculteurs, directement dépendants de la qualité de l’eau pour l’irrigation et l’élevage, perçoivent la salinisation et la pollution comme des menaces immédiates pour leur productivité. Ceux-ci, en raison de leurs besoins de rendement, s’adaptent tant bien que mal à ces problèmes. Des solutions pour lutter contre ces phénomènes leur seraient d’une grande aide. Toutefois, pour certains, une mauvaise gestion de leur élevage ou encore l’utilisation excessive d’engrais azotés contribue à la pollution.
Les chercheurs et laboratoires, de leur côté, insistent sur le fait que le problème reste sous-estimé. Ils produisent beaucoup de données utiles, qui servent à orienter les politiques publiques et à informer les associations, mais rappellent que les réponses ne peuvent pas être uniquement technologiques : elles doivent aussi inclure des changements de pratiques et de politiques.
Enfin, les associations environnementales mettent en avant les impacts écologiques de la dégradation de l’eau. Elles considèrent la salinisation et la pollution comme des menaces majeures pour les écosystèmes et la biodiversité, et insistent sur la responsabilité des pratiques humaines, privilégiant la prévention et la sensibilisation des populations.
II. Nos recherches documentaires
a. Introduction et contexte
La salinisation des eaux douces est un enjeu environnemental majeur, particulièrement dans les zones littorales comme la Bretagne. Bien que l’eau douce représente moins de 3 % des ressources mondiales, elle demeure indispensable pour l’alimentation, l’agriculture, l’industrie et le maintien des écosystèmes. En Bretagne, la proximité de l’océan Atlantique, la géologie locale et les usages intensifs exposent les nappes côtières à un risque accru d’intrusion saline.
L’objectif de ce travail documentaire est de retracer les connaissances actuelles sur les mécanismes de salinisation, d’identifier les facteurs contributifs, d’analyser les solutions existantes, de comprendre les usages associés et de situer le cadre réglementaire applicable.
b. Écosystème et ressources concernées
L’écosystème visé englobe essentiellement :
- Les nappes phréatiques côtières (plus ou moins profondes selon les secteurs).
- Les cours d’eau et estuaires, qui peuvent être sujets à des remontées d’eau salée lors de marées ou tempêtes.
- Les milieux humides, zones de transition entre milieux d’eau douce et milieux salés, pour lesquels la qualité de l’eau est cruciale.
Ces ressources alimentent les usages suivants :
- Eau potable (via les services publics, comme Eau du Ponant à Brest)
- Irrigation agricole
- Abreuvement du bétail
- Entretien des équipements agricoles (nettoyage des installations, refroidissement, etc.)
- Usage industriel (notamment agroalimentaire)
- Aquaculture (conchyliculture, pisciculture, algoculture)
- Milieux naturels (faune, flore aquatique)
- Activités récréatives : Pêche de loisir (en eau douce et en mer), sports aquatiques (baignade, voile, kayak, surf…
- Transport fluvial ou maritime
c. Facteurs contribuant à la salinisation
La littérature et les rapports montrent que plusieurs facteurs, cumulés ou interactifs, favorisent la salinisation :
-
- Proximité de l’océan Atlantique : Les nappes côtières peuvent subir l’infiltration d’eau de mer si la pression d’eau douce baisse. Les marées et tempêtes accentuent ce risque [1].
- Surexploitation des nappes : Les pompages excessifs pour répondre aux besoins croissants diminuent la pression dans l’aquifère, ce qui facilite l’intrusion saline [2].
- Changement climatique et sécheresses : Diminution des précipitations, épisodes secs prolongés équivaut à moins de recharge des nappes, ce qui affaiblit la résistance des nappes à l’intrusion saline [3].
- Géologie locale et perméabilité : La nature des roches et des sols (porosité, perméabilité) conditionne la facilité d’infiltration de l’eau salée dans les nappes.
d. Techniques et solutions existantes
Les solutions identifiées, présentes dans des études ou déjà appliquées, offrent des pistes de réponses partiellement ou totalement au problème. Nous énumérons entre autres : Gestion raisonnée des prélèvements, recharge artificielle des nappes, Dessalement de l’eau de mer, Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) ainsi que les travaux de protection des captages et zones tampons. Nous en approfondissons quelques pour les besoins de la compréhension :
Dessalement de l’eau de mer
Le dessalement est peu déployé en France mais reste évoqué comme solution de secours en cas de stress hydrique sévère, surtout dans les îles ou zones côtières isolées. Trois usages principaux :
- Alimentation en eau potable :
-Acteurs : communes insulaires (ex : Île de Sein, Haute-Corse), entreprises spécialisées comme Osmosun, collectivités locales.
-Statistiques : en France, il existe peu d’unités de dessalement en fonctionnement dans l’hexagone ; la technologie est encore marginale. [4]
- Solution d’urgence en période de sécheresse ou de rupture d’approvisionnement :
-Acteurs : collectivités locales, autorités publiques, parfois entreprises privées ou partenariats public-privé.
-Statistiques : le marché mondial du dessalement est en forte croissance ; environ 20 000 usines dans le monde produisant environ 115 millions de m³ d’eau douce par jour en 2023 [5].
-Résultats : ces installations permettent de faire face à des épisodes critiques, mais sont souvent considérées comme une option de dernier recours en France, en raison de leur impact environnemental (consommation d’énergie, rejet de saumure) et de leur coût économique.
- Usage dans les territoires d’outre-mer ou milieu littoral sensible :
-Acteurs : administrations ultramarines, collectivités insulaires, bureaux d’études, entreprises d’eau.
-Statistiques : bien qu’il y ait quelques installations dans les territoires d’outre-mer, leur capacité reste limitée. La France ne figure pas parmi les pays les plus avancés en dessalement de mer.
•Surveillance et instrumentation
La surveillance (qualité, niveaux, salinité) et les dispositifs d’instrumentation sont des outils essentiels pour anticiper les risques, piloter les politiques et adapter les usages.
- Suivi piézométrique et des niveaux de nappes :
-Acteurs : BRGM, Agences de l’eau, DREAL ou DREAL de bassin, services de l’État.
-Statistiques : la France dispose de milliers de points de suivi ; de nombreux forages piézométriques sont relevés régulièrement (état des nappes, évolution interannuelle). [6]
- Contrôle chimique (conductivité, chlorures, nitrate, pesticides) :
-Acteurs : laboratoires publics, BRGM, agences de l’eau, collectivités, associations environnementales.
-Statistiques : près de 14 300 captages fermés depuis 1980 pour cause de pollution, dont ~32 % des cas pour la dégradation de la qualité de l’eau (nitrates, polluants agricoles, pesticides) en France. [7]
-Résultats : ces contrôles permettent de détecter des dépassements de normes, de déclencher des actions réglementaires ou des fermetures de captages. Par exemple, le dispositif ZSCE (Zones Soumises à Contraintes Environnementales) s’applique à des captages sensibles pour nitrates/pesticides.
- Modélisation et alertes : télérelève et outils d’aide à la décision :
-Acteurs : BRGM, services hydrologiques, Agences de l’eau, collectivités territoriales, entreprises technologiques fournissant capteurs/télémétrie.
-Statistiques : les systèmes de télérelève se développent, mais il existe des lacunes en couverture selon les territoires (zones rurales plus démunies). Des synthèses nationales de surveillance incluent ces outils. [8]
•Protection des captages et zones tampons
Cette technique vise à sécuriser la ressource en amont, réduire les pollutions diffuses ou ponctuelles, et préserver la qualité de l’eau prélevée.
- Délimitation réglementaire et actions agricoles sur les aires d’alimentation des captages (AAC) :
-Acteurs : collectivités, préfets, Agences de l’eau, Chambres d’agriculture, exploitants agricoles.
-Statistiques : la France compte environ 33 000 captages d’eau potable, dont ~1 500 à ce jour sécurisés selon les plans existants. De plus, près de 14 000 captages ont été fermés depuis les années 1980, beaucoup pour cause de pollution diffuse. [9]
-Résultats : dans les zones où les agriculteurs réduisent les intrants ou se convertissent au bio (comme certains territoires autour de Paris ou en Ille-et-Vilaine), on observe une baisse significative de la pollution (pesticides, nitrates) dans les captages.
- Mise en place de périmètres de protection, zones tampons physiques et barrières naturelles :
-Acteurs : collectivités locales, services de l’eau potable, BRGM, services de l’environnement.
-Statistiques : les zones tampons autour des captages protégés (PPC) sont plus souvent situées dans des sols agricoles ou urbains que les captages non protégés, ce qui montre la reconnaissance des zones à risque.
- Plans de gestion, prévention, financements & stratégies nationales :
-Acteurs : l’État (ministère de la Transition écologique), agences de l’eau, collectivités locales, Banque des Territoires, associations, agriculteurs.
-Statistiques : la feuille de route nationale pour la protection des captages prévoit un financement de 6,5 millions d’euros en 2025 dans le cadre d’Ecophyto 2030 pour soutenir les captages sensibles. On compte ~100 captages fermés chaque année pour pollution, mais seulement ~1 500 captages sur 33 000 considérés comme sécurisés. [10]
e. Environnement réglementaire
La gestion de l’eau en Bretagne s’inscrit dans un cadre multi-niveaux.
•Directive-Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) : établit l’objectif du “bon état” des masses d’eau, oblige la surveillance et la restauration.
•Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (2006) : fixe les responsabilités en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource.
•Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne : définit les orientations de gestion, d’actions prioritaires et de protection des nappes et cours d’eau du bassin.
•Rôle de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : acteur de financement, de régulation, de soutien technique et de planification. L’Agence opère via des délégations territoriales, dont la Délégation Armorique couvre le Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor. [11]
•Programmes d’intervention et aides : L’Agence de l’eau propose des aides pour la réduction des pressions, la maîtrise d’ouvrage locale, la surveillance…
f. Synthèse renforcée et limites de l’exploration
La salinisation des eaux douces en Bretagne apparaît comme le résultat d’un mélange de contraintes naturelles et anthropiques. La proximité de l’Atlantique offre une pression saline permanente, mais ce risque devient critique lorsque les nappes sont fragilisées par la surexploitation, les sécheresses ou une recharge insuffisante.
Les solutions proposées sont variées, mais aucune n’est universelle : leur efficacité dépend de la configuration locale (géologie, niveau de la nappe, usage). De plus, les données disponibles (contrôles, relevés, rapports) ne couvrent pas nécessairement tous les secteurs ou périodes, d’où l’importance de compléter avec des relevés de terrain.
III. Ecosystème visé
a. Politique
La gestion de l’eau en Bretagne s’inscrit dans un cadre politique européen, national et régional. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) impose aux États membres d’atteindre un “bon état écologique et chimique” des masses d’eau [12]. En France, cette directive est traduite dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), dont celui du bassin Loire-Bretagne [13]. La DREAL Bretagne souligne également que la région fait face à des spécificités majeures : nappes phréatiques réduites, forte pression agricole, littoral très sensible [14].
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a publié en 2019 un rapport sur la sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines [15]. Celui-ci met en lumière la vulnérabilité de zones comme la rade de Brest, la baie de Saint-Brieuc, Saint-Malo ou la côte des Légendes, où plus de 5 500 forages ont été recensés en zone à risque. Un seuil d’alerte est fixé à 800 μS/cm de conductivité électrique (ou 60 mg/L de chlorures) pour identifier les premiers signes de salinisation. Ces données ont pu orienter les politiques de gestion des forages et l’encadrement réglementaire des prélèvements.
Enfin, la politique agricole reste au cœur du problème : la Politique Agricole Commune (PAC) subventionne encore en partie les modèles productivistes exerçant une pression sur la ressource en eau [16]. Cependant, des programmes de transition agroécologique sont encouragés par les pouvoirs publics régionaux pour limiter les intrants (nitrates, pesticides) et préserver la qualité des ressources [17].
Les usages domestiques (jardins, piscines, appareils électroménagers) et les fuites dans les réseaux d’eau potable représentent une part importante de la consommation. Les choix politiques en matière de gestion des infrastructures conditionnent directement la lutte contre ce gaspillage.
b. Économique
Le coût de la production d’eau potable varie fortement selon la qualité de la ressource. Pour de l’eau douce faiblement salée, le coût moyen se situe autour de 0,3–0,7 €/m³ selon les méthodes de captation et de traitement classiques. En revanche, pour de l’eau issue du dessalement de l’eau de mer, le coût est beaucoup plus élevé, atteignant 0,65–1,8 €/m³ selon le procédé utilisé (distillation ou osmose inverse) [18]. Cette différence souligne la fragilité du modèle économique actuel si la salinisation des nappes s’intensifie, notamment dans les zones littorales vulnérables comme en Bretagne.
Le secteur agricole, premier consommateur d’eau en Bretagne, est directement concerné. L’Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB) rappelle que l’irrigation en période estivale dans les zones littorales accentue la baisse piézométrique et favorise l’intrusion saline [19]. À cela s’ajoutent les pics de consommation liés au tourisme, particulièrement dans les stations balnéaires, qui aggravent la pression sur les aquifères côtiers [20].
À long terme, la raréfaction de l’eau douce de qualité pourrait affecter la compétitivité de l’agriculture régionale, mais aussi le coût de la vie pour les habitants (factures d’eau plus élevées) et la durabilité des activités économiques dépendantes du littoral (conchyliculture, tourisme, agroalimentaire) [21]. Les collectivités locales, comme Eau du Ponant, mènent déjà des expérimentations pour la réutilisation des eaux usées traitées à des fins non alimentaires (hydrocurage, arrosage), dans une logique de réduction des coûts et de sécurisation de la ressource [22].
L’augmentation de la demande estivale (tourisme, agriculture irriguée) accentue les déséquilibres économiques. Le gaspillage d’eau représente un coût caché qui alourdit les factures des ménages et fragilise les secteurs dépendants du littoral.
c. Sociétal
Sur le plan sociétal, la qualité de l’eau est un sujet sensible en Bretagne. L’histoire des marées vertes liées aux excès de nitrates a marqué la population et reste une source de conflits entre riverains, associations et agriculteurs [23]. La salinisation, bien que moins visible, inquiète également car elle touche directement la potabilité de l’eau.
Certaines associations locales, comme Eau et Rivières de Bretagne, se mobilisent pour alerter sur les conséquences des pollutions diffuses (nitrates, pesticides, résidus médicamenteux) et pour défendre une gestion durable de la ressource [24]. D’autres initiatives, telles que les programmes éducatifs sur les corridors écologiques ou la sensibilisation des enfants à la biodiversité aquatique, contribuent à renforcer l’acceptabilité sociale de nouvelles politiques de gestion [25].
Par ailleurs, une étude de la DREAL Bretagne [26] souligne que la gestion quantitative de la ressource en eau est confrontée à des défis liés à la connaissance précise des prélèvements, notamment ceux effectués par les forages agricoles privés. La DREAL note que la collecte de données sur ces prélèvements est insuffisante, ce qui complique l’évaluation des pressions sur les milieux aquatiques et la mise en place de stratégies de gestion adaptées. Cette situation contribue à un climat social tendu autour de la répartition de l’eau.
Les habitudes de consommation d’eau des ménages, parfois peu économes, pèsent sur les ressources locales. La sensibilisation au gaspillage (robinets ouverts, douches longues, arrosages intensifs) est un levier culturel important pour réduire la pression sur les aquifères.
d. Technologique
Les avancées technologiques offrent des perspectives intéressantes pour mieux comprendre et gérer le phénomène d’intrusion saline. L’OFB (Office Français de la Biodiversité) a publié une fiche technique décrivant les outils de suivi : mesures de conductivité, modélisations hydrogéologiques, et techniques de géophysique pour caractériser l’interface eau douce / eau salée [27]. Ces méthodes permettent de détecter les phénomènes de “biseau salé” et d’anticiper les crises.
Le SIGES Bretagne (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines) propose également une cartographie interactive des zones vulnérables aux intrusions salines, qui intègre les paramètres géologiques (fractures, linéaments, altitudes inférieures à 15 m NGF, proximité du littoral) [28]. Cette base de données constitue un outil pour les collectivités et les gestionnaires de l’eau.
La recherche, elle, explore des approches innovantes comme la myco-restauration (utilisation de champignons pour dégrader certains micropolluants) , la réutilisation des eaux usées traitées [29] ou encore le développement de capteurs autonomes pour surveiller la qualité de l’eau en continu [30].
D’autre part, les technologies de détection de fuites dans les réseaux ou de suivi intelligent de la consommation (compteurs connectés) permettent de réduire le gaspillage. Leur diffusion plus large pourrait apporter un gain d’efficacité.
e. Environnemental
La Bretagne est particulièrement vulnérable aux changements environnementaux. Les aquifères y sont petits, discontinus et souvent fracturés, ce qui les rend plus sensibles aux intrusions salines que dans d’autres régions françaises. De plus, les projections climatiques montrent des étés plus secs et une baisse de la recharge naturelle des nappes phréatiques [3b1].La montée du niveau de la mer exerce une pression supplémentaire, accentuant la poussée de l’eau salée vers les nappes côtières [32]. Selon Science Ouest, certains forages côtiers atteignent déjà des conductivités de 800 à 1000 μS/cm, contre 300–400 μS/cm en moyenne [33]. La biodiversité aquatique est également menacée : les espèces migratrices (saumon, truite de mer, anguille) souffrent de la dégradation de la qualité de l’eau, tandis que des espèces plus tolérantes à la chaleur et à la salinité risquent de dominer [34].
Enfin, la pollution issue de l’agriculture reste un facteur aggravant majeur. Les intrants azotés et phosphorés favorisent les marées vertes et compromettent le bon état écologique des masses d’eau de surface [35]. Les micropolluants émergents (résidus pharmaceutiques, pesticides interdits mais persistants, microplastiques) compliquent encore la situation [36].
De plus, chaque mètre cube d’eau gaspillé augmente la pression sur des écosystèmes déjà fragilisés. La sobriété hydrique devient un impératif environnemental pour limiter l’aggravation des intrusions salines.
f. Légal
La DCE fixe les objectifs, mais la France a déjà été condamnée plusieurs fois pour non-respect des seuils de nitrates [37]. En Bretagne, la réglementation interdit en principe les forages trop proches du littoral (<1,5 km) ou à faible altitude (<15 m), mais la multiplication des puits privés ou agricoles rend son contrôle difficile [38].
Le Code de l’Environnement impose aux exploitants de forages de déclarer et mesurer leurs prélèvements, mais dans les faits, le suivi reste lacunaire, notamment dans le secteur agricole. Les stations d’épuration, quant à elles, ne sont pas encore équipées pour traiter les micropolluants (hormones, antibiotiques, PFAS), ce qui pose un vide réglementaire [39]. Certaines initiatives locales, comme les arrêtés préfectoraux de restriction d’usage en période de sécheresse, témoignent d’une gouvernance réactive mais fragmentée [40]. La montée en puissance d’outils de planification comme les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) pourrait renforcer la cohérence juridique et opérationnelle dans la région. [41]
IV. Justification du recentrage : l’enjeu de l’usage domestique de l’eau
Au fil de nos recherches, il est devenu évident que le verrou principal n’est pas uniquement la salinisation ou les intrusions d’eau de mer, mais la manière dont les usagers consomment l’eau. En d’autres termes, sensibiliser à la quantité et au bon usage de l’eau domestique s’avère être un levier fondamental pour atténuer la pression sur les ressources et changer le récit du “manque d’eau”.
Quelques constats et chiffres clés :
-
- En France, la consommation moyenne d’eau potable par personne est d’environ 148 litres par jour. [44]
- Cette consommation se répartit ainsi (pour un ménage moyen) :
• 39 % pour l’hygiène corporelle
• 20 % pour les chasses d’eau
• 22 % pour le linge et la vaisselle
• 6 % pour la cuisine
• 6 % pour l’arrosage ou nettoyage (voiture, jardin)
• 1 % seulement pour boire [45] - Sur le plan institutionnel, le Plan Eau français fixe comme objectif une réduction de 10 % des prélèvements à l’horizon 2030, ce qui dépend fortement de la maîtrise de la consommation des ménages. [46]
- Le rapport “Défi Sobriété Mobiliser les abonnés du service public d’eau” insiste sur l’importance de sensibiliser les usagers domestiques pour réduire collectivement les prélèvements sur le territoire. [47]
- Ce rapport mentionne aussi que les collectivités peuvent tirer parti du comptage individualisé pour fournir aux usagers un retour sur leur consommation, ce qui aide à mieux piloter les efforts de sobriété. [47]
- Le gouvernement note que méconnaissance des gestes efficaces et confusion entre actions symboliques et gestes réellement impactant constituent des freins réels dans l’adoption d’une consommation plus raisonnable. [46]
Pourquoi ce focus usager est fondamental pour notre projet :
-
- Impact direct et accessible : Modifier les usages domestiques (réduire les douches longues, réparer les fuites, optimiser les cycles de lavage, etc.) est une action concrète que chaque citoyen peut adopter cela génère des résultats immédiats et perceptibles à l’échelle locale.
-
- Allègement de la pression sur les nappes : En réduisant la demande intérieure, on diminue les besoins de pompage dans les nappes souterraines, donc la fragilisation de ces dernières face aux intrusions salines.
-
- Changement de narratif : Si l’eau vient à manquer dans certains secteurs, ce ne sera plus un problème uniquement technique ou naturel (salinisation, sécheresse), mais le reflet d’un déséquilibre entre offres et usages. En recentrant sur l’usage, on déplace le débat vers la responsabilité collective.
-
- Approche préventive plutôt que curative : Beaucoup d’efforts actuels sont consacrés à réparer (traitement, captages, rechargements, etc.). Le pilotage par les usages agit en amont, réduisant la nécessité d’interventions lourdes.
-
- Possibilité de suivi précis et personnalisé : Grâce aux technologies (capteurs, télérelève, interface d’aide à la décision), les usagers peuvent comprendre leur consommation, visualiser les économies potentielles, et ajuster leur comportement de façon éclairée.
V. Impact de l’étude sur notre problème initial
En définitive, si la salinisation reste un enjeu réel dans certaines zones littorales, elle n’est qu’une facette d’un problème bien plus vaste : la dégradation générale de la qualité des eaux douces en Bretagne. Cette évolution du problème est fondamentale : elle déplace le focus d’une solution potentiellement très technique et localisée vers une approche beaucoup plus informative et préventive.
Nous avons relevé un consensus entre les chercheurs : une solution purement technique, n’est pas viable mais elle réside dans un changement des modèles économiques, agricoles et des habitudes de consommation. Nous nous sommes d’abord interrogés sur la pertinence de cibler les agriculteurs ou les usagers. Pour les agriculteurs, des solutions techniques existent déjà, notamment grâce à des capteurs afin d’optimiser la qualité de l’eau ainsi que sa consommation.
C’est pourquoi nous avons choisi de réorienter notre réflexion vers les usagers. La gestion individuelle de la consommation domestique d’eau représente un réel problème, à la fois économique et énergétique. Notre projet s’appuie donc sur une solution informative, basée sur des capteurs de débit d’eau et des recommandations intelligentes, afin d’accompagner les citoyens dans une consommation plus responsable. L’objectif est double : sensibiliser à l’importance de préserver la ressource et offrir un outil concret pour réduire la consommation au quotidien. Notre réflexion a évolué d’une problématique centrée sur la qualité de la ressource à une problématique centrée sur la maîtrise de son usage. C’est en agissant sur les comportements quotidiens, soutenus par des outils de suivi intelligents, que nous pouvons espérer réduire la pression sur les eaux douces, ralentir les processus de dégradation des eaux et préserver durablement la disponibilité de l’eau potable en Bretagne.
Notre problématique : « Comment réduire la consommation excessive d’eau dans les foyers ? »
Nos hypothèses qui ont été le fil conducteur de nos interview :
-
-
- Hypothèse 1 : Les foyers n’ont pas conscience (ou une méconnaissance) de leur consommation détaillée d’eau utilisée lors de leurs gestes quotidiens
- Hypothèse 2 : Les utilisateurs seraient plus motivés à réduire leur consommation s’ils pouvaient visualiser en temps réel l’impact financier de leur usage
- Hypothèse 3 : Les propriétaires de plusieurs logements (bailleurs, résidences, colocations…) souhaitent suivre et comparer les consommations d’eau afin de détecter un quelconque problème ou surconsommation.
- Hypothèse 4 : L’adoption d’un capteur dépend de sa facilité d’installation et d’usage.
-
VI. Bibliographie
[1] : Région Bretagne, Document, 2019, Salinisation des eaux souterraines : Sensibilité des nappes bretonnes aux intrusions salines
[2] : Onema, BRGM, « Salinisation des masses d’eaux en France », Rapport, 2010, RP-59496-FR.pdf
https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-59496-FR.pdf
[3] : BRGM, « Rechargement des nappes phréatiques », 2015, Changement climatique : la recharge des nappes d’eau souterraines pourrait baisser de 10 à 25% en 2070
[4] : Le Monde, « Le dessalement, un marché en croissance, sauf en France », article, 2025, Le dessalement, un marché en croissance, sauf en France
[5] France 24, « Usines de dessalement d’eau de mer : un enjeu de sécurité nationale », vidéo, 2024, Usines de dessalement d’eau de mer : un enjeu de sécurité nationale – L’Entretien de l’intelligence économique
[6] Eau de France, « Les efforts de surveillance des eaux souterraines, synthèse, 2013, Les efforts de surveillance des eaux souterraines – Synthèse | Eaufrance
https://www.eaufrance.fr/publications/les-efforts-de-surveillance-des-eaux-souterraines-synthese
[7] SDES, « La pollution des eaux superficielles souterraines en France, article, 2025, La pollution des eaux superficielles et souterraines en France – Extrait du Bilan environnemental 2024 | Données et études statistiques
[8] Eau de France, « Les efforts de surveillance des eaux souterraines, synthèse, 2013, Les efforts de surveillance des eaux souterraines – Synthèse | Eaufrance
https://www.eaufrance.fr/publications/les-efforts-de-surveillance-des-eaux-souterraines-synthese
[9] APVF, « Protection des captages d’eau potable », article, 2025, Protection des captages d’eau potable : une feuille de route nationale à l’épreuve des territoires – APVF
Protection des captages d’eau potable : une feuille de route nationale à l’épreuve des territoires
[10] Le Monde, « Eau potale : les objectifs de protection des captages du gouvernement jugés décevants », article, 2025, Protection des captages d’eau potable : une feuille de route nationale à l’épreuve des territoires – APVF,
https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/03/28/eau-potable-les-objectifs-de-protection-des-captages-du-gouvernement-juges-decevants_6587259_3244.html
[11] Agence de l’eau Loire-Bretagne, info contact, Vos interlocuteurs de proximité – Agence – Agence de l’eau Loire-bretagne,
[12] Directive Cadre Européenne sur l’Eau (2000/60/CE),
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
[13] Agence de l’eau Loire-Bretagne, SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027,
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/sdage-2022-2027.html
[14] DREAL Bretagne, L’eau, un enjeu pour l’avenir de la Bretagne, 2020,
[15] BRGM, Sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines, 2019,
https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-69012-FR.pdf
[16] Cour des Comptes Européenne, La PAC et la protection de l’eau, 2021,
https://www.eca.europa.eu/fr/publications?did=58582
[17] PAC & conditionnalité environnement,
[18] FMES France, Le dessalement de l’eau de mer : Une solution de facilité face au stress hydrique au fort impact environnemental, janvier 2024,
[19] OEB, La salinité des eaux côtières et des océans en Bretagne, 2025,
[20] DREAL Bretagne, Intrusions salines – Journée Forages 2025, plaquette technique,
[21] BRETAGNE.BZH, Les enjeux de l’eau en Bretagne à l’horizon 2040,2016,
https://www.bretagne.bzh/app/uploads/rapport_eau.pdf
[22] Eau du Ponant, La réutilisation des eaux usées traitées, une première, 2025,
https://www.eauduponant.fr/fr/actualite/la-reutilisation-des-eaux-usees-traitees-une-premiere
[23] Inrae, Nitrates et marées vertes en Bretagne, 2019,
https://app.inrae.fr/app/uploads/2024/04/Algues_vertesV3_web.pdf
[24] Eau et Rivières de Bretagne, Rapport annuel, 2022,
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Rapport%20AG%202022%20-%202023_compressed.pdf
[25] Bretagne Vivante, Programme corridors de biodiversité, 2021,
https://www.bretagne-vivante.org/wp-content/uploads/2022/08/Plan-strate%CC%81gique-2021-2026.pdf
[26] DREAL, Étude sur la gestion quantitative de la ressource en eau en Bretagne, analyse de la pression de prélèvement, définition des volumes disponibles,2021,
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapportgq_drealbretagne_dec2021_vf.pdf
[27] OFB, Quels outils pour caractériser l’intrusion saline ?, 2021,
[28] SIGES Bretagne, Cartographie des zones vulnérables aux intrusions salines, 2025,
https://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Fiche-Ma-Commune.html
[29] DREAL Bretagne, Réutilisation des eaux usées traitées : enjeux et perspectives, 2022,
[30] CNRS/UBO, Capteurs autonomes pour la surveillance des eaux, 2023,
[31] OEB, Le changement climatique en Bretagne, 2015,
https://bretagne-environnement.fr/sites/default/files/imports/6a306228291b4d345d3069412abde712.pdf
[32] Science direct, Coastal groundwater salinization, 2016,
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716309214
[33] Science Ouest, Gare au sel qui s’infiltre !, 2018,
https://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/354/dossier/gare-au-sel-qui-s-infiltre
[34] ASLO, impacts of increasing salinity in freshwater and coastal ecosystems: Introduction to the special issue, 2023,
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lol2.10307?
[35] Agence de l’eau Loire-Bretagne, Surveillance des nitrates et phosphates, 2022,
[36] OEB, Les pesticides dans l’eau en Bretagne, 2025,
[37] CJUE, Affaires nitrates France/Bretagne, 2018,
https://www.eau-et-rivieres.org/nitrates-laffaire-du-siecle
[38] DREAL Bretagne, Recommandations sur les forages littoraux, 2025,
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/6-fevrier-2025-les-forages-d-eau-a5955.html
[39] INRAE, Micropolluants en sortie de station d’épuration : quels impacts sur la santé humaine et les milieux aquatiques ?, 2020,
[40] Préfecture du Finistère, Arrêtés sécheresse 2022-2023,
[41] SAGE Élorn, Gestion intégrée de la ressource en eau, 2022,
https://bassin-elorn.fr/nos-missions/sage-elorn/
[42] Observatoire de l’environnement de Bretagne, « Acidité, température et salinité des eaux côtières et océans en Bretagne », mai 2015, https://bretagne-environnement.fr/article/acidite-temperature-salinite-ocean-adaptation-climat-bretagne
[43] Site web ADIONICS, https://www.adionics.com/
[44] ADEME, L’eau, une ressource à préserver, 2023, Agir pour la transition+2info.gouv.fr+2
[45] Sispea, Comment économiser son eau, 2023, Comment économiser son eau | Observatoire Sispea
[46] Direction interministérielle de la transformation publique, Encourager la consommation d’eau des ménages, 2025 Encourager la réduction de la consommation d’eau des ménages | DITP
[47] AMORCE, Mobiliser les abonnés du service public d’eau par des campagnes de sensibilisation, 2025 EAT17-10_Fiche-action-10_Mobiliser-abonnes-service-public-eau-actions-sensibilisation.pdf
MAKER LENS – Etat de l’art
Maker Lens — État de l’art
Auteurs : Bérénice CARDOSO-FAUCHER, Pol TYMEN, Lucas REIS OLIVER, Divine BANON, Alex PEIRANO et Marc DUBOC — Contact : berenice.cardoso-faucher@imt-atlantique.net
1. Introduction
Près de neuf Français sur dix estiment que l’obsolescence programmée est une réalité, mais seuls 38 % déclarent faire réparer régulièrement leurs appareils électriques et électroniques lorsqu’ils tombent en panne [1]. Cette contradiction traduit un paradoxe central de notre société : d’un côté, une conscience grandissante des dérives de la consommation high-tech ; de l’autre, des pratiques quotidiennes encore ancrées dans le remplacement systématique.
Ce modèle a des conséquences lourdes : sur le plan environnemental, il génère une accumulation de déchets dangereux et un gaspillage de ressources rares ; sur le plan économique, il encourage une consommation à court terme ; et sur le plan social, il entraîne une perte progressive des savoir-faire liés à la réparation.
Face à ce constat, la démarche low-tech apparaît comme une alternative. Elle propose de concevoir des technologies utiles, accessibles et durables, centrées sur les besoins réels des utilisateurs, et non sur une logique d’innovation permanente. Encore peu connue du grand public, elle connaît néanmoins une structuration croissante : selon le Low-Tech Lab, plus de 800 projets low-tech étaient déjà recensés en 2024, allant d’outils simples pour la cuisson (marmite norvégienne, four solaire) à des dispositifs plus élaborés de gestion énergétique ou de mobilité [2].
Glossaire (acronymes)
- ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
- AREP : Architecture Recherche Engagement Post-carbone.
- RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.
- CSRD : Corporate Sustainability Reporting Directive (directive européenne sur le reporting de durabilité).
- AGEC : Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (France, 2020).
- DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.
2. Contexte
Origine et émergence du concept
Le concept de low-tech s’est véritablement formalisé dans les années 2010, en grande partie grâce aux travaux du Low-Tech Lab, association française fondée par Corentin de Châtelperron [3][4].
Celui-ci a largement contribué à populariser la démarche à travers son projet Nomade des Mers, un voilier transformé en laboratoire flottant parcourant le monde pour expérimenter et documenter des solutions low-tech adaptées aux besoins essentiels : cuisine, énergie, habitat, mobilité [5]. Son initiative a permis de rendre visible et concrète une philosophie qui, jusque-là, restait souvent cantonnée à des cercles d’ingénieurs, de bricoleurs ou de militants écologistes.
Cependant, les racines intellectuelles de la low-tech sont plus anciennes et remontent aux réflexions critiques sur la technologie des années 1970. Des penseurs comme Jacques Ellul, Ivan Illich ou encore André Gorz avaient déjà mis en garde contre une dépendance croissante aux technologies complexes, coûteuses et difficiles à maîtriser par l’utilisateur final [6][7][8]. Ellul parlait de “système technicien” auto-entretenu, Illich appelait à des “outils conviviaux” permettant l’autonomie des individus, tandis que Gorz insistait sur la nécessité de relier choix techniques et choix de société. Ces critiques ont ouvert la voie à une pensée technologique alternative, où la sobriété et l’appropriation par l’usager deviennent des critères fondamentaux.
Le terme low-tech, en tant que tel, apparaît dans la littérature scientifique et technique à partir des années 2000, principalement pour désigner des technologies simples, robustes, peu consommatrices en ressources et adaptées à des contextes contraints [9]. Son usage s’est progressivement consolidé en opposition explicite à high-tech, marquant ainsi une prise de distance avec l’idéologie dominante du progrès technologique illimité [9][10]. Pourtant, de nombreux acteurs, de la low-tech notamment (mais pas que), défendent une approche de complémentarité : la low-tech ne doit pas être opposée à la high-tech, mais envisagée comme une alliée possible dans la recherche d’un modèle technologique durable et équilibré [9][11].
Aujourd’hui, la démarche low-tech n’est plus portée uniquement par des individus isolés : elle s’appuie sur un réseau structuré de chercheurs, associations, fablabs et collectivités territoriales, qui cherchent à lui donner une véritable légitimité académique, politique et sociale [12]. Ce processus d’institutionnalisation témoigne de la montée en puissance du sujet dans le débat public, même si son intégration dans les politiques industrielles et économiques demeure encore limitée.
Démarche versus objets
Il convient de distinguer deux niveaux :
- la démarche low-tech, qui consiste à penser la conception sous l’angle de la sobriété, de la réparabilité, de l’appropriation par l’utilisateur et de la robustesse ;
- les objets low-tech, qui matérialisent cette démarche sous forme de solutions concrètes, reproductibles et adaptées à des besoins réels [13].
Cette distinction est essentielle car elle permet de comprendre que le low-tech ne se limite pas à des « bricolages », mais constitue un véritable paradigme de conception.
Le concept d’innovation frugale
La low-tech se rapproche de ce que l’on appelle l’innovation frugale, un concept notamment développé par l’ingénieur indien R. A. Mashelkar et popularisé par Navi Radjou [14]. Cette approche valorise la création de solutions simples, économiques et adaptées à des contextes de rareté des ressources. Si l’innovation frugale est souvent pensée pour des économies émergentes, la low-tech transpose ces principes aux pays industrialisés, en insistant sur la nécessité de sobriété volontaire et de réappropriation des technologies.
3. Parties prenantes
Les acteurs et médiateurs de la low-tech
La low-tech repose sur un écosystème d’acteurs variés dont les interactions favorisent la diffusion et la mise en œuvre concrète de la sobriété technologique. Ces acteurs, issus de milieux complémentaires, contribuent à la conception, à la transmission, à la démocratisation et à l’adoption des pratiques low-tech.
- Enseignement : enseignants, chercheurs et étudiants jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la culture low-tech. En intégrant des projets de conception durable, des ateliers de prototypage et des réflexions sur l’impact environnemental dans leurs cursus, ils préparent les futurs ingénieurs et citoyens à concevoir autrement. Les fablabs éducatifs et les écoles d’ingénieurs expérimentent également des projets concrets, reliant savoirs théoriques et pratiques responsables.
- Secteur privé : entreprises engagées dans la transition écologique — bureaux d’études, startups de réparation ou de réemploi — explorent de nouveaux modèles économiques basés sur la durabilité, la maintenance et la réparabilité. Les ingénieurs, consultants et responsables RSE adaptent les méthodes de production pour réduire les impacts environnementaux tout en répondant aux attentes sociétales et réglementaires.
- Collectifs et associations : structures citoyennes (fablabs, ateliers partagés, associations écologiques) qui rendent la low-tech concrète et accessible. Animateurs, médiateurs et bénévoles favorisent la transmission de savoir-faire, la réparation participative et la réappropriation des techniques par le grand public.
- Médiateurs et plateformes de diffusion : plateformes collaboratives, wikis, blogs, chaînes vidéo et communautés open source assurent la documentation et la diffusion des connaissances. Les rédacteurs et créateurs de contenu partagent tutoriels, plans, retours d’expérience et réflexions, permettant à chacun d’expérimenter et d’adapter les solutions low-tech localement.
- Utilisateurs : citoyens, artisans, bricoleurs, acteurs humanitaires ou collectifs de terrain incarnent la finalité du mouvement low-tech. En expérimentant, adaptant ou réemployant les solutions conçues, ils démontrent la viabilité des technologies sobres et renforcent leur ancrage dans la vie quotidienne. Leur retour d’expérience nourrit la communauté et guide l’évolution des projets.
Interactions entre les acteurs
Ces acteurs n’évoluent pas séparément : leurs interactions forment un véritable réseau. L’enseignement initie et forme, les collectifs et associations expérimentent et diffusent, les entreprises cherchent à traduire certains principes dans l’économie classique, les ressources digitales permettent la diffusion, et les utilisateurs réinventent. Toutefois, cette dynamique reste aujourd’hui asymétrique : les collectifs militants et les communautés citoyennes portent la majorité des initiatives, tandis que les entreprises et institutions éducatives ne s’impliquent encore que de façon marginale. Cette asymétrie explique en partie pourquoi l’image du low-tech demeure associée à des cercles spécialisés, ce qui alimente directement notre problématique centrale : comment élargir la démarche low-tech à des profils plus variés[12].
4. Écosystème
A) Analyse PESTEL
Politique
La question de la low-tech ne peut pas être envisagée sans prendre en compte sa dimension politique. Il s’agit à la fois d’un mot, d’une communauté et d’une démarche, tous porteurs d’une charge symbolique et normative qui dépasse le simple cadre technique.
- Une démarche et un mot intrinsèquement politiques
Le terme “low-tech” est en lui-même politisé : il renvoie à une volonté de rupture avec les logiques dominantes de croissance et d’innovation illimitée. Parler de low-tech, ce n’est pas seulement désigner un objet plus simple, c’est remettre en cause un imaginaire collectif centré sur le progrès technique et la complexité. De nombreux auteurs insistent sur le fait que la low-tech est d’abord une démarche politique avant d’être un catalogue d’objets [15]. La communauté qui s’en réclame est, par ailleurs, souvent militante, composée d’acteurs déjà sensibilisés aux enjeux écologiques et investis personnellement dans la promotion de la sobriété.
- Politiques publiques et cadres institutionnels
La Ville Low-Tech de l’AREP [16] montre comment ces démarches s’articulent avec l’économie sociale et solidaire, la relocalisation d’activités et la structuration de coopératives. De même, le Labo ESS [17] a publié un guide incitant les pouvoirs publics à soutenir l’autoconstruction, la réparation et la sobriété. Toutefois, ces initiatives restent marginales et contrastent avec les priorités nationales ou européennes, qui continuent de valoriser une “transition verte” largement techno-solutionniste et high-tech.
- Freins institutionnels et politiques
Malgré ces signaux positifs, le poids du low-tech dans les agendas politiques demeure limité. L’étude Recherche & Low-Tech de l’ADEME [12] note que la recherche dans ce domaine reste peu financée et peine à attirer des acteurs hors du milieu académique.
Economique
Les enjeux économiques de la low-tech doivent être analysés à plusieurs échelles (micro, macro, mondiale, individuelle), car les logiques de coût, de rentabilité et de structuration diffèrent fortement selon le niveau considéré.
- Échelle micro-économique : promesses et paradoxes
Les objets low-tech consomment généralement moins de ressources – matériaux, énergie, composants complexes – ce qui laisse supposer des coûts moindres en matière première et en fonctionnement. Cette sobriété, en réduisant les dépendances externes, constitue une promesse évidente. Un rapport de l’Armée de Terre (Épuisement des ressources : vers une armée de Terre low-tech) rappelle d’ailleurs que la dépendance à des équipements trop complexes ou énergivores fragilise la résilience opérationnelle [18]. Mais ce gain en robustesse se heurte à une limite importante : dès qu’il s’agit de passer à une fabrication industrialisée, les coûts unitaires deviennent rapidement élevés, car la production repose sur des processus locaux, des volumes réduits et une main-d’œuvre qualifiée. On retrouve ici un paradoxe constitutif du low-tech : une sobriété matérielle réelle, mais des coûts d’entrée parfois supérieurs à ceux des produits industrialisés en grande série [9].
- Échelle macro-économique : ESS et circularité
À l’échelle nationale et européenne, le low-tech s’inscrit dans des dynamiques collectives plus larges, comme l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’économie circulaire. Ces modèles favorisent la réparation, la relocalisation des activités, le réemploi des matériaux et une logique de durabilité. Des initiatives comme le Fairphone incarnent cette orientation : conçu pour être modulaire et réparable, il illustre la possibilité de développer un produit commercial compatible avec la philosophie low-tech [19][20]. Pourtant, ce type de produit reste une niche, plus coûteuse que les alternatives classiques, ce qui met en évidence la difficulté de faire entrer le low-tech dans un marché dominé par des logiques de prix bas et de volumes élevés [21]. Le rapport La Ville Low-Tech [16] insiste néanmoins sur la pertinence d’articuler la démarche avec l’ESS, qui fournit un cadre organisationnel adapté et peut compenser les faiblesses de rentabilité par des logiques coopératives et solidaires.
- Échelle mondiale : concurrence et trajectoires divergentes
À l’échelle globale, les projets low-tech se heurtent à une concurrence frontale avec le low-cost. Les produits industriels fabriqués massivement à bas prix dominent les marchés, et rendent difficile la percée de solutions sobres produites localement. Le rapport Démarches Low-Tech (ADEME) souligne ainsi que le retour sur investissement des initiatives low-tech est souvent trop long ou difficile à monétiser pour séduire les investisseurs classiques [9]. Les trajectoires divergent donc : alors que l’Europe tente d’intégrer l’éco-conception et la réparabilité dans ses réglementations, d’autres régions du monde privilégient au contraire une intensification high-tech de leur développement. Corentin de Châtelperron (Low-Tech Lab) rappelle toutefois que de nombreux pays plus pauvres pratiquent une forme de low-tech par contrainte, en valorisant réparation et débrouille au quotidien, même sans employer ce terme. Mais cette différence entre sobriété subie et sobriété choisie souligne bien l’ambiguïté du low-tech : est-il une contrainte des marges ou un choix stratégique des sociétés industrialisées [22] ?
- Échelle individuelle : apports économiques et limites
À l’échelle individuelle, les bénéfices économiques du low-tech sont réels : réduction des dépenses liées à l’énergie (chauffage, électricité), diminution des achats d’équipements neufs grâce à la réparation et au réemploi, possibilité d’accéder gratuitement à des tutoriels ou de fabriquer ses propres dispositifs. Ces logiques soutiennent également des micro-filières locales, comme les artisans réparateurs, les ateliers de bricolage partagé ou encore les services de location et de mutualisation. Pourtant, ces apports se heurtent à des contraintes pratiques : le temps nécessaire à la réparation ou à l’autoconstruction, l’effort d’apprentissage, l’accès parfois limité à des pièces détachées ou à des matériaux de qualité. Ainsi, malgré ses bénéfices à long terme, le low-tech est encore perçu comme un investissement initial coûteux ou chronophage, ce qui freine son adoption de masse.
Social
La dimension sociale de la low-tech est centrale : elle touche à la réappropriation des technologies, à leur désirabilité et à l’élargissement des communautés d’usagers.
- Réappropriation et accessibilité
Le manifeste du Low-Tech Lab définit une low-tech comme “utile, accessible et durable” [23]. Cette accessibilité vise à permettre à chacun de comprendre, réparer et reproduire un objet. C’est pourquoi la plupart des objets low-tech sont référencés en open-source, notamment dans les Fablabs. Pourtant, comme le montre l’article The user experience of low-techs, les usagers rencontrent des difficultés d’appropriation et d’adaptation, ce qui suppose un apprentissage et une médiation adaptés [24].
- Désirabilité sociale et freins culturels
Le rapport Démarches Low-Tech[9] souligne que la société valorise encore le high-tech, associé à la performance et au progrès. Dès lors, “faire simple” ou “faire moins” peut être perçu comme un recul. Le document Low-Tech, Just-Tech, Right-Tech (Bouygues Construction) [25] insiste sur le poids des mots : “low” évoque une connotation négative qui peut limiter l’adhésion.
- Communautés et inclusion
Les fablabs, ateliers de réparation et tiers-lieux jouent un rôle essentiel : ils constituent des espaces collectifs de transmission de savoir-faire, d’entraide et d’apprentissage. Toutefois, l’étude Recherche & Low-Tech [12] souligne que la communauté reste encore trop spécialisée et militante. Attirer des acteurs non académiques, des publics populaires ou éloignés de la “fabrique technologique” est crucial pour élargir la diffusion.
- Adhésion des jeunes générations
Les jeunes générations constituent un levier essentiel pour la diffusion de la démarche low-tech. Selon le CRÉDOC, leur préoccupation écologique atteint un niveau historiquement élevé : l’environnement s’impose depuis quelques années parmi les premières préoccupations des 18–30 ans, comme le montre la Figure 1 [26]. Toutefois, ces aspirations coexistent avec d’autres enjeux jugés plus urgents, comme l’emploi, le logement ou le coût de la vie. Cette compétition entre priorités contribue à expliquer le décalage entre sensibilité et passage à l’action, déjà observé dans leurs pratiques de consommation ou de mobilité. Dans cette dynamique, rendre les solutions sobres plus concrètes et attractives apparaît comme un enjeu clé : les jeunes ne rejettent pas la sobriété, mais ils peinent encore à la percevoir comme désirable et accessible.
Dans cette dynamique de médiation, la chaîne YouTube Hourrail promeut le train comme une alternative sobre à la voiture. Dans l’épisode consacré au “train low-tech”, Philippe Bihouix — directeur général d’AREP (filiale d’ingénierie du groupe SNCF, spécialisée dans la conception et la rénovation d’infrastructures comme les gares) et auteur de L’Âge low-tech — explique comment des solutions ferroviaires plus simples mais robustes, à fort maillage territorial, peuvent répondre efficacement aux besoins du quotidien tout en réduisant l’empreinte matérielle et énergétique ; et ce à moindre coût pour la SNCF et les régions. Selon lui, des trains low-tech, dotés de technologies éprouvées plutôt que de systèmes électroniques complexes, pourraient être remis en service plus rapidement sur les petites lignes régionales aujourd’hui délaissées [27].
- Accès universel et résilience en contexte de crise
La low-tech se distingue par sa capacité à rester utilisable dans des contextes de crise : guerres, catastrophes climatiques ou situations de grande pauvreté. Parce qu’elles nécessitent peu de ressources externes, ces solutions technologiques simples peuvent offrir une continuité d’usage essentielle (chauffage, mobilité, communication). Elles deviennent alors un outil de justice sociale et de survie, permettant l’accès aux technologies de base pour des populations souvent exclues des innovations high-tech.
Technologique
La technologie dans la démarche low tech occupe une place centrale, puisqu’elle conditionne à la fois l’accessibilité, la reproductibilité et la durabilité des solutions proposées.
- Recherche appliquée et expérimentation
L’ADEME rappelle dans son rapport Recherche & Low-Tech (2024) que la low-tech est avant tout une démarche de conception : concevoir des technologies utiles, sobres et appropriables suppose de tester en conditions réelles, d’impliquer les utilisateurs et de s’autoriser l’essai-erreur [12]. Le rapport Démarches Low-Tech (ADEME, 2022) souligne l’importance de “laboratoires vivants” dans lesquels écoles, entreprises et collectivités expérimentent des dispositifs simples, réparables et mutualisables, avant leur diffusion à plus grande échelle [9].
- Communautés open-source et diffusion des savoirs
Selon le Low Tech Lab, la réussite des low-tech dépend autant de la technologie que de sa documentation partagée : tutoriels, wikis et retours d’expérience permettent la reproduction libre de plus de cinquante solutions dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la mobilité ou de l’habitat [2][24]. Des plateformes telles qu’Instructables ou Open Source Ecology contribuent à cette diffusion en open-source, réduisant la dépendance industrielle et favorisant la co-conception locale [28][30]. La Fabrique Ecologique rappelle d’ailleurs que le partage des connaissances est une condition de légitimité : une technologie ne peut être dite “sobre” que si elle est compréhensible et réparable par le plus grand nombre [20].
- Innovation frugale et hybridations
La low-tech ne rejette pas les outils modernes : elle prône un usage modéré et pertinent du numérique. Comme l’indique le rapport de Bouygues Constructions (Low-Tech, Just-Tech, Right-Tech), certaines entreprises expérimentent des dispositifs mêlant matériaux simples et capteurs à faible consommation pour un suivi énergétique sobre et accessible [26]. Cette hybridation entre technologies avancées et frugalité matérielle esquisse le concept de « juste technologie » ou « right tech », centrée sur la robustesse et l’adaptation au besoin.
- Applications concrètes : énergie, mobilité et habitat
Les applications les plus prometteuses concernent la mobilité sobre : lignes ferrées régionales simplifiés, vélos ou véhicules modulaires réparables, solutions de recharge locales. L’ADEME et le Low Tech Lab mettent également en avant des innovations dans l’habitat : fours solaires, marmites norvégiennes, systèmes de ventilation naturelle ou filtres à eau low-tech [13][5]. Ces technologies montrent qu’il est possible de conjuguer efficacité et sobriété sans dépendre de systèmes complexes.
Environnemental
La dimension écologique influence fortement la conception et la mise en œuvre des innovations low-tech.
- Réduction des consommations
La première étape du cycle de vie low-tech consiste à réduire les flux de matière et d’énergie dès la conception. L’ADEME recommande de privilégier les matériaux biosourcés, locaux et faiblement transformés, et de limiter la multiplicité des composants [9]. Cette approche de sobriété “à la source” diminue la pression sur les ressources naturelles et anticipe la fin de vie du produit.
- Réutilisation des matières et objets
Le second pilier, la réutilisation, repose sur la remise en usage d’objets ou de composants existants. Des ateliers de réparation et ressourceries encouragés par l’ADEME et les collectivités locales prolongent la durée de vie des produits et stimulent l’économie de proximité [9]. Le Low-Tech Lab y voit un moyen de redonner du pouvoir d’agir à l’usager : la créativité remplace la consommation [24].
- Recyclage et circularité
En dernier recours, le recyclage transforme les déchets en ressources. Le projet Precious Plastic illustre cette logique circulaire : des machines open-source permettent de broyer, fondre et remodeler le plastique localement, réduisant les flux d’exportation [29]. L’ADEME rappelle toutefois que le recyclage n’a de sens que s’il s’inscrit dans une hiérarchie des priorités : réduire d’abord, réutiliser ensuite, recycler enfin [9].
- Vers une sobriété systémique
Enfin, la démarche low-tech vise une sobriété systémique : moins de dépendance énergétique, plus de résilience territoriale, et une cohérence entre dimensions sociales, économiques et environnementales. Pour la Fabrique Écologique, cette transition suppose de revoir nos critères de progrès : “le mieux-vivre doit primer sur le plus-produire” [20]. En réduisant les flux de matière et en réancrant la production dans les territoires, la low-tech devient un levier concret de transition écologique.
Légal
Les aspects juridiques sont essentiels pour encadrer la création, l’utilisation et la diffusion des solutions low-tech :
- Open source et licences
La plupart des projets low-tech s’appuient sur des modèles open source, permettant le partage des plans, logiciels et tutoriels. Cependant, le choix de la licence détermine les conditions de réutilisation, de modification et de redistribution, et peut limiter ou faciliter la diffusion des innovations.[31]
- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
Cette directive européenne impose aux entreprises de rendre compte de leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour les projets low-tech intégrés dans des structures industrielles ou associatives, la CSRD peut influencer la conception et la documentation des produits, afin d’assurer transparence et conformité[32].
- Autres évolutions législatives récentes
L’interdiction de l’obsolescence programmée (France, 2015), la loi AGEC et son index de réparabilité, tout comme la directive européenne CSRD sur le reporting extra-financier, créent un environnement plus favorable aux démarches low-tech. Ces évolutions législatives contribuent à institutionnaliser des principes de réparabilité, d’éco-conception et de durabilité [12].
- Responsabilité
La responsabilité juridique est un aspect clé dans le développement et l’usage des solutions low-tech. Selon les parties prenantes — particuliers, structures associatives ou entreprises — la responsabilité peut incomber soit à l’individu (responsabilité civile personnelle), soit à la structure (responsabilité de l’organisation) en cas de dommages liés à l’utilisation ou à la diffusion d’un produit. Il est donc essentiel de respecter les normes de sécurité, d’informer correctement les utilisateurs et, le cas échéant, de souscrire des assurances adaptées pour limiter les risques légaux.
B) De l’état de l’art à nos choix (validation d’hypothèses)
| Hypothèse initiale | Ce que dit l’état de l’art [refs] | Résultat | Décision produit |
|---|---|---|---|
| Nous pouvons viser « tout le monde ». | La diffusion passe par des relais (école, fablabs) et des publics cadrés [12][23]. | Précisée | Cible prioritaire : enseignants & fabmanagers (préparation d’ateliers, séquences). |
| Le manque de ressources est le frein principal. | La ressource existe (wikis, tutos), mais mal agrégée et/ou peu contextualisée [2][28][30]. | Invalidée | Positionnement Maker Lens = agrégateur qualifié + parcours guidés. |
| L’IA d’identification d’objet est nécessaire pour inspirer l’usager. | Les freins sont surtout culturels/usage (désirabilité, médiation) plus que techniques [9][12][25]. | Invalidée | Abandon de la reco visuelle → outil pédagogique centré “matériau” et “besoin”. |
5. Problématique et solution
A) Le constat
À travers notre enquête terrain nous constatons que la démarche frugale et la low-tech restent encore enfermés dans une niche.Il existe une multitude de sites et de tutoriels qui proposent des solutions pratiques, mais ceux-ci s’adressent principalement à un public déjà convaincu : des passionnés de bricolage ou des personnes sensibilisées aux questions écologiques. Cette limitation vient en grande partie de l’image qui colle à la low-tech, souvent réduit à une vision « bobo-écolo ».
Pour les étudiants en ingénierie et en formation technique, l’approche low-tech n’est pas perçue comme un domaine porteur. Leur intérêt se porte prioritairement sur des projets à forte valeur ajoutée technologique et innovante, ce qui relègue les démarches frugales au second plan.
Les Fab managers cherchent à transmettre une démarche fondée sur la frugalité et l’ingéniosité. Toutefois, ils rencontrent des difficultés à mobiliser l’attention des participants et à faire reconnaître la valeur et l’importance de ces savoirs au sein de leurs activités.
Chez les enseignants, le manque de temps et d’outils pédagogiques freine une intégration plus large de l’approche low-tech dans les cursus. Ils se trouvent également confrontés à un public d’élèves profondément ancré dans la culture numérique, pour qui cette approche peut sembler dépassée, voire dénuée de pertinence.
Face à ces constats, une question centrale émerge : Comment attirer des profils plus variés à l’approche frugale ?
B) Notre réponse
Pour répondre à cette problématique, notre projet Maker Lens a évolué pour devenir un outil pédagogique pensé spécifiquement pour les enseignants et les responsables de FabLab, identifiés comme les principaux relais de la culture low-tech. Nous avons abandonné l’idée d’une reconnaissance d’objet par l’image, partant du principe que l’utilisateur sait déjà ce qu’il a sous la main. L’application se recentre sur l’inspiration et la mise en relation, en proposant deux parcours distincts :
1. Le parcours « matériau » : que faire avec ce que j’ai ?
L’utilisateur (un enseignant préparant un atelier, par exemple) renseigne un objet ou un matériau dont il dispose (ex : bouteilles en plastique, chambre à air, palettes de bois). L’application lui propose alors une sélection de projets low-tech réalisables à partir de cette ressource.
2. Le parcours « besoin » : comment fabriquer ce dont j’ai besoin ?
L’utilisateur exprime un besoin ou un objet qu’il souhaite obtenir (ex : un four solaire, un système d’arrosage automatique, une éolienne). L’application lui suggère alors différents tutoriels et approches low-tech pour le construire, en détaillant les matériaux nécessaires.
Dans les deux cas, Maker Lens fonctionne comme un agrégateur de ressources qualifiées. La véritable valeur ajoutée n’est pas de créer de nouveaux tutoriels, mais de centraliser et d’organiser l’existant. Chaque sortie est un lien vers un site web, une documentation ou une vidéo (Low-tech Lab, Instructables, etc.) qui détaille les étapes de fabrication. En fournissant un outil clé en main qui facilite la recherche d’idées et la préparation de cours ou d’ateliers, nous visons à équiper les « transmetteurs » pour qu’ils puissent plus facilement diffuser la démarche frugale auprès d’un public plus large.
C) Projets existants
Si notre projet Maker Lens a fait le choix de ne pas recourir à une identification par intelligence artificielle, privilégiant une approche pédagogique et manuelle, il est pertinent de situer notre démarche par rapport à l’état de l’art technologique. Les projets suivants illustrent comment la vision par ordinateur est aujourd’hui utilisée pour identifier des objets dans une logique de tri ou de recyclage. Ils soulignent, par contraste, la spécificité de notre approche centrée sur l’utilisateur et ses intentions (créer ou recycler) plutôt que sur l’automatisation.
-
- WasteNet (MIT) [33] — Projet de recherche exploitant la vision par ordinateur pour identifier automatiquement différents types de déchets (plastique, métal, verre) et faciliter leur tri, dans une perspective d’optimisation des processus de recyclage à grande échelle.
-
- Recyc’IA (INRIA) [34]— Prototype français utilisant l’intelligence artificielle pour reconnaître des objets du quotidien et guider l’utilisateur vers les filières de recyclage adaptées, contribuant ainsi à renforcer la traçabilité et la sensibilisation environnementale.
-
- ImageNet for Waste [35]— Bases de données d’images annotées dédiées à la classification d’objets et de déchets, utilisées pour entraîner des modèles de détection open source et améliorer la précision des systèmes de reconnaissance automatique.
-
- Google AutoML Vision [36]— Outils de reconnaissance visuelle personnalisables permettant de détecter et de catégoriser des objets selon des besoins spécifiques, y compris des initiatives de réemploi ou de valorisation des matériaux.
-
- Carton Recognition (Alibaba Cloud) [37]— Application de détection automatique des emballages visant à améliorer le tri logistique, la traçabilité et la réutilisation des cartons dans les chaînes d’approvisionnement.
-
- Recycleye (UK) [38]— Startup britannique spécialisée dans la vision artificielle appliquée au tri des déchets, dotée de caméras et d’IA capables d’identifier des matériaux recyclables en temps réel sur les lignes industrielles.
-
- NVIDIA Jetson DIY Projects [39]— Projets communautaires exploitant les modules d’IA embarquée Jetson pour détecter des objets et développer localement des applications de réemploi et de recyclage à faible coût.
6. Références
- [1] Ifop pour le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), Les Français et la réparation des appareils électriques et électroniques, 2018. | ecologie.gouv
- [2] Low-Tech Lab, « Les Low-tech dans le monde », 2025. | lowtechlab.org
- [3] Low-Tech Lab, « Historique – Le Low-Tech Lab à ses origines », 2014. | lowtechlab.org
- [4] Gold of Bengal, « 2009>2020 : Site Musée », 2020. | goldofbengal.com
- [5] Low-Tech Lab, Nomade des Mers : 5 ans d’exploration des innovations low-tech – Dossier de presse , Juin 2021. | lowtechlab.org
- [6] Ellul, Jacques, Le Système technicien , Paris : Calmann-Lévy, 1977.
- [7] Illich, Ivan, La Convivialité , Paris : Editions du Seuil, 1973.
- [8] Gorz, André, Ecologie et liberté , Paris : Galilée, 1977.
- [9] ADEME, Démarches « LOW-TECH » : Etat des lieux et perspectives – Rapport final » , Mars 2022. | librairie.ademe.fr
- [10] Europe 1, « Low-tech en opposition à high-tech : des innovations simples qui s’inspirent de la nature », 2024. | europe1.fr
- [11] L’Opinion, « High-tech et low-tech, complémentaires, selon Chanel », 2024. | lopinion.fr
- [12] ADEME, Recherche & low-tech : premiers éléments de réflexion, Juillet 2024. | librairie.ademe.fr
- [13] ADEME, « La démarche Low-Tech : qu’est-ce que c’est ? [exemple du vélo][0.55 à 1.21] », Octobre 2023. | youtube.com
- [14] Navi Radjou, Jaideep Prabhu & Simone Ahuja, L’innovation Jugaad : redevenons ingénieux ! , Editions Diateino, 2013.
- [15] Low-Tech Journal, « La low-tech : une écologie dépolitisée ? », 2024. | lowtechjournal.fr
- [16] Lopez C., Le Bot N., Soulard O., Detavernier P., Heil Selimanovski A., Tedeschi F., Bihouix Ph., Papay A., La Ville Low-Tech, ADEME (Agence de la Transition Écologique) – Institut Paris Région – AREP (Agence de Recherche et d’Expertise Pluridisciplinaire, groupe SNCF), 2021. | institutparisregion.fr
- [17] Labo de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), Vers une politique publique low-tech à l’échelle urbaine – Guide pratique, 2022. | ess-europe.eu
- [18] Académie de Défense de l’école militaire (ACADEM) – Réflexions libres, Épuisement des ressources et limites de l’hypertechnologisme : vers une armée de Terre low-tech, 2024. | defense.gouv.fr
- [19] La Fabrique Ecologique, Vers des technologies sobres et résilientes : Pourquoi et comment et développer l’innovation « low-tech » ?, Avril 2019. | lafabriqueecologique.fr
- [20] Carbo,« Low tech : la sobriété technologique au service d’une société durable », 2024. | hellocarbo.com
- [21] Novethic,« Fairphone : le pionnier militant du smartphone durable à grande échelle », 2023. | novethic.fr
- [22] Reporterre, « De la sobriété imposée à la sobriété choisie », 2016.
- [23] Low Tech Lab, « Le manifeste du Low-tech Lab : pour un avenir low-tech ! », Mai 2019. | lowtechlab.org
- [24] Clément Colin, Antoine Martin, The user experience of low-techs: from user problems to design principles. Journal of User Experiences, 2023, 18 (2), pp.68-85. | hal.science
- [25] Bouygues Construction, Low-tech, Just-tech, Right-tech…de nouvelles approches pour les villes et territoires, Juillet 2023. | bouygues-construction.com
- [26] CRÉDOC (Centres de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie) (pour l’ADEME), Environnement : les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes, Consommation & Modes de Vie n° 308, décembre 2019. | credoc.fr
- [27] Hourrail, «Le train doit-il devenir low tech ? Avec Philippe Bihouix (AREP) », YouTube, Septembre 2025. | youtube.com/@Hourrail
- [28] Open Source Ecology, Global Village Construction Set, 2022.
- [29] Precious Plastic, Machines open source pour recycler localement le plastique, 2023.
- [30] Instructables, DIY Projects Database, instructables.com
- [31] Code Gouv DINUM, Licences libres pour les codes sources publics, code.gouv.fr
- [32] Portail RSE Gouv.fr, CSRD : comprendre la directive européenne et ses enjeux pour la durabilité, 2024.
- [33] Recycleye, WasteNet Dataset and Vision System, 2024. | recycleye.com
- [34] INRIA, Intelligence Artificielle et Environnement – Recyc’IA, 2024. | inria.fr
- [35] TACO Dataset, Trash Annotations in Context, 2023. | tacodataset.org
- [36] Google Cloud, AutoML Vision / Vertex AI – Documentation, 2024. | cloud.google.com
- [37] Alibaba Cloud, AI & Computer Vision Solutions (Carton Recognition), 2024. | alibabacloud.com
- [38] Recycleye, Vision AI for Waste Sorting, 2024. | recycleye.com
- [39] NVIDIA Developer Blog, Detecting Waste Contamination Using Edge Computing (Jetson), 2023. | developer.nvidia.com
Cailloux – État de l’art – Le défi de l’Érosion côtière : Un enjeu majeur pour le littoral
Etat de l’art du projet : Cailloux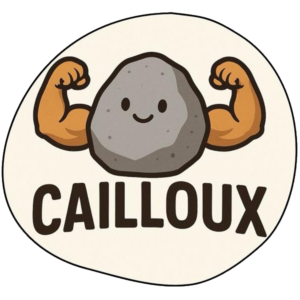
- Présentation du problème
- Le défi de l’Érosion côtière : Un enjeu majeur pour le littoral français
En France, le littoral constitue un patrimoine naturel et économique d’une richesse inestimable. Il abrite une variété d’écosystèmes fragiles, des villes dynamiques et des activités touristiques essentielles. Cependant, plusieurs kilomètres de côtes reculent chaque année sous l’effet conjugué de phénomènes naturels (marées, tempêtes, montée du niveau de la mer), mais en grande partie des activités humaines (aménagements, urbanisation, fréquentation touristique). Effectivement, près de 1 720 km de côtes sont concernés par des problématiques d’érosion, avec un recul parfois supérieur à 0,5 mètre par an (Réseau National des Observatoires du Trait de Côte, 2025). Ce phénomène de recul progressif du trait de côte, entraîne des répercussions directes sur les écosystèmes naturels, les infrastructures humaines et l’économie locale. Compte tenu de l’importance du littoral français, il apparaît aujourd’hui essentiel de développer des solutions innovantes et durables afin de lutter efficacement contre cet aléa (GIP Littoral, 2021-a).
- Une approche collaborative des acteurs de la lutte : tous contre un
L’érosion du littoral est un problème transversal qui touche quasiment tous les acteurs de la société allant des populations jusqu’aux institutions étatiques. En effet, l’érosion côtière ne concerne pas qu’une seule partie prenante, mais un écosystème d’acteurs aux rôles variés et complémentaires. Ces acteurs travaillent main dans la main dans l’élaboration des stratégies locales qui constitue également un moment privilégié d’échange et de partage entre acteurs sur les objectifs de gestion de la bande côtière pour le court, le moyen (2040) et le très long terme (2100) ainsi que de coordination des actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Parmi les acteurs concernés, nous avons identifié 5 types d’acteurs différents : les administrations, les affectés, les scientifiques, les engagés et les assurances. Nous définissons ci-dessous ces différentes catégories :
- Les administrations
De nombreuses institutions publiques sont directement concernées par la gestion des risques naturels. Elles interviennent à différents niveaux : local, départemental, régional et national.- A l’échelle locale : les communes :
Les communes, à travers les mairies, sous-préfectures et préfectures, jouent un rôle essentiel avant, pendant et après la survenue d’un risque.En amont, elles informent la population, intègrent les risques dans la planification communale et organisent les dispositifs de secours. En situation de crise, elles coordonnent les opérations d’urgence.
Le maire est informé par le préfet des risques naturels majeurs présents sur son territoire communal par le biais des PAC (Porter à connaissance) et du DDRM (Dossier départemental des risques majeurs) et ce conformément aux articles L.121-2, R.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme (Légifrance, 2025), articles R.125-10 et R.125-10 et R.125-11 du Code de l’environnement (Légifrance, 2023). - A l’échelle départementale : les administrations publiques déconcentrées :
C’est une direction départementale interministérielle (DDI). En tant qu’administration déconcentrée de l’État, elle gère les politiques publiques liées à la mer et au littoral (réglementation maritime, aménagement du littoral, gestion des ports, etc.) à l’échelle d’un département, comme le Finistère. Son rôle est crucial pour l’application des lois et la coordination des actions sur le terrain. Leurs expertises techniques et réglementaires permettent d’avoir une vision réaliste des contraintes et des opportunités. - A l’échelle régionale : Les Conseil Généraux et Régionaux :
Les conseils régionaux et généraux ne possèdent pas de compétences particulières en matière de gestion des risques naturels majeurs. Les conseils généraux participent toutefois au financement des SDIS (Services départementaux d’incendie et de secours). Il établit les orientations et politiques pour la lutte contre l’érosion par l’adaptation des territoires au recul du trait de côte (GIP Littoral, 2021-a).
- À l’échelle nationale : le Conservatoire du littoral :
Le Conservatoire du littoral en tant que gestionnaire et/ou propriétaire d’espaces naturels littoraux mènent des actions majeures pour la bonne gestion des espaces naturels. Dans le cadre de ses actions, il intègre les questions relatives à la gestion de la bande côtière dans le respect de politiques et de stratégies de gestion définies nationalement et localement.
- A l’échelle locale : les communes :
- Les affectés : Les citoyens et propriétaires riverains :
Les citoyens et propriétaires installés à proximité du littoral sont les premiers touchés par l’érosion côtière. Le recul du trait de côte met en péril leurs habitations, résidences secondaires ou locaux professionnels, entraînant souvent une forte dévaluation, voire une perte totale des biens. Ces dommages ne sont généralement pas couverts par le régime d’assurance « catastrophe naturelle », ce qui accroît leur vulnérabilité.
Depuis la loi du 16 septembre 1807, article 33 (Légifrance, 1807), la protection contre l’érosion relève de la responsabilité du propriétaire. Cette règle, peu adaptée aux enjeux actuels du changement climatique, fait peser une charge financière importante sur les particuliers et alimente les tensions entre citoyens, collectivités et État.
- Les scientifiques et les chercheurs :
Ces professionnels du domaine travaillant dans les laboratoires de recherche contribuent à la compréhension comme l’érosion du trait de côte, la surveillance du littoral et la mise au point de politiques publiques adaptées. Par leurs recherches, ils apportent leur expertise et disposent de données qu’ils partagent avec les autres institutions en vue de concilier la lutte et d’avoir une vision plus profonde du problème. Leurs données, pertinentes et explicatives, permettent une meilleure visualisation de l’impact du phénomène et participent également au développement de solutions pour lutter contre ce phénomène. Ils travaillent dans les laboratoires et centre comme l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) qui est l’un des pôles majeurs de recherche marine en France et spécialisé dans les sciences de l’environnement marin, aussi le LETG-Brest (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique), équipe de l’UMR LETG (Laboratoire créée en 1996 par le CNRS pour regrouper les recherches menées en géographie sur les trois sites universitaires Nantes, Brest, Rennes) à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) spécialisé dans l’étude les dynamiques géomorphologiques et risques côtiers, l’occupation des sols et la fréquentation des usages (LETG-Géomer – Université de Bretagne Occidentale, s.d.) ainsi que l’Observatoire Osirisc (Observatoire Scientifique Intégré des Risques Côtiers) dédié à la surveillance et à la compréhension des risques côtiers comme l’érosion et la submersion marine. Ils fonctionnent en collaboration avec d’autres structures comme le conseil départemental du Finistère et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) pour une efficacité maximale (Risques Côtiers, s.d.).
- Les engagés
Face à l’intensification du recul du trait de côte, de nombreux acteurs publics, techniques et associatifs se mobilisent. Ils interviennent à des niveaux complémentaires, depuis la production de connaissances scientifiques jusqu’à la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain. Ensemble, ils forment le cœur opérationnel de la stratégie nationale de gestion du littoral : les engagés.- Acteurs publics et techniques
Ces acteurs constituent les principaux leviers de la lutte contre l’érosion. Leur expertise scientifique, technique et réglementaire permet d’éclairer les décisions publiques et d’accompagner les collectivités dans leurs politiques d’adaptation.
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) : c’est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Il fournit une expertise scientifique et technique aux collectivités et à l’État. Son rôle est crucial pour la réalisation de cartes de projection de l’érosion, l’analyse des risques et le développement de solutions d’aménagement durable. Le Cerema est l’une des sources de données les plus fiables sur le sujet (Cerema, s. d.-a).
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : C’est le service géologique national. Le BRGM mène des recherches sur les risques naturels (dont l’érosion côtière), les ressources souterraines et les eaux. Il a un rôle d’observation, de modélisation et d’expertise pour l’État et les collectivités. Il est notamment impliqué dans le suivi de l’évolution du trait de côte et dans la connaissance des dynamiques sédimentaires (BRGM, 2024).
Comité national du trait de côte (CNTC) : créé en 2012, c’est une instance de dialogue et de coordination qui rassemble les acteurs publics (État, collectivités territoriales) et les acteurs de la société civile. Son rôle est de faire avancer la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion du trait de côte (Contributeurs aux projets Wikimedia, 2024).
Les structures collaboratives (Adapto, Pacco, Sea’ties, Littoral en commun) (Conservatoire du Littoral, s.d.-a) : ce sont des programmes ou des réseaux qui facilitent l’échange d’expériences et la mise en œuvre de projets pilotes. Par exemple, Adapto est un programme du Conservatoire du Littoral qui vise à restaurer des espaces naturels pour qu’ils puissent s’adapter aux changements climatiques, tandis que Sea’ties se concentre sur les villes côtières..
- Associations et défense de l’environnement
Les associations environnementales jouent un rôle complémentaire, en ancrant la lutte contre l’érosion dans une dimension citoyenne et écologique.
Bretagne Vivante et France Nature Environnement (FNE) Bretagne (Bretagne Vivante, 2025) : Ces associations de protection de la nature jouent un rôle de plaidoyer, de sensibilisation et de veille citoyenne. Elles alertent sur les conséquences de l’érosion et de l’aménagement du littoral sur les écosystèmes et la biodiversité. Elles participent également aux instances de dialogue et peuvent apporter une expertise de terrain sur l’état des milieux naturels.
- Acteurs publics et techniques
- Les assurances:
En France, les assurances jouent un rôle central dans la gestion des conséquences de l’érosion du trait de côte, mais ce rôle demeure limité. En effet, contrairement aux inondations ou aux tempêtes, l’érosion progressive n’est pas reconnue comme une catastrophe naturelle, ce qui prive de nombreux propriétaires d’une indemnisation. Cette situation fragilise particulièrement les territoires littoraux, d’autant que les coûts liés aux événements climatiques augmentent fortement avec le changement climatique (Échanges Assurance, 2023).
Pour répondre à ce défi, les pouvoirs publics et les assureurs cherchent à faire évoluer le système. La loi Climat et Résilience de 2021 a renforcé l’anticipation des risques, notamment par la cartographie des zones exposées au recul du trait de côte (GIP Littoral, 2021). Toutefois, la soutenabilité financière du secteur assurantiel reste menacée : la montée du niveau de la mer et l’intensification des tempêtes accélèrent les phénomènes d’érosion, ce qui pourrait mettre en question l’efficacité des mécanismes actuels. (Echanges Assurance, 2023)
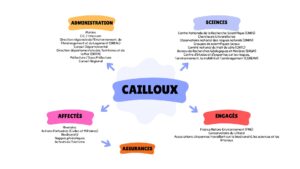
Figure 1 : Cartographie et Interactions Acteurs
- Les administrations
- Le défi de l’Érosion côtière : Un enjeu majeur pour le littoral français
- Écosystème visé
- Politique
- Protection du littoral
Deux types de mesures de protection du littoral sont mises en place : des outils réglementaires et des actions concrètes. Des lois comme la Loi Littorale (Ministère de la Transition écologique, 2022) ou la Loi Climat et Résilience (DREAL, Bretagne, 2025) mentionnent les obligations liées à l’aménagement, l’urbanisme et la prévention des risques dans les territoires concernés par le risque d’érosion côtière. Concernant les actions concrètes, plusieurs projets ont été menés sur différentes communes afin d’expérimenter des solutions fondées sur la nature telles que la végétalisation des dunes ou la restauration de marais et des méthodes plus “dures” telles que l’installation de digues ou d’épis (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a).
- Politiques d’adaptation
L’érosion du trait de côte représente un risque socio-économique important, notamment à cause de l’urbanisation des littoraux et de l’attrait des populations pour ces zones. Les bâtiments situés à proximité immédiate de la côte risquent d’être touchés par le recul du trait de côte, ils seront donc évacués et détruits : les estimations réalisées indiquent qu’en 2028, près de 1000 bâtiments, principalement résidentiels et commerciaux seraient concernés par cette problématique, ce qui représente un budget de 240 millions d’euros, et en 2050, ce seraient 5200 logements et 1400 locaux d’activités qui seraient affectés pour une valeur de 1,2 milliard d’euros (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a). Les politiques d’adaptation sont donc indispensables pour gérer au mieux les conséquences de ce phénomène. Elles passent par de la sensibilisation (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a), mais également par la maîtrise de l’urbanisme grâce à la Loi Climat et Résilience (DREAL, Bretagne, 2025).
- Coopération transfrontalière
La coopération transfrontalière est nécessaire pour faire face à l’érosion du trait de côte et à ses conséquences. En Europe, plusieurs programmes contribuent à la mise en commun de ressources techniques, financières et juridiques, tels que le programme Interreg, encourageant la collaboration des territoires européens (Interreg Maritime, s. d.). Ce programme finance notamment le projet PACCo, un projet visant à promouvoir l’adaptation aux changements côtiers en France et Angleterre (Programme Interreg VA France-Manche-Angleterre, s. d.).
La coopération transfrontalière permet de dépasser les limites administratives, mais nécessite la plupart du temps une gouvernance multi-niveaux, associant Union Européenne, États, collectivités locales et autres acteurs (entreprises, scientifiques…), pour assurer la souveraineté territoriale de chaque territoire engagé et la cohésion des espaces transfrontaliers (Philizot, F., Desforges, C., Pommier, A., & Inspection générale de l’administration, 2022).
- Souveraineté politique
Face à l’accélération des phénomènes d’érosion côtière, les enjeux de gouvernance territoriale prennent une dimension stratégique. De plus, la pression exercée par les risques littoraux redéfinit les rapports entre l’État et les collectivités locales :
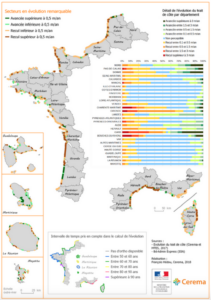 Figure 2 : L’évolution du trait de côte en France
Figure 2 : L’évolution du trait de côte en France
Cette situation oblige les collectivités locales à adapter leurs politiques d’aménagement et à élaborer des plans de prévention des risques littoraux, sous peine de perdre des portions de territoire et de voir leur autonomie décisionnelle réduite (Gouvernement, 2022).
L’érosion du trait de côte en Finistère touche 120 km de côtes, ce qui représente une quarantaine de communes. Dans ces zones, la prévention passe par l’intégration de ces problématiques dans les documents de planification et d’urbanisme, par exemple : Scot, PLUi. Chaque acteur a un rôle défini dans la gestion de cet aléa, aussi bien les propriétaires que les élus locaux ou encore l’État (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021).
- Protection du littoral
- Economique
- Extinction des ports (Hachemi, K., Thomas, Y.-F., Senhoury, A. O.-E.-M., Achek-Youcef, M., Ozer, A., & Nouacer, H. A, 2014) :
Les ports actuels possèdent des infrastructures conçues en relation avec le niveau de la mer actuel et ne sont généralement pas adaptables. Les pontons, par exemple, sont construits directement à hauteur de mer et certains se retrouvent déjà inondés à marée haute à cause de la montée du niveau moyen des eaux. La solution la plus souvent adoptée consiste alors en des rénovations de rehaussement, mais celles-ci sont généralement coûteuses et à court terme dans la mesure où l’eau continue de monter. À terme, cette montée pourrait remettre en question l’existence de la majorité des infrastructures côtières et limiter la répartition à quelques villes. - Prix des digues (Observatoire de l’environnement en Bretagne, s. d.-a) :
Les digues et les autres constructions de protection contre la montée du niveau de la mer présentent de nombreux désavantages, le plus important de tous étant leur coût. Une digue en enrochement, par exemple, coûte 1,8 millions d’euros par kilomètre et un épis 2 500 euros par mètre (Horizons, L, 2023). Un prix qui dépend aussi de la hauteur de l’édifice, lequel risque de devoir être rehaussé au fil des années. Ces échelles de prix ne sont pas atteignables par la plupart des petites communes du littoral et sont pourtant souvent à la charge de leurs mairies. Ils n’incluent d’ailleurs pas les frais d’entretiens qui peuvent monter jusqu’à 5% du prix de construction (Horizons, L, 2023). Toutes ces contraintes dissuadent souvent les mairies de s’engager vers ce genre de solutions. Elles favorisent alors des méthodes plus douces, moins chères et souvent plus efficaces comme nous le verrons en partie D. - Impact sur le tourisme (Barry, 2016 ; Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-b)
Le secteur touristique représente environ 64 % des 525 000 emplois liés à l’économie maritime en France (Statistique publique de l’énergie, des transports, du logement et de l’environnement, 2024). Les stations balnéaires, hôtels, campings, restaurants et activités nautiques sont au cœur de cette dynamique.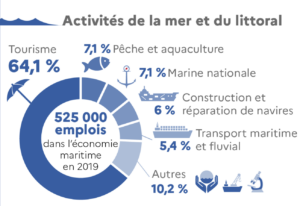 Figure 3 : Activités de la mer et du littoral
Figure 3 : Activités de la mer et du littoral
L’érosion menace directement des milliers de bâtiments et infrastructures touristiques. Selon une étude du Cerema et comme énoncé précédemment, d’ici 2028, près de 1 000 bâtiments, principalement résidentiels et commerciaux, pourraient être affectés, représentant une valeur de 240 millions d’euros (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a).
L’érosion affecte également la fréquentation touristique. Des sites emblématiques, tels que Étretat, accueillent plus d’un million de visiteurs annuels, contribuant à l’accentuation de l’érosion (Gouvernement, 2023). Cette pression touristique peut entraîner une dégradation des sites, réduisant ainsi leur attractivité et, par conséquent, les revenus générés.
Face à ces enjeux, des investissements sont nécessaires pour protéger les zones littorales. Par exemple, la commune de Lacanau en Gironde a évalué le coût potentiel de l’érosion pour la région Nouvelle-Aquitaine entre 8 et 17 milliards d’euros d’ici 2050 (Mayer, C., 2024). Des mesures telles que la construction de digues, la végétalisation des dunes et la désimperméabilisassion des sols sont envisagées pour limiter les impacts.
- Dévalorisation foncière (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024 ; Cerema, s. d.-a) :
L’érosion du trait de côte provoque une perte progressive et durable de valeur pour les biens immobiliers situés en bord de mer. Cette dévalorisation repose sur plusieurs mécanismes : d’abord, l’augmentation du risque physique (inondation, recul du rivage, submersion) rend les terrains plus vulnérables et donc moins attractifs. Ensuite, l’incertitude sur la pérennité des constructions engendre une instabilité du marché immobilier, car les acheteurs hésitent à investir dans des zones dont la viabilité est compromise (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024). À cela s’ajoutent les coûts élevés liés aux mesures de protection, comme les digues, l’entretien ou même la relocalisation, qui réduisent la rentabilité d’un bien (Horizons, L, 2023). Enfin, les contraintes réglementaires mises en place pour limiter l’urbanisation littorale dans les zones exposées pèsent sur les possibilités d’aménagement et diminuent directement la valeur marchande.
Au-delà des pertes individuelles, le problème soulève des questions collectives. L’urbanisation croissante des littoraux a concentré populations et activités dans des zones fragiles, ce qui amplifie la vulnérabilité du patrimoine foncier. Comme le souligne Fonciers en débat (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024), certaines zones peuvent même perdre définitivement leur valeur du fait de la disparition physique du terrain, tandis que d’autres ne conservent une valeur que grâce à des investissements permanents en protection. Les collectivités sont alors confrontées à un dilemme : protéger à grands frais ou accepter la relocalisation, avec des conséquences sociales et économiques importantes (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024)
En résumé, l’érosion littorale entraîne une véritable érosion financière, qui se manifeste à plusieurs échelles : la perte de valeur pour les particuliers, la fragilisation des marchés immobiliers, et la pression budgétaire croissante pour les territoires côtiers. Cette dynamique, qui s’intensifie dans les prochaines décennies, place la question du littoral au croisement des enjeux écologiques, fonciers et économiques.
- Opportunités ingénierie côtière (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021 ; Contributeurs aux projets Wikimedia, 2024 ; Horizons, L., 2023) :
L’ingénierie côtière offre des leviers concrets pour transformer la menace de l’érosion en opportunités d’adaptation et d’innovation territoriale. Plutôt que de subir passivement le recul du trait de côte, les collectivités et acteurs du littoral peuvent investir dans des solutions techniques, organisationnelles et foncières pour anticiper et accompagner la transformation. Parmi les dispositifs possibles, les ouvrages protégés (digues, enrochements, brise-lames, perrés) permettent de stabiliser localement le littoral et de réduire l’énergie des vagues. (Préfet du Finistère, s.d.).
Par ailleurs, les techniques de rechargement de plage (réensablement artificiel) consistent à amener du sable ou des sédiments pour compenser les pertes liées à l’érosion, reconstituer un profil de plage plus protecteur, et maintenir les usages (plage, promenade) tout en réfléchissant la houle loin du rivage (Contributeurs aux projets Wikimedia, 2024). Cette approche “douce” est souvent privilégiée dans les zones où les contraintes environnementales ou paysagères rendent l’installation d’ouvrages lourds peu envisageable.
Dans le cas du Finistère, l’étude du trait de côte mentionne que la côte est composée de segments d’accumulation, de plages, de dunes, mais aussi de zones d’ablation, ce qui impose une approche différenciée selon les secteurs (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021). Cela signifie que l’ingénierie doit être adaptée localement, ce n’est pas une solution unique mais un bouquet de solutions modulables selon la morphologie, la sédimentation et les contraintes naturelles.
L’article “Aléas naturels et transformation des littoraux” (Thomas, B., & Débat, F. E., 2024) insiste sur des outils fonciers nouveaux qui peuvent s’inscrire dans une démarche d’ingénierie globale. Par exemple, on peut geler la constructibilité dans les zones les plus exposées, procéder à la déconstruction progressive des parcelles menacées, puis reconfigurer l’usage de ces espaces (restauration écologique, zones tampons) pour absorber le recul littoral. Le 6 avril 2022, le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC) a été créé. Ce bail peut être consenti par l’État, une commune ou un groupement de communes, un établissement public pour une occupation temporaire des terrains jusqu’à ce que le recul devienne critique, puis une restitution à la nature (Horizons, L., 2023).
En combinant l’ingénierie physique (ouvrages, rechargement) avec des stratégies foncières et réglementaires innovantes, on peut concevoir des territoires littoraux résilients. Même si ces solutions ne suppriment pas le risque, elles offrent une voie proactive pour que l’érosion n’impose pas un effondrement du patrimoine littoral, mais soit intégrée dans la dynamique de transition du territoire. - Refus d’assurer / coûts assurance(Combe, M., 2022) :
L’érosion côtière soulève un défi majeur pour le secteur assurantiel, car ce risque n’est pas couvert par le régime français des catastrophes naturelles. Concrètement, lorsqu’un bien est menacé par le recul du trait de côte, les propriétaires ne peuvent pas prétendre à une indemnisation, contrairement à ce qui existe pour les inondations ou les tempêtes (Combe, M., 2022).
Face à cette situation, les compagnies d’assurance se trouvent en difficulté. D’un côté, elles doivent tenir compte d’un risque croissant, difficile à estimer dans le temps et dans l’espace. De l’autre, elles savent que certaines zones littorales seront inévitablement perdues à long terme. Dans ce contexte, de nombreux assureurs refusent tout simplement de couvrir les biens concernés ou appliquent des primes plus élevées, assorties de franchises et d’exclusions. Pour les propriétaires, cela signifie que certains logements deviennent quasiment inassurables, ce qui renforce leur perte de valeur et complique toute perspective de revente.
Les conséquences dépassent le cadre individuel. L’absence de couverture assurantielle pèse sur la stabilité des marchés immobiliers littoraux, limite l’accès au crédit, les banques étant réticentes à financer des biens non assurables, et accentue la vulnérabilité économique des collectivités. Face à cette impasse, plusieurs rapports plaident pour une refonte du système de mutualisation des risques climatiques, afin d’intégrer des mécanismes spécifiques à l’érosion côtière et de ne pas laisser les ménages seuls face à un risque dont la fréquence et l’intensité vont s’accroître (Combe, M., 2022).
- Extinction des ports (Hachemi, K., Thomas, Y.-F., Senhoury, A. O.-E.-M., Achek-Youcef, M., Ozer, A., & Nouacer, H. A, 2014) :
- Social
Lors de la définition d’une stratégie locale, il convient d’examiner l’ensemble des scénarios classiques (protection rigide, protection souple, laisser évoluer naturellement…), mais aussi les options consistant à déplacer, supprimer ou relocaliser les enjeux situés dans la bande d’aléa, ainsi que leurs combinaisons spatiales et temporelles (par exemple : protéger dans un premier temps puis opter pour un repli).
Le déplacement ou la relocalisation des enjeux doit être envisagé lorsque tout ou partie des conditions suivantes sont réunies : existence d’un intérêt public, caractère déplaçable ou ponctuel de l’enjeu, présence d’habitations isolées ou dispersées (zones à très faible densité), exposition à un aléa fort ou très fort, ou encore mise en danger du patrimoine par la mise en place d’aménagements de protection active (GIP Littoral, 2021-b).
- Déplacement des populations (Minsitère de la transition écologique, 2022 ; DREAL, Bretagne, 2025 ; Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., n.d.) :
En France, l’érosion côtière est devenue une menace tangible pour des milliers de résidents littoraux, contraints à envisager le déplacement de leur habitat face à la montée des eaux et au recul du trait de côte. Ce phénomène, amplifié par le changement climatique, affecte particulièrement les communes du littoral atlantique et méditerranéen, où les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent désormais intégrer des zones d’exposition au recul du rivage. La loi Climat et Résilience de 2021 a introduit des dispositions inédites, comme la possibilité pour les communes de créer des zones d’aménagement résilient, où les constructions peuvent être interdites ou soumises à des conditions de démolition anticipée (GIP Littoral, 2021-a). Ce cadre juridique, bien que ambitieux, soulève des enjeux sociaux majeurs : comment accompagner les familles déplacées, préserver leur lien au territoire, et éviter une fracture entre les zones protégées et celles sacrifiées. Le déplacement des populations ne se limite donc pas à une question technique ou environnementale, mais devient un défi de solidarité territoriale, de justice sociale et de mémoire collective.
- Perte de patrimoine(Devillers, B., Benlloch, P. O., & Castanyer, P., 2021) :
La perte du patrimoine liée à l’érosion côtière en France constitue une dimension souvent négligée mais profondément symbolique du phénomène. En menaçant les sites historiques, les lieux de mémoire collective et les espaces culturels emblématiques (Devillers, B., Benlloch, P. O., & Castanyer, P., 2021), l’érosion ne se contente pas d’altérer le paysage : elle efface des fragments d’identité territoriale. De nombreuses communes ont vu des bâtiments centenaires, des villas balnéaires ou des chapelles se retrouver en zone à risque, parfois condamnés à la démolition ou à l’abandon. Ce recul du trait de côte soulève des dilemmes patrimoniaux : faut-il déplacer un monument ? Le laisser disparaître ? Ou le documenter avant sa perte ? Ainsi, la disparition de ces repères culturels ne se mesure pas seulement en mètres de côté perdus, mais en mémoire effacée, en identité fragilisée, et en rupture du lien entre les habitants et leur territoire (Centre de Ressources Pour L’adaptation Au Changement Climatique, s.d.-a). - Conflits d’usage (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020) :
Les conflits d’usage liés à l’érosion côtière en France traduisent une tension croissante entre les différents acteurs du littoral, chacun porteur d’intérêts parfois contradictoires. À mesure que le trait de côte recule, les espaces disponibles se réduisent, exacerbant les rivalités entre usagers récréatifs (plagistes, surfeurs, promeneurs), acteurs économiques (pêcheurs, restaurateurs, promoteurs immobiliers), et gestionnaires environnementaux (parcs naturels, conservatoires du littoral). Par exemple, dans des communes comme Lacanau ou Saint-Jean-de-Luz, la volonté de préserver les plages pour le tourisme entre en conflit avec les impératifs de protection des dunes ou de relocalisation des infrastructures. Le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine, dans sa stratégie régionale, souligne que ces conflits doivent être anticipés par une gouvernance partagée, impliquant les collectivités, les citoyens, les services de l’État et les acteurs privés (GIP Littoral, 2021-a). De plus, la loi Climat et Résilience introduit des outils comme les zones d’aménagement résilient et les stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC), qui visent à concilier les usages tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes (GIP Littoral. 2021-a). Ces dispositifs, bien qu’encore en phase d’expérimentation dans plusieurs territoires, posent les bases d’un dialogue territorial essentiel pour éviter que l’érosion ne devienne un facteur de division sociale et économique.
- Déplacement des populations (Minsitère de la transition écologique, 2022 ; DREAL, Bretagne, 2025 ; Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., n.d.) :
- Technologique
- Technologies d’adaptation (épi, murs, enrochements) (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021 ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016) :
Les technologies d’adaptation regroupent les technologies de compromis, de protection et de repli. Certaines peuvent être complémentaires, d’autres concurrentes :
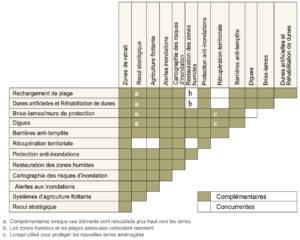 Tableau 4 : Les technologies d’adaptation complémentaires et concurrentes
Tableau 4 : Les technologies d’adaptation complémentaires et concurrentes
Solutions d’urbanisation : les nouveaux lotissements sont construits plus loin des côtes, les anciens bâtiments sont rénovés de sorte à ce qu’ils soient plus adaptés (rehaussement du rdc, isolation à l’humidité, au sable…).
Solutions dures : des digues, épis ou encore brise-lames peuvent empêcher complètement localement la montée de l’eau tant qu’il n’y a pas de débordement par le dessus ou par les côtés. Ces solutions sont chères et nécessitent d’être étendues ou rehaussées si l’eau continue à monter, de la maintenance régulière. De plus, elles peuvent parfois faillir. Dans certains cas, elles peuvent aussi avoir l’effet inverse de celui attendu (Observatoire de l’Environnement de Bretagne, s.d.-a).
Solutions douces : la réhabilitation de la nature du littoral empêche partiellement la submersion et l’érosion mais pas complètement. Il n’est plus respectueux de la biodiversité et de l’environnement que les digues. (barrières d’arbres, recouvrage de branches, cordon de galets, recharge en sable…) Acteur impliqué en Bretagne : Le Conservatoire du littoral (Observatoire de l’Environnement de Bretagne, s.d.-a).
- Technologie de suivi :
Les technologies de suivi sont indispensables à la prévention des risques liés à l’érosion du trait de côte et à l’adaptation des territoires, puisqu’elles permettent à la fois de suivre l’évolution du recul côtier au cours du temps, mais également de détecter les changements géomorphologiques, sédimentaires ou encore écologiques localement et sur une échelle de temps plus réduite. Dans le cadre de l’érosion côtière, les technologies de suivi sont multiples, notamment en raison des nombreuses causes et conséquences de l’érosion (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016).
- Résistance des matériaux :
Différents matériaux résistants à l’eau peuvent être utilisés dans le cadre de la recherche de solutions “dures”, des matériaux naturels tels que la pierre, l’ardoise ou le bois résistant au pourrissement et d’autres types tels que le béton, le fer ou le métal. Lorsque des solutions “douces” sont privilégiées, les “matériaux” sont les zones humides, les arbres ou encore le sable et ils s’avèrent plus résistants que les éléments énumérés ci-dessus (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016).
- Technologies d’adaptation (épi, murs, enrochements) (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021 ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016) :
- Environnemental
- Biodiversité littorale (Barry, 2016) :
Les côtes bretonnes présentent une diversité animale et végétale remarquable. Si la montée des eaux n’est pas un problème de même envergure pour ces espèces que la pression de l’urbanisme et du tourisme, elle reste un facteur aggravant dans la mesure où elle reforme le terrain à grande vitesse. De plus, une destruction de cette diversité serait en tant que telle un facteur d’érosion car les algues et plantes côtières permettent l’absorption de surplus d’eau, peuvent permettre de stabiliser une dune et dans certains cas atténuent les fortes houles (Observatoire de l’Environnement de Bretagne, s.d-b). - Nappes phréatiques (Barry, 2016) :
La montée générale du niveau de la mer peut mener à des conséquences indirectes inattendues. Par exemple, elle peut entraîner la salinisation des réserves d’eau souterraines et donc impacter l’agriculture de la région. Le phénomène peut se produire par deux processus :
– Par l’infiltration d’eau de mer directement dans la nappe
– Par remontée de la nappe en surface sous pression de l’eau de mer (Littoral de la Manche, 2025)
Ces changements ont des conséquences sur la qualité de l’eau de consommation, celle utilisée pour l’agriculture et par une grande quantité d’espèces de plantes. Ils causent aussi une détérioration de la qualité des sols. Les conséquences indirectes de la montée des eaux se retrouvent donc dans tous les secteurs d’activité et sur toute la surface de la région côtière (France Environnement s.d.). - Augmentation de la fréquence des niveaux marins extrêmes (Cyven, 2024) :
Un des problèmes majeurs pour les riverains d’une côte en recul est le fait que la mer présente un niveau changeant selon les moments de la journée et surtout selon la météo. En effet, certaines marées extrêmes, certaines tempêtes ou fortes houles ont parfois pour effet un débordement d’eau de mer sur une certaine surface du rivage qui peut parfois s’étendre jusqu’à des zones habitées. Les causes suivent des schéma très chaotiques et sont donc très difficile à prévoir et les conséquences sont souvent très dommageable pour les habitants du littoral (inondation, dégradation des infrastructures, pollution marine du littoral…). Malheureusement, il est prévu que la hausse générale du niveau de la mer ait pour effet une augmentation significative de la fréquence de ces évènements dans les prochaines années. Jusqu’à une multiplication par cent d’ici la fin du siècle. Et le rapprochement de la mer vers les zones urbanisées rendrait leurs dommages d’autant plus conséquents. Il s’agit donc aussi d’un enjeu social et économique majeur (IHE Delft Institute For Water Education, s.d.).
- Biodiversité littorale (Barry, 2016) :
- Légal
- Statut des réfugiés :
L’érosion côtière constitue un aléa majeur menaçant directement les habitats et les biens des populations riveraines. Le recul du trait de côte entraîne la destruction de logements et d’infrastructures, provoquant des déplacements parfois permanents, qui peuvent générer ce qu’on appelle des « réfugiés climatiques » (Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., n.d.). Ces populations déplacées nécessitent un encadrement juridique spécifique, car le droit international des réfugiés ne reconnaît traditionnellement pas les catastrophes environnementales comme motif de protection(Interreg Maritime, s. d.). La France et l’Union européenne doivent donc adapter leurs cadres légaux pour garantir l’accès à des mesures de protection, de relogement et d’assistance sociale. Les collectivités locales jouent un rôle clé en intégrant les risques littoraux dans les documents d’urbanisme (PLUi, SCoT) pour anticiper ces migrations et définir des zones de relocalisation sécurisées, tout en respectant les droits des personnes concernées. La coordination avec l’État et les établissements publics fonciers permet de mobiliser le foncier nécessaire, en assurant un statut juridique clair pour les habitants déplacés (Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G., s.d.). L’absence de cadre légal pourrait accroître la précarité des populations exposées et créer des conflits fonciers avec des zones non exposées (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020). De plus, l’artificialisation des sols aggrave le phénomène, car elle réduit les espaces naturels tampons, essentiels à l’accueil des populations déplacées (Cerema, s.d.-a). Les politiques d’adaptation doivent donc combiner protection juridique, urbanisme préventif et résilience territoriale, pour garantir à la fois la sécurité des personnes et la continuité de leurs droits fondamentaux. Enfin, des solutions juridiques innovantes, comme des régimes de préemption ou des baux adaptés, peuvent être mobilisés pour encadrer la relocalisation de ces populations (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020).
- Loi Littoral (3 janvier 1986) :
La loi Littoral a pour objectif principal de protéger les espaces naturels, les paysages et l’équilibre écologique du littoral français. Elle impose une protection graduée selon la proximité avec le rivage, limitant les constructions dans les zones les plus exposées aux phénomènes d’érosion et de submersion marine (Cerema, s. d.-a). Les communes littorales doivent adapter leurs documents d’urbanisme, tels que les PLU et les SCoT, pour encadrer la densification et le développement économique tout en préservant la résilience des territoires (Cyven, 2024 ; La librairie ADEME, s.d.). Cette loi interdit la fixation systématique du trait de côte par des ouvrages en dur, sauf nécessité technique impérative, favorisant des solutions douces basées sur la nature (Ministère de la Transition écologique, 2023). Elle encadre également les infrastructures existantes, telles que les ouvrages portuaires ou de défense, pour minimiser leur impact sur les dynamiques hydrosédimentaires et la biodiversité (Combe, M. 2022). L’approche préventive de la loi contribue à limiter l’exposition des populations à long terme, en intégrant l’érosion et le recul du trait de côte dans les stratégies locales (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère, 2021) . En combinant planification territoriale et protection des milieux naturels, elle offre un cadre juridique pour concilier développement économique et gestion durable du littoral. Les documents d’urbanisme doivent ainsi prendre en compte non seulement les risques immédiats, mais aussi les projections à 30 ou 100 ans. Enfin, la loi Littoral sert de base à l’élaboration de plans de prévention des risques littoraux (PPRL), instruments essentiels pour limiter l’exposition aux aléas côtiers (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2016 ; Gouvernement, 2022).
- Loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN) :
La loi Zéro Artificialisation Nette vise à stopper la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Sur le littoral, cette politique est essentielle pour réduire la pression foncière dans les zones exposées à l’érosion et à la submersion marine. La renaturation des terrains artificialisés abandonnés permet de restaurer des fonctions écologiques, telles que la régulation des flux hydriques et la protection des sols contre l’érosion. L’observatoire de l’artificialisation mis en ligne en 2019 fournit des données détaillées sur la progression de l’urbanisation, facilitant l’identification des zones vulnérables. En limitant l’expansion urbaine dans les bandes littorales à moins de 500 mètres de la mer, la loi contribue à préserver les espaces tampons naturels, indispensables pour absorber l’impact des tempêtes et du recul du trait de côte (Cerema & GéoLittoral,2023). Elle favorise également des stratégies locales d’intensification urbaine, permettant de loger la population tout en limitant l’emprise sur les sols. L’artificialisation passée ayant saturé certains secteurs littoraux, le ZAN encourage le réemploi des friches et des logements vacants (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020). Enfin, l’application du principe ERC (Éviter, Réduire, Compenser) permet de concilier développement et protection environnementale, contribuant à la résilience du littoral face aux effets du changement climatique.
- Loi Climat et Résilience (22 août 2021) :
La loi Climat et Résilience inscrit la gestion des risques côtiers et l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques. Elle fixe comme objectif l’absence de toute artificialisation des sols d’ici 2050 et la réduction de moitié du rythme de consommation des espaces sur 2021-2031. Les communes exposées au recul du trait de côte doivent réaliser des cartes prospectives à 30 et 100 ans, intégrant ces projections dans les PLUi et SCoT. Cette approche permet de limiter l’urbanisation dans les zones à haut risque et de planifier la relocalisation stratégique d’infrastructures et d’habitations. La loi introduit de nouveaux outils fonciers, tels que le droit de préemption ou le bail réel d’adaptation. Les établissements publics fonciers peuvent ainsi acquérir des terrains pour anticiper l’érosion et mettre en œuvre des projets de protection ou de relocalisation (Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R., 2020). En parallèle, les mesures GEMAPI donnent aux collectivités la compétence pour gérer les ouvrages de défense contre la mer et les inondations de manière cohérente. L’objectif est de favoriser des territoires résilients, capables de s’adapter aux aléas côtiers sans accentuer les impacts environnementaux (Cerema, s.d.-a). Cette loi complète et renforce la loi Littoral et les dispositifs ZAN, offrant un cadre juridique global pour la prévention, la planification et la gestion durable des littoraux français (Légifrance, 2023).
- Statut des réfugiés :
- Politique
- Conclusion sur le PESTEL
L’analyse PESTEL de l’érosion côtière met en évidence un phénomène à la fois environnemental, social et politique, révélateur des fragilités du modèle d’aménagement littoral. Politiquement, la gouvernance reste morcelée malgré les efforts de coordination entre État, collectivités et organismes techniques. Économiquement, les pertes foncières et l’absence de couverture assurantielle adaptée accentuent les inégalités territoriales.
Sur le plan social, la relocalisation forcée et la perte du patrimoine local questionnent la justice et la résilience des communautés côtières. Les avancées technologiques offrent de nouveaux outils de suivi et d’aménagement, tandis que les initiatives environnementales cherchent à restaurer les écosystèmes naturels comme barrières protectrices. Enfin, le cadre juridique, encore marqué par la responsabilité individuelle, évolue lentement vers une approche plus collective et préventive du risque.
L’érosion côtière apparaît ainsi comme un défi global nécessitant une réponse intégrée, conciliant connaissance scientifique, solidarité territoriale et adaptation durable des zones littorales.
- Avancée par rapport au problème initial
L’état de l’art a permis d’enrichir notre compréhension du phénomène d’érosion côtière et de préciser les contours de notre étude. Cette partie revient sur les principaux ajustements apportés au cadre de recherche : le choix de la zone géographique, la validation ou la reformulation des hypothèses, ainsi que l’évolution de la problématique initiale. Elle met en évidence comment notre réflexion s’est structurée au fil de l’analyse bibliographique.
- Evolution de la zone géographique :
Sans connaissance préalable du sujet, il nous était difficile d’identifier si la problématique serait spécifique à une zone ou généralisable à l’ensemble du littoral. Il nous était donc difficile de statuer sur une zone. Pour autant, nos recherches nous ont rapidement permis de nous focaliser sur le problème localement : en Bretagne. La richesse des données disponibles a confirmé la pertinence du choix de la Bretagne comme territoire d’étude.
Notons par ailleurs que l’enquête terrain nous permettra de confirmer ce premier choix.
- Evolution des hypothèses :
Nos hypothèses initiales étaient les suivantes :
Hypothèse 1 : L’érosion est un enjeux sociétal
Hypothèse 2 : Augmentation de l’érosion avec le réchauffement climatique
Hypothèse 3 : Les politiques d’aménagement et de gestion durable peuvent limiter et atténuer les effets de l’érosion
Hypothèse 4 : L’érosion modifie durablement les écosystèmes et impacte la biodiversité
Nos recherches bibliographiques ont confirmé notre première hypothèse : l’érosion est effectivement un enjeux sociétal. Elle touche de nombreux territoires, impacte l’économie, la biodiversité et la gouvernance des zones concernées. Ce phénomène ralentit le tourisme sur les littoraux, détruit certains habitats, et demande une adaptation locale de l’ensemble des politiques existantes.
La seconde hypothèse a également été validée par notre état de l’art. Les conséquences du réchauffement climatique, notamment la montée des eaux, amplifient le phénomène d’érosion du trait de côte. Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (s.d.-a)
La troisième hypothèse, portant sur les politiques d’aménagement, reste ouverte : les stratégies actuelles sont multiples mais parfois insuffisamment coordonnées, d’où la nécessité d’enquêter localement sur leur efficacité réelle. Nous profiterons de l’enquête terrain pour obtenir de nouveaux éléments sur cette conjecture.
Enfin, la relation entre érosion et biodiversité s’est révélée plus complexe que prévu : la dégradation des milieux accélère l’érosion, tandis que la préservation des écosystèmes côtiers agit comme une forme de défense naturelle. La dernière hypothèse a été confirmée : l’érosion dégrade les écosystèmes et entraîne une perte de biodiversité. Inversement, la biodiversité joue un rôle protecteur face à l’érosion ; sa dégradation contribue donc à l’amplifier (Barry, 2016).
- Evolution de la problématique :
Initialement, notre problème portait sur l’érosion du trait de côte ainsi que sur les problématiques annexes telles que la submersion marine ou la salinisation des eaux douces. L’état de l’art nous a permis de centrer le problème sur le recul du trait de côte lié aux dynamiques hydrosédimentaires. Cette reformulation clarifie le cadre d’analyse et permet de mieux relier les dimensions physiques, écologiques et sociales du phénomène.
- Evolution de la zone géographique :
- Bibliographie / webographie
BibliographieBarry, M. (2016). Erosion côtière et impacts dans dans la commune de Kafountine (Basse Casamance).https://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/1211Bretagne Vivante. (2025, 30 septembre). Association de protection de la nature.
https://www.bretagne-vivante.org/v
BRGM. (2024, 25 septembre). Littoral, risques côtiers et changement climatique. https://www.brgm.fr/fr/solutions/littoral-risques-cotiers-changement-climatique
Causse, C., Mokhnacheva, D. & Camus, G. (s.d.). Océan, changements climatiques et migration humaine. Ocean-Climate.org https://www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/2017/02/oc%C3%A9an-climat-migration_FichesScientifiques_Oct2016_BD_ppp-12.pdf
Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (s.d.-a) Érosion du littoral : à quoi s’attendre et comment s’adapter ? https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/impacts/erosion-du-littoral
Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. (s.d.-b) Tourisme : une activité sous influence du climat. https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/secteurs-d-activites/tourisme
Cerema & GéoLittoral. (2023). L’artificialisation des sols en France métropolitaine : état des lieux et enjeux. https://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/artificialisation_vf_med_cerema.pdf
Cerema.(s. d.-a). Erosion côtière : Christophe Béchu présente les scénarios nationaux et les cartographies nationales, ainsi que les conséquences pour les territoires littoraux. https://www.cerema.fr/fr/presse/dossier/erosion-cotiere-christophe-bechu-presente-scenarios-0?utm
Cerema. (s. d.-b). – Le Cerema achève la réalisation de l’indicateur national de l’érosion côtière
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-acheve-realisation-indicateur-national-erosion
Cerema. (s.d-c). Risques et territoires – lettre n°24 – mai 2024. https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/risques-territoires/risques-territoires-lettre-ndeg24-mai-2024/risques-territoires-lettre-ndeg24-mai-2024
Combe, M. (2022, 9 février). L’érosion côtière, un risque naturel délaissé des fonds d’indemnisation. Natura Sciences. https://www.natura-sciences.com/comprendre/erosion-cotiere-risque-naturel.html
Conservatoire du Littoral. (s. d.-a). Adapto, un projet Life initié. https://www.lifeadapto.eu/
Conservatoire du littoral. (s. d.-b). dernières acquisitions, actualités, publications. https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, 10 novembre). Rechargement de plage. Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre. Consulté le 27 septembre 2025, sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Rechargement_de_plage
Cyven. (2024, 2 juillet). Le recul du littoral breton, une problématique importante face aux changements climatiques. https : //www-iuem.univ-brest.fr/le-recul-du-littoral-breton-une-problematique-importante-face-aux-changements-climatiques/
Devillers, B., Benlloch, P. O., & Castanyer, P. (2021). Introduction. Méditerranée, 133, 5‑8. https://doi.org/10.4000/mediterranee.12847
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère. (2021). Les traits de côte du Finistère. https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/44736/317999/file/20210118_traits_de_c%C3%B4te_Finist%C3%A8re.pdf
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). (s.d.). Les services de l’État en Finistère. https://www.finistere.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
DREAL, Bretagne. (2025, 10 juillet). Dispositions législatives en matière de trait de côte – Loi Climat et Résilience. https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/dispositions-legislatives-en-matiere-de-trait-de-a4917.html
Échanges Assurance. (2023). Érosion côtière et assurances : quelles couvertures face à ce risque naturel amplifié ?
https://echangesassurances.org/1990/erosion-cotiere-et-assurances-quelles-couvertures-face-a-ce-risque-naturel-amplifie/2023/
FranceEnvironnement. (s. d.). Qu’est-ce que la salinisation d’une nappe phréatique et quels en sont les impacts environnementaux ? https://www.franceenvironnement.com/question/qu-est-ce-que-la-salinisation-une-nappe-phreatique-et-quels-en-sont-les-impacts-environnementaux
GIP Littoral. (2021-a). Stratégie régionale : Introduction. https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/2021-06/SGBC-12-%20strat%C3%A9gie%20r%C3%A9gionale%20introduction.pdf
GIP Littoral. (2021-b). Stratégie régionale – Guide de l’action locale. https://www.giplittoral.fr/sites/default/files/2021-06/SGBC-15-%20strat%C3%A9gie%20r%C3%A9gionale%20Guide%20de%20l%27action%20locale.pdf
GIP Littoral. (2021, 9 septembre). Promulgation de la loi climat et résilience : dispositions relatives à la gestion de l’érosion côtière. https://www.giplittoral.fr/actualites/promulgation-de-la-loi-climat-et-resilience-dispositions-relatives-la-gestion-de
Gouvernement. (2022). Érosion du littoral : un plan de prévention pour les communes les plus touchées. https://www.info.gouv.fr/actualite/erosion-du-littoral-un-plan-de-prevention-pour-les-communes-les-plus-touchees
Gouvernement (2023). Le surtourisme : quel impact sur les villes et sur l’environnement ? https://www.vie-publique.fr/eclairage/24088-le-surtourisme-quel-impact-sur-les-villes-et-sur-lenvironnement?utm
Hachemi, K., Thomas, Y.-F., Senhoury, A. O.-E.-M., Achek-Youcef, M., Ozer, A., & Nouacer, H. A. (2014). Étude de l’évolution du trait de côte au niveau du port de Nouakchott (Mauritanie) à partir d’une chronique d’images SAR d’ENVISAT. Geo-Eco-Trop: Revue Internationale de Géologie, de Géographie et d’Écologie Tropicales, 38(1), 169–178. https://hdl.handle.net/2268/249776
Horizons, L. (2023, 17 novembre). Les digues sont-elles une bonne solution face au risque d’inondation ? Demain la Ville – Bouygues Immobilier. https://www.demainlaville.com/les-digues-sont-elles-une-bonne-solution-face-au-risque-dinondation/
Interreg Maritime. (s. d.). MAREGOT – MAnagement des Risques de l’Érosion côtière et actions de GOuvernance Transfrontalière. https://interreg-maritime.eu/fr/web/maregot/projet
IHE Delft Institute For Water Education. (s. d.). Extreme sea levels to become much more common worldwide as Earth warms. https://www.un-ihe.org/news/extreme-sea-levels-become-much-more-common-worldwide-earth-warms
La librairie ADEME. (s.d.). Objectif « Zéro Artificialisation nette » (ZAN) et contribution de l’ADEME. https://librairie.ademe.fr/urbanisme-territoires-et-sols/4784-objectif-zero-artificialisation-nette-zan-et-contribution-de-l-ademe.html
Le Figaro Nautisme. (2025, 7 août). L’impact du tourisme sur les zones côtières : la plaisance face au mur écologique. https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-escales/2025-08-07/80268-limpact-du-tourisme-sur-les-zones-cotieres-la-plaisance-face-au-mur-ecologique
Légifrance. (1807). Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847111
Légifrance. (2023). Code de l’environnement. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210405/
Légifrance. (2025). Code de l’urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074075
LETG-Géomer – Université de Bretagne Occidentale. (s. d.). Publications scientifiques du laboratoire LETG-Géomer. HAL Archives Ouvertes. https://hal.univ-brest.fr/LETG-GEOMER
Littoral de la Manche. (2025, 13 mai). La salinisation des nappes phréatiques et des sols. https://littoral.manche.fr/risques-littoraux/les-risques-littoraux-dans-la-manche/la-salinisation-des-nappes-phreatiques-et-des-sols/#:~:text=Remont%C3%A9e%20de%20la%20nappe%20phr%C3%A9atique,de%20la%20surface%20du%20sol.
Mayer, C. (2024, 28 mars). Changement climatique : à Lacanau, actions et réflexions pour lutter contre l’érosion. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/03/28/changement-climatique-a-lacanau-actions-et-reflexions-pour-lutter-contre-l-erosion_6224680_3244.html
Ministère de la Transition écologique. (2023, 24 septembre). Artificialisation des sols. https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
Ministère de la Transition écologique. (2022, 8 août). Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/loi-relative-lamenagement-protection-mise-valeur-du-littoral
Observatoire de L’environnement en Bretagne. (s. d.-a). Comment sur le littoral breton fait-on face aux risques d’érosion-submersion ? https://bretagne-environnement.fr/article/adaptation-littoral-risques-cotiers-bretagne?utm_source=chatgpt.com
Observatoire de L’environnement En Bretagne. (s. d.-b). Quelles sont les espèces remarquables qui fréquentent le littoral breton ? https://bretagne-environnement.fr/article/littoral-breton-biodiversite-remarquable
Programme Interreg VA France-Manche-Angleterre. (s. d.). PACCo, Promouvoir l’adaptation aux changements Côtiers – Promoting Adaptation to Changing Coasts. https://www.pacco-interreg.com/?lang=fr
Préfet du Finistère.(s. d.). Prévention des risques littoraux et submersions marines dans le Finistère.
https://www.finistere.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-littoraux-et-submersions-marines-dans-le-Finistere?utm_source=chatgpt.com
Philizot, F., Desforges, C., Pommier, A., & Inspection générale de l’administration. (2022). La coopération transfrontalière des collectivités territoriales. https://www.espaces-transfrontaliers.org/wp-content/uploads/2025/06/2022_Rapport_IGA.pdf
Programme des Nations Unies pour l’environnement. (2016). L’érosion côtière : défis et solutions. https://unepccc.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/9-coastal-erosion-french.pdf
Réseau national des observatoires du trait de côte. (2025, 1 juillet). Chiffres clés de l’érosion. https://observatoires-littoral.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-l-erosion-a225.html
Risques Côtiers. (s.d.). Observatoire OSIRISC. https://www.risques-cotiers.fr/accueil-risques-cotiers/projets/observatoire-osirisc/
Rufin-Soler, C., Ruz, M., Deboudt, P., & Révillon, R. (2020). Comment vivre avec des conflits d’usages au sein d’un espace naturel protégé exposé à des risques littoraux ? https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2020-v20-n1-vertigo06155/1078819ar.pdf
Statistique publique de l’énergie, des transports, du logement et de l’environnement. (2024). Chiffres clés de la mer et du littoral – Édition 2024 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-la-mer-et-du-littoral-edition-2024?utm
Thomas, B., & Débat, F. E. (2024, 3 juillet). Aléas naturels et transformation des littoraux : quels enjeux fonciers ? Fonciers en débat. https://fonciers-en-debat.com/aleas-naturels-et-transformation-des-littoraux-quels-enjeux-fonciers/
Tribune, L. (2024, 11 avril). Érosion du littoral : avec le ZAN, pourra-t-on reloger les victimes du recul du trait de côte ? https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/erosion-du-littoral-avec-le-zan-pourra-t-on-reloger-les-victimes-du-recul-du-trait-de-cote-994993.html
Université du Littoral – Côte d’Opale. (s.d.). Quelles solutions pour le littoral ? https://cosaco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/11/Techniques-protection-2P.pdf
A la découverte du plancton – formation professeurs de primaire sciences & technologie
Le pôle Médiation scientifique accompagne régulièrement les professeurs de l’Éducation nationale dans leur développement professionnel : formation à la démarche d’investigation scientifique et/ou technologique.
Le 19 mars 2024, le fablab a accueilli 27 professeurs de primaire sur une formation organisée par la DSDEN 29 (la direction des services départementaux de l’Éducation nationale) pour partir à la découverte du plancton. Base du réseau trophique, producteur d’oxygène, objet d’études innombrables études scientifiques : le plancton joue plusieurs rôles clés et est un objet d’étude très intéressant en primaire. Mais quel rapport avec le fablab ?!
Le plancton regroupe tous les organismes aquatiques ou marins dérivant dans le courant (n’ayant pas la force de sortir du courant), sans distinction de taille. Une méduse est un plancton. Une micro-algue ou une diatomée aussi. Le krill, bien connu comme source de nourriture pour les baleines est aussi un plancton. Pour observer le petit plancton (inférieur à 1 cm et jusqu’à quelques nanomètres), il faut utiliser un filet à plancton puis l’observer à la loupe binoculaire ou au microscope. Le filet comme les instruments d’observation sont des objets techniques et c’est précisément là que le fablab intervient !
Animé par Yann Ty Coz, conseiller pédagogique de la circonscription de Brest Iroise, Armande Péres, conseillère pédagogique départementale sciences pour le Finistère, et Maud Tournery chargée de médiation scientifique et fabmanager à l’IMT Atlantique, la formation de 3h a permis aux enseignants d’explorer ce qu’est un objet technique. Comment le définir, comment le choisir en fonction du besoin, quel objet technique choisir, comment en fabriquer soi-même ou avec ses élèves ?
Pour l’occasion les enseignants ont appris à fabriquer un smartoscope : un support permettant de placer un smartphone au-dessus d’une lentille optique et d’une lamelle contenant une goutte d’eau. Le zoom obtenu permet d’observer du zooplancton sur le terrain et sans gros moyens…
En dehors du smartoscope, un fablab peut être utilisé avec les élèves ou en accompagnement de projet : gravure de clé de détermination, impression 3D de plancton pour rendre visible l’invisible ou encore animation simple avec des Leds (par exemple en utilisant la mallette MERITE « objets animés »).
Après cette première séance au fablab, les enseignants sont allés pêcher du plancton et l’observer à Océanopolis.
Cette première collaboration sur cette formation était un succès ! L’expérience sera renouvelée autour de filets à plancton cette fois en mars 2026…
Quelques photos de l’atelier au fablab et du test à Océanopolis :

|

Apprentissage de la manipulation d’une perceuse à colonne |

Test de la lumière du smartoscope |
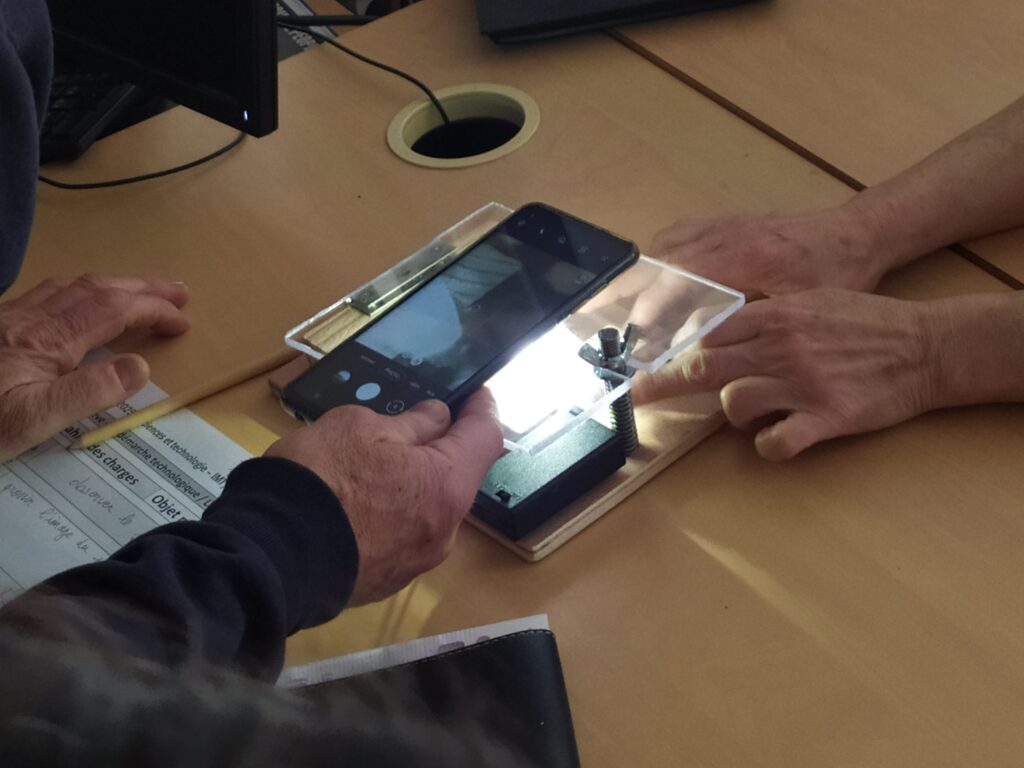
Test du smartoscope avec un smartphone |